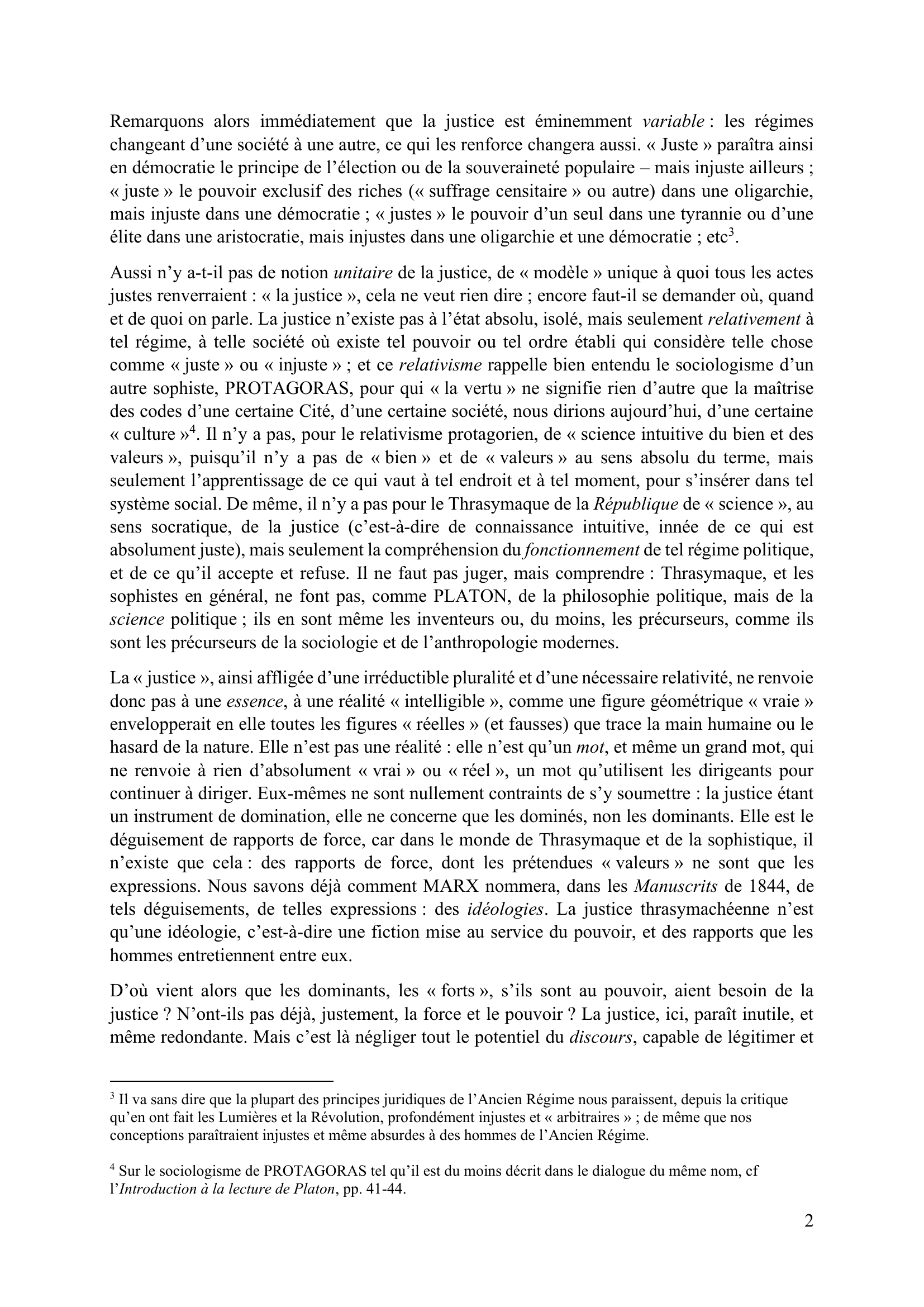explication du cours sur le dialogue de thrasymacque et socrate
Publié le 13/11/2021

Extrait du document
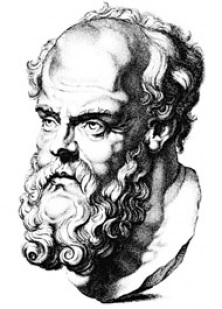
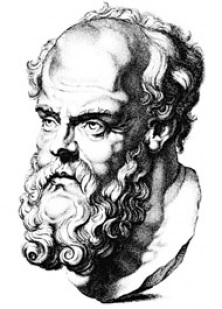
«
2
Remarquons alors immédiatement que la justice est éminemment variable : les régimes
changeant d’une société à une autre, ce qui les renforce changera aussi.
« Juste » paraîtra ainsi
en d émocratie le principe de l’élection ou de la souveraineté populaire – mais injuste ailleurs ;
« juste » le pouvoir exclusif des riches (« suffrage censitaire » ou autre) dans une oligarchie,
mais injuste dans une démocratie ; « justes » le pouvoir d’un seu l dans une tyrannie ou d’une
élite dans une aristocratie, mais injustes dans une oligarchie et une démocratie ; etc 3.
Aussi n’y a -t-il pas de notion unitaire de la justice, de « modèle » unique à quoi tous les actes
justes renverraient : « la justice », cela ne veut rien dire ; encore faut -il se demander où, quand
et de quoi on parle.
La justice n’existe pas à l’état absolu, isolé, mais seulement relativement à
tel régime, à telle société où existe tel pouvoir ou tel ordre établi qui considère telle chose
comme « juste » ou « injuste » ; et ce relativisme rappelle bien entendu le sociologisme d’un
autre sophiste, PROTAGORAS, pour qui « la vertu » ne signifie rien d’autre que la maîtrise
des codes d’une certaine Cité, d’une certaine société, nous dirions aujourd’hui, d’une certaine
« culture »4.
Il n’y a p as, pour le relativisme protagorien, de « science intuitive du bien et des
valeurs », puisqu’il n’y a pas de « bien » et de « valeurs » au sens absolu du terme, mais
seulement l’apprentissage de ce qui vaut à tel endroit et à tel moment, pour s’insérer dan s tel
système social.
De même, il n’y a pas pour le Thrasymaque de la République de « science », au
sens socratique, de la justice (c’est -à-dire de connaissance intuitive, innée de ce qui est
absolument juste), mais seulement la compréhension du fonctionne ment de tel régime politique,
et de ce qu’il accepte et refuse.
Il ne faut pas juger, mais comprendre : Thrasymaque, et les
sophistes en général, ne font pas, comme PLATON, de la philosophie politique, mais de la
science politique ; ils en sont même les in venteurs ou, du moins, les précurseurs, comme ils
sont les précurseurs de la sociologie et de l’anthropologie modernes.
La « justice », ainsi affligée d’une irréductible pluralité et d’une nécessaire relativité, ne renvoie
donc pas à une essence , à une réa lité « intelligible », comme une figure géométrique « vraie »
envelopperait en elle toutes les figures « réelles » (et fausses) que trace la main humaine ou le
hasard de la nature.
Elle n’est pas une réalité : elle n’est qu’un mot , et même un grand mot, qu i
ne renvoie à rien d’absolument « vrai » ou « réel », un mot qu’utilisent les dirigeants pour
continuer à diriger.
Eux -mêmes ne sont nullement contraints de s’y soumettre : la justice étant
un instrument de domination, elle ne concerne que les dominés, no n les dominants.
Elle est le
déguisement de rapports de force, car dans le monde de Thrasymaque et de la sophistique, il
n’existe que cela : des rapports de force, dont les prétendues « valeurs » ne sont que les
expressions.
Nous savons déjà comment MARX n ommera, dans les Manuscrits de 1844, de
tels déguisements, de telles expressions : des idéologies .
La justice thrasymachéenne n’est
qu’une idéologie , c’est -à-dire une fiction mise au service du pouvoir, et des rapports que les
hommes entretiennent entre eu x.
D’où vient alors que les dominants, les « forts », s’ils sont au pouvoir, aient besoin de la
justice ? N’ont -ils pas déjà , justement, la force et le pouvoir ? La justice, ici, paraît inutile, et
même redondante.
Mais c’est là négliger tout le potentiel du discours , capable de légitimer et
3 Il va sans dire que la plupart des principes juridiques de l’Ancien Régime nous paraissent, depuis la critique
qu’en ont fait les Lumières et la Révolution, profondément injustes et « arbitraires » ; de même que nos
conceptions paraîtraient injustes et même absurdes à des hommes de l’Ancien Régime.
4 Sur le sociologisme de PROTAGORAS tel qu’il est du moins décrit dans le dialogue du même nom, cf
l’Introduction à la lecture de Platon , pp.
41 -44..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HUITIÈME DIALOGUE. La Mort de Socrate (résumé)
- DIALOGUE DES COURS (Le) (résumé et analyse)
- Le Ménon de Platon met en scène le dialogue de Socrate avec Ménon, élève du sophiste Gorgias.
- Cours de philosophie ancienne - De Socrate aux Stoiciens
- (IL S'AGIT D'UN DIALOGUE ENTRE SOCRATE ET ALCIBIADE) S.