Explication du texte de Alain: « La force semble […] le loup lui-même »
Publié le 04/02/2012

Extrait du document
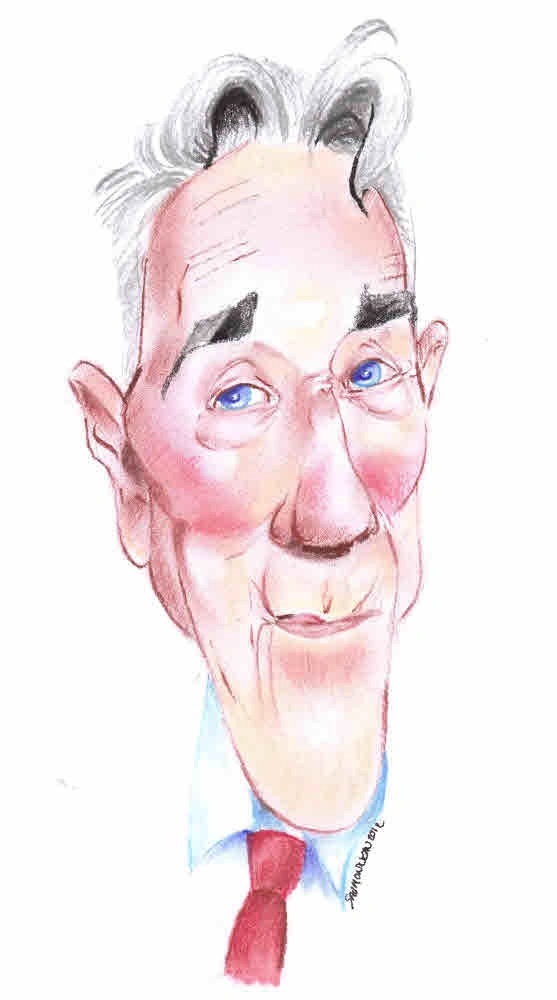
Dans ce texte extrait de l’œuvre Eléments philosophiques publié en 1916, Alain aborde les notions de justice et de droit à travers ce qui semble être un commentaire de la fable De La Fontaine intitulée Le Loup Et L’Agneau. L’extrait oppose donc les thèmes de justice et d’injustice pour essayer de trouver une définition à ce qu’est la justice, idée si abstraite et si controversée. Si on a moyen de parvenir à notre fin, cela veut-il nécessairement dire que nos actes sont jugés justes ? Sur quoi doit se fonder la justice ? La question qui se pose à travers ce texte est ainsi qu’est-ce donc rendre justice ?
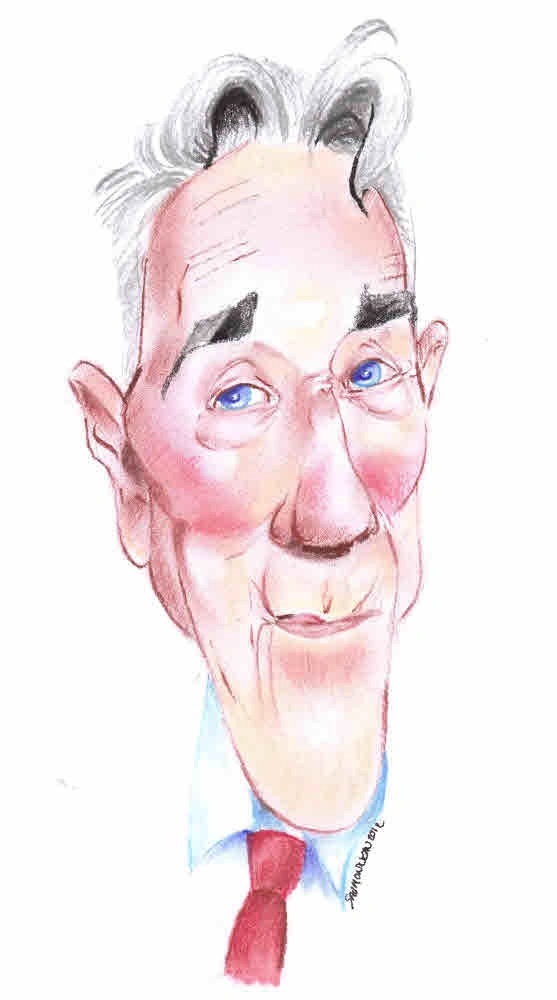
«
Ainsi, on ne peut que parler de justice lorsqu’il y s’agit d’êtres dotés d’une raison.
Cependant, lorsque la forcevient s’ajouter a cette équation, celle-ci mène nécessairement, par prétention d’esprit, a des injustices, car laraison est inefficace face a la force.
Pour obtenir une société juste, elle doit alors se baser uniquement sur laraison.
Effectivement, la justice doit être fondé sur la raison, raison qui est objective et universelle.
Premièrement, Alain énonce « la justice relève du jugement et que le succès n’y fait rien ».
Dans la justice, cen’est pas la fin qui justifie les moyens : si le loup parvient a manger l’agneau, cela ne signifie pas que le loup avaitraison de manger l’agneau et que ces actes sont légitimes.
La force ne fait pas le droit, et le succès d’une actionne la justifie pas.
Il ne s’agit pas d’observer la fin du chemin, mais plutôt le début, c’est à dire les motifs, pourpouvoir donner un jugement.
Un jugement se base donc universellement sur la raison, car la raison seule peutincontestablement nous permettre de faire la distinction, qu’elles que soient les circonstances, entre le bien et lemal.
D’ailleurs, dans un procès, les victimes et les accusés plaident, et les juges rendent justice.
« Plaider c’estargumenter » (l.6) ce que fait l’agneau dans la fable.
Il réfute tous les arguments du loup par des argumentsrationnels et logiques.
Par exemple, dans la fable, le loup accuse l’agneau d’avoir commis ce même délit (de boiredans son territoire) l’année précédente, mais l’agneau lui répond que cela était impossible car il n’était pas encorené.
Le rôle de la justice c’est donc de peser les arguments, les raisons des deux adversaires et par suite décider.La justice se base alors sur l’argumentation des deux partis, sur des justifications qui sont réfléchies et raisonnéesqui ont pour but de convaincre.
« Peser des raisons, non des forces.
» (l.7).
Ainsi, la justice a recours à la forcede conviction, par opposition a frapper, a la force pure et a la violence qui elle nous permettrait de nous donnerraison, sans véritablement l’y être.
Elle doit donc chercher plus loin que la fin, que les conséquences.
Par conséquent il aboutit a une définition de la justice : si l’auteur avait défini l’injustice comme une prétention del’esprit, il définit la justice comme un jugement de l’esprit, et par jugement il veut dire de bonne foi.
Justice etinjustice diffèrent ainsi par l’état d’esprit.
Une prétention de l’esprit c’est croire, de mauvaise foi, avoir droit àquelque chose, arbitrairement et superficiellement, sans fondement consistant.
Une investigation de l’esprit seraitdonc par opposition une recherche de bonne foi de la raison afin de la juger.
Ainsi l’investigation de l’esprit est lejugement par lequel on peut décider si les actes de tel ou tel individu sont conformes à la raison et aux lois.
Pour cela, Alain continue en disant que la justice c’est aussi « l’examen des raisons ».
Nous avons vu que lejugement se fonde sur la raison car celle-ci, universelle et objective, est incontestable.
C’est sur celle-ci qu’il fautdonc se baser pour poursuivre a un examen des raisons.
Les raisons pour lesquelles un individu a effectue uneaction doivent être valables pour qu‘elles soient considérées justes.
Une raison est valable du moment ou elle estconforme aux valeurs morales qui fondent la justice d’abord, et qu’elle ne va pas à l’encontre des droits établispar le législateur.
Ces valeurs morales sont déterminées soit par le droit naturel, soit par le droit positif quiconsidère que les lois dont établies par convention.
D’autre part, le droit naturel est le droit qui découle d’un idéaltranscendant du juste.
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen par exemple qui déclare que « tous leshommes nés et demeurent libres et égales en droit » est une vérité universelle.
On suppose qu’il y a un idéal dejustice universelle qui est conforme en tout temps et pour tous, quelque soit le lieu ou la culture.
Cette normetranscendante se base surtout sur le principe de la dignité humaine.
Ce droit naturel ne peut être contestepuisqu’il est universel, et tant que les raisons lui sont conformes, le jugement serait juste.
Ainsi, la justice n’estpas légitime tant qu’il n’y a pas cet examen des raisons, qui consiste donc en la vérification que les argumentscorrespondent bien aux lois établies.
La justice doit donc essentiellement se fonder sur une investigation de l’esprit, et sur la raison qui doit être enaccord avec les droits établies par l’Etat.
Toutefois, ces droits définissent entre autres l’Egalite entre les hommes,qui joue un rôle primordial dans l’établissement de la justice.
Finalement, le principe d’isonomie impose le caractère impartial de la justice.
Tout d’abord, Alain évoque l’injustice « du parti pris ».
Si la justice est impartiale, elle doit juger tous les hommesobjectivement, sans préjugés et de la même manière : l’institution juridique joue ainsi le rôle d’arbitre, alorsévidemment impartiale.
En effet, tous les hommes sont égaux et ont alors les mêmes droits : les mêmes droits dese faire entendre et les mêmes droits de se faire juger.
Prenons l’exemple d’une accusation de meurtre : le procèsoppose une victime et un accusé.
Les membres de la cour de justice, a savoir juges et avocats, doiventconsidérées les rapports de l’un avec autant d’égalité et d’estime que l’autre.
L’accuse doit avoir le droit de sedéfendre avant que son sort soit décidé.
Or dans un parti pris, pour des raisons quelconques, qu’elles soientpersonnelles (le juge est émotionnellement lié a un membre du parti par exemple) ou politiques, etc., l’autre partine se fait pas entendre ou du moins, ses raisons ne sont pas pris en considérations.
Dans l’exemple de la fable, leloup se déclare lui-même arbitre, et toute justice mise alors de côté, il n’agit que de mauvaise foi.
Il est clair quedans cet exemple le manque de partialité mène à l’injustice.
La justice veut alors que les deux partis soient.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- explication de texte propos, Alain
- Explication de texte: “Système des beaux-arts” , Alain
- explication de texte : Alain, Elements de philosophie
- Explication de Texte Alain
- Explication de texte: Alain Hume
































![Prévisualisation Prévisualisation du document Explication du texte de Alain: « La force semble […] le loup lui-même »](https://static.devoir-de-philosophie.com/img/preview/explication-du-texte-de-alain-la-force-semble-le-loup-lui-meme.png)
