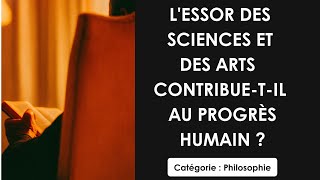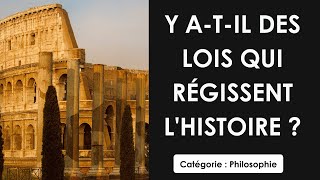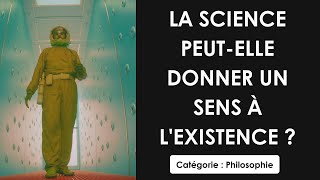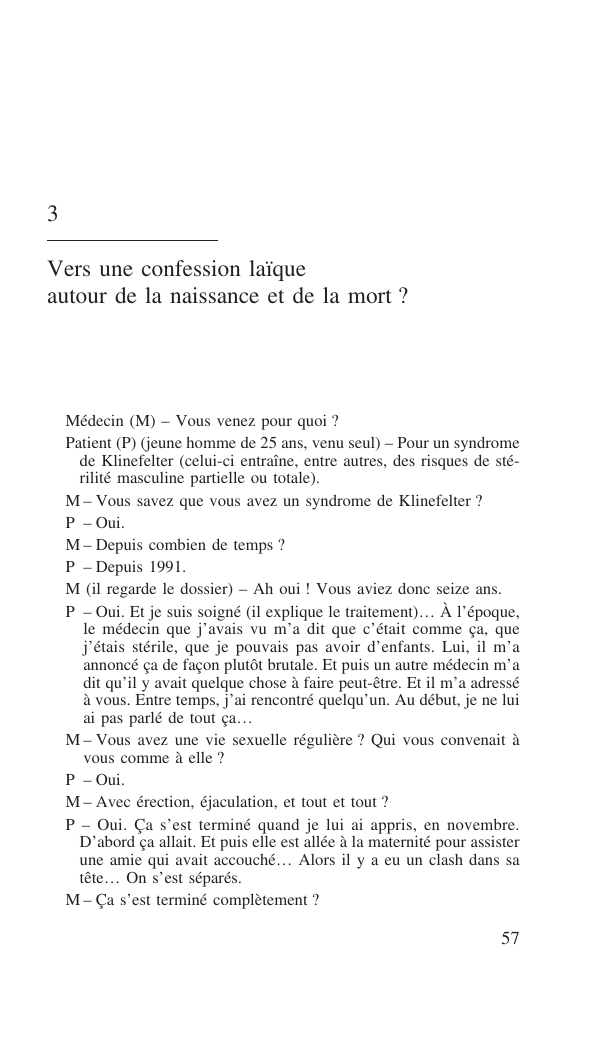faire vivre et laisser mourir
Publié le 22/10/2025
Extrait du document
«
3
Vers une confession laïque
autour de la naissance et de la mort ?
Médecin (M) – Vous venez pour quoi ?
Patient (P) (jeune homme de 25 ans, venu seul) – Pour un syndrome
de Klinefelter (celui-ci entraîne, entre autres, des risques de stérilité masculine partielle ou totale).
M – Vous savez que vous avez un syndrome de Klinefelter ?
P – Oui.
M – Depuis combien de temps ?
P – Depuis 1991.
M (il regarde le dossier) – Ah oui ! Vous aviez donc seize ans.
P – Oui.
Et je suis soigné (il explique le traitement)… À l’époque,
le médecin que j’avais vu m’a dit que c’était comme ça, que
j’étais stérile, que je pouvais pas avoir d’enfants.
Lui, il m’a
annoncé ça de façon plutôt brutale.
Et puis un autre médecin m’a
dit qu’il y avait quelque chose à faire peut-être.
Et il m’a adressé
à vous.
Entre temps, j’ai rencontré quelqu’un.
Au début, je ne lui
ai pas parlé de tout ça…
M – Vous avez une vie sexuelle régulière ? Qui vous convenait à
vous comme à elle ?
P – Oui.
M – Avec érection, éjaculation, et tout et tout ?
P – Oui.
Ça s’est terminé quand je lui ai appris, en novembre.
D’abord ça allait.
Et puis elle est allée à la maternité pour assister
une amie qui avait accouché… Alors il y a eu un clash dans sa
tête… On s’est séparés.
M – Ça s’est terminé complètement ?
57
un bel édifice juridico-politique
P – Oui.
Moi, je voudrais bien savoir si j’ai une chance avec une
autre femme…
M – Bon.
Vous avez fait une analyse de sperme ? (Il étudie le dossier.) Bon, je crains que le Dr X ait eu raison, même s’il a été
brutal.
Les testicules ne fabriquent pas de spermatozoïdes dans
le sperme : c’est ça la maladie de Klinefelter.
Et on ne sera
pas capable d’agir là-dessus.
La probabilité que vous puissiez
provoquer une grossesse est quasi nulle.
Si vous rencontrez une
femme et que vous décidez d’avoir des enfants avec elle, il y a
très peu de chances que ça soit possible.
Maintenant, dans une
situation comme la vôtre, quand on ne peut pas avoir des enfants
tout seuls, ce qui est le cas de beaucoup d’hommes, on peut procéder autrement.
P – Oui, je sais, mais ça provoque des ruptures…
M – Oui, mais il faut remettre les choses dans l’ordre.
Le jour où
vous rencontrerez une femme avec laquelle vous désirez vivre, il
n’y a aucune raison… Il y a plein de femmes qui vivent avec des
hommes stériles.
Ça n’empêche pas d’avoir une bonne vie, en
bonne santé.
Et puis il faut que vous sachiez que vous risquez
de transmettre la maladie aussi (silence).
Bon, ça n’est pas très
drôle, mais vous pouvez vivre avec.
Et quand vous aurez une
femme, vous reviendrez nous voir…
P – Oui, mais…
M – Peut-être que votre relation n’était pas encore assez stable, je
ne sais pas, moi.
Ça, c’est une question de relation, d’amour
dans la relation (silence).
Bon, je vais faire une photocopie pour
conserver ça dans le dossier (il sort).
Bon, eh bien, si vous avez
des questions, vous pouvez toujours reprendre contact avec
moi… (Il se lève.
Ils se saluent.
Fin de la consultation.)
Tel est le type d’entretien qu’autorise la nouvelle administration des conduites.
En matière d’encadrement des pratiques
autour de la reproduction et de la mort, tout se passe comme
si on retrouvait une forme spécifique de surveillance publique
des pratiques : l’autobiographie d’institution 1 .
À quoi
avons-nous affaire en effet ? Qu’est-ce qui est demandé à ceux
qui se déclarent candidats à ces prestations médicales entourant
le corps procréateur et le corps mourant ?
Une biographie, si l’on en croit une des trois définitions qui
en sont proposées par Lejeune : « L’histoire d’un homme
1.
Cette notion a été systématisée par Bernard Pudal et Claude Pennetier, in C.
PENB.
PUDAL, Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste,
Belin, Paris, 2002.
NETIER,
58
vers une confession laïque autour de la naissance et de la mort ?
raconté par lui-même à un ou des autres qui l’aident par leur
écoute à s’orienter dans sa vie 2 .
» Obtenir l’intervention
convoitée exige bien d’évoquer sa « détresse » ou son « désir
d’enfant » et de produire une part de sa biographie à ceux qui
vont d’une manière ou d’une autre, plus ou moins fugitivement,
matériellement ou verbalement, la prendre en charge.
Une autobiographie, puisque c’est le demandeur qui se
raconte.
Mais la grande particularité de ces discours sur soi, c’est
qu’ils ne sont pas laissés à l’initiative de l’individu, comme
ceux qui sont à visée littéraire (autobiographies à fin de publication) ou psychologique (journaux intimes).
Ils sont officiellement sollicités par le représentant d’une institution.
Il existe certes aujourd’hui tout un champ d’analyse sur les
biographies et autobiographies littéraires 3.
Il en existe un sur les
journaux intimes 4.
Plus proche de notre objet, il en existe un
autre consacré aux biographies sollicitées lors de cette conjoncture très particulière qui met aux prises un sociologue avec ses
objets de recherche : le produit de cette situation a donné lieu,
sous la qualification notamment de « récit de vie », à une littérature prolixe 5.
Mais les véritables autobiographies d’institution ont été assez
peu exploitées au total, y compris celle qui devrait nous
concerner en tout premier lieu : le discours habituel sollicité au
cours des consultations médicales, l’« anamnèse ».
Des situations officielles où le représentant d’une institution réclame un
récit sur soi un peu circonstancié, on a fait au fond assez peu
de cas hors, depuis quelques années, quelques politistes surtout.
On s’est ainsi intéressé à la présentation de soi des élites
politiques : cadres du PCF, membres de la Ligue des droits de
l’homme, personnalités politiques 6.
Plus sociologues, certains
2.
Par opposition à « l’histoire, d’un homme (en général célèbre) écrite par quelqu’un
d’autre », c’est « l’histoire d’un homme (en général obscur) racontée oralement par luimême à quelqu’un d’autre qui a suscité ce récit pour l’étudier » : Ph.
LEJEUNE, Moi
aussi, Le Seuil, Paris, 1986, p.
18.
3.
Cf.
J.
LECARME, E.
LECARME-TABONE, L’Autobiographie, Armand Colin, Paris,
1999 ; Ph.
LEJEUNE, L’Autobiographie.
De la littérature aux médias, Le Seuil, Paris,
1980, et L’Autobiographie en France, Armand Colin, coll.
« Cursus », Paris, 1998.
4.
Cf.
Ph.
LEJEUNE, Le Moi des demoiselles, Le Seuil, Paris, 1993.
5.
Pour une synthèse, cf.
D.
MEMMI, « L’enquêteur enquêté.
De la connaissance par
corps dans l’entretien sociologique », Genèses, nº 35, juin 1999, p.
131-145.
6.
C.
PENNETIER, B.
PUDAL, « For intérieur et remise de soi.
L’autobiographie
communiste d’institution (1931-1939) : étude du cas de Paul Esnault », in CURAPP, Le
For intérieur, PUF, Paris, 1995, p.
325-340 ; E.
AGRIKOLIANSKI, « Biographies d’insti-
59
un bel édifice juridico-politique
se sont intéressés à la présentation de soi des plus démunis face
aux assistants sociaux, aux guichets des caisses d’assurance
sociale, aux commissions d’attribution de prestations diverses,
voire aux destinataires des discours de manche 7.
C’est pourtant
une pratique institutionnelle constante de nos sociétés que celle
qui consiste à justifier une demande faite à l’institution par la
production d’une présentation de soi minimale.
Carte d’identité, curriculum vitae, livret de famille : cette justification produite à la demande est plus ou moins bavarde, mais elle est si
constante qu’elle peut apparaître inaperçue, ce qui pourrait
expliquer l’intérêt relativement faible qu’on lui a accordé.
Il est cependant une autobiographie d’institution qui a été un
peu systématiquement analysée, et par des auteurs différents : la
confession religieuse 8.
On va voir que, malgré les apparences,
elle peut servir utilement de référence à notre analyse, comme
elle a servi, de manière plus ou moins appuyée, à d’autres 9.
Il
est quelques traits de notre dispositif qui le rapprochent parfois
de manière saisissante des procédures religieuses de contrôle du
for interieur.
Mais la figure de la confession religieuse est peutêtre encore plus précieuse par les énormes différences qu’elle
présente avec la sollicitation médicale idéale d’aujourd’hui, et
donc par les lumières qu’elle peut projeter sur elle de ce fait.
La comparaison permettra aussi au lecteur d’opérer spontanément des rapprochements inattendus avec d’autres autobiographies d’institution, d’en récuser d’autres encore, pourtant plus
évidents à première vue.
On va proposer donc ici ce qui pourrait
bien apparaître à certains moments comme un exercice de style,
utile cependant par les lumières qu’il projette tout de même sur
tution et mise en scène de l’intellectuel.
Les candidats au comité central de la LDH »,
Politix, nº 27, 3e trimestre 1994, p.
94-111 ; Annie COLLOVALD, « Identités stratégiques », Actes de la recherche en sciences sociales, nº 73, 1988, p.
29-40.
7.
J.F.
LAE et N.
MURARD, Le Récit des malheurs, Descartes et Cie, Paris, 1995 ;
V.
DUBOIS, La Vie au guichet, Economica, Paris, 1999 ; D.
FASSIN, « La supplique.
Stratégies....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- faut-il vivre comme si nous devions jamais mourir ?
- « Vivre, c’est apprendre à mourir ».
- Que faire des traces du passé ? Faut-il s'en libérer, s'en débarrasser ? Est-ce possible ou bien est-on condamné à vivre avec ?
- Faudrait-il vivre comme si nous ne devions jamais mourir ?
- Doit-on vivre comme si l'on ne devait jamais mourir ?