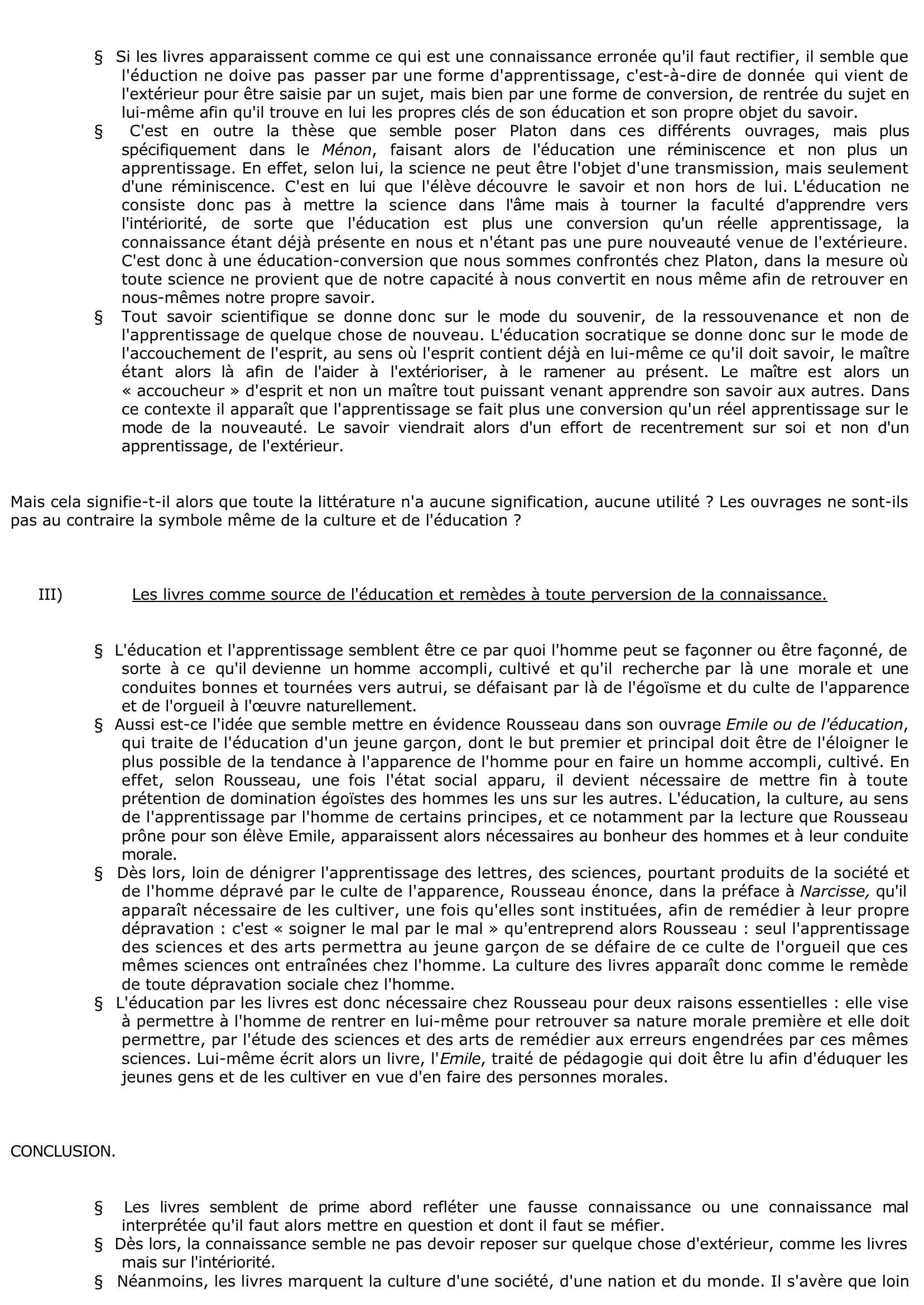FAUT IL SE MEFIER DES LIVRES ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
§ Il apparaît de prime abord que les livres sont une valeur nécessaire à la culture, au sens où ils sont le support de toute éducation, de toute culture. Dès lors la question posée semble de prime abord étonnante, au sens où il semble que les livres, loin d’être source de méfiance, soient source de confiance.
§ Néanmoins, il arrive que nous ne comprenions pas les livres ou que nous les comprenions mal, de sorte, que quand bien même la connaissance qui en est issue serait bonne, nous le déformerions en la comprenant mal. Les livres seraient alors source d’erreur et non de connaissance, demandant de fait une remis de en question radicale de leur contenu ainsi que de l’interprétation que l’on en fait.
§ Mais se pose alors la question de savoir à quoi tient la connaissance, quel est son point de départ, si elle n’est pas issue des livres. De plus, que faire de la culture si elle ne repose plus sur les livres ?
§ Doit-on alors se méfier des livres en eux-mêmes ou de l’interprétation qu’on en fait ? La connaissance doit elle prendre un autre fondement que celui des livres et si oui lequel ?
§ Se pose alors le problème suivant : La connaissance par les livres doit-elle être radicalement remise en question, cette connaissance étant erronée et source d’interprétations fausses ou les livres sont-ils le remèdes à toute dépravation de la culture et de la connaissance ?
I) La méfiance eu égard des livres comme condition de possibilité de tout progrès dans la connaissance.
II) La connaissance comme repli sur soi même, sans recours à aucune extériorité.
III) Les livres comme source de l’éducation et remèdes à toute perversion de la connaissance.
«
§ Si les livres apparaissent comme ce qui est une connaissance erronée qu'il faut rectifier, il semble quel'éduction ne doive pas passer par une forme d'apprentissage, c'est-à-dire de donnée qui vient del'extérieur pour être saisie par un sujet, mais bien par une forme de conversion, de rentrée du sujet enlui-même afin qu'il trouve en lui les propres clés de son éducation et son propre objet du savoir. § C'est en outre la thèse que semble poser Platon dans ces différents ouvrages, mais plusspécifiquement dans le Ménon , faisant alors de l'éducation une réminiscence et non plus un apprentissage.
En effet, selon lui, la science ne peut être l'objet d'une transmission, mais seulementd'une réminiscence.
C'est en lui que l'élève découvre le savoir et non hors de lui.
L'éducation neconsiste donc pas à mettre la science dans l'âme mais à tourner la faculté d'apprendre versl'intériorité, de sorte que l'éducation est plus une conversion qu'un réelle apprentissage, laconnaissance étant déjà présente en nous et n'étant pas une pure nouveauté venue de l'extérieure.C'est donc à une éducation-conversion que nous sommes confrontés chez Platon, dans la mesure oùtoute science ne provient que de notre capacité à nous convertit en nous même afin de retrouver ennous-mêmes notre propre savoir. § Tout savoir scientifique se donne donc sur le mode du souvenir, de la ressouvenance et non del'apprentissage de quelque chose de nouveau.
L'éducation socratique se donne donc sur le mode del'accouchement de l'esprit, au sens où l'esprit contient déjà en lui-même ce qu'il doit savoir, le maîtreétant alors là afin de l'aider à l'extérioriser, à le ramener au présent.
Le maître est alors un« accoucheur » d'esprit et non un maître tout puissant venant apprendre son savoir aux autres.
Dansce contexte il apparaît que l'apprentissage se fait plus une conversion qu'un réel apprentissage sur lemode de la nouveauté.
Le savoir viendrait alors d'un effort de recentrement sur soi et non d'unapprentissage, de l'extérieur. Mais cela signifie-t-il alors que toute la littérature n'a aucune signification, aucune utilité ? Les ouvrages ne sont-ilspas au contraire la symbole même de la culture et de l'éducation ? III) Les livres comme source de l'éducation et remèdes à toute perversion de la connaissance. § L'éducation et l'apprentissage semblent être ce par quoi l'homme peut se façonner ou être façonné, desorte à ce qu'il devienne un homme accompli, cultivé et qu'il recherche par là une morale et uneconduites bonnes et tournées vers autrui, se défaisant par là de l'égoïsme et du culte de l'apparenceet de l'orgueil à l'œuvre naturellement. § Aussi est-ce l'idée que semble mettre en évidence Rousseau dans son ouvrage Emile ou de l'éducation , qui traite de l'éducation d'un jeune garçon, dont le but premier et principal doit être de l'éloigner leplus possible de la tendance à l'apparence de l'homme pour en faire un homme accompli, cultivé.
Eneffet, selon Rousseau, une fois l'état social apparu, il devient nécessaire de mettre fin à touteprétention de domination égoïstes des hommes les uns sur les autres.
L'éducation, la culture, au sensde l'apprentissage par l'homme de certains principes, et ce notamment par la lecture que Rousseauprône pour son élève Emile, apparaissent alors nécessaires au bonheur des hommes et à leur conduitemorale. § Dès lors, loin de dénigrer l'apprentissage des lettres, des sciences, pourtant produits de la société etde l'homme dépravé par le culte de l'apparence, Rousseau énonce, dans la préface à Narcisse, qu'il apparaît nécessaire de les cultiver, une fois qu'elles sont instituées, afin de remédier à leur propredépravation : c'est « soigner le mal par le mal » qu'entreprend alors Rousseau : seul l'apprentissagedes sciences et des arts permettra au jeune garçon de se défaire de ce culte de l'orgueil que cesmêmes sciences ont entraînées chez l'homme.
La culture des livres apparaît donc comme le remèdede toute dépravation sociale chez l'homme. § L'éducation par les livres est donc nécessaire chez Rousseau pour deux raisons essentielles : elle viseà permettre à l'homme de rentrer en lui-même pour retrouver sa nature morale première et elle doitpermettre, par l'étude des sciences et des arts de remédier aux erreurs engendrées par ces mêmessciences.
Lui-même écrit alors un livre, l' Emile , traité de pédagogie qui doit être lu afin d'éduquer les jeunes gens et de les cultiver en vue d'en faire des personnes morales. CONCLUSION.
§ Les livres semblent de prime abord refléter une fausse connaissance ou une connaissance malinterprétée qu'il faut alors mettre en question et dont il faut se méfier. § Dès lors, la connaissance semble ne pas devoir reposer sur quelque chose d'extérieur, comme les livresmais sur l'intériorité. § Néanmoins, les livres marquent la culture d'une société, d'une nation et du monde.
Il s'avère que loin.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il vraiment se mefier des apparences ?
- FAUT-IL SE MEFIER DE LA RAISON ?
- Dans Les Mouches, pièce de Jean-Paul Sartre, l'un des personnages expose ce qu'est pour lui la culture (il s'agit du pédagogue qui s'adresse à son élève, Oreste, un jeune homme de dix-huit ans) : « Que faites-vous de la culture, monsieur?... Ne vous ai-je pas fait, de bonne heure, lire tous les livres, pour vous familiariser avec la diversité des opinions humaines et parcourir cent États, en vous remontrant en chaque circonstance comme c'est chose variable que les mœurs des hommes? A
- Jean Paul Sartre, écrivain du XXe siècle affirme à la fin de son autobiographie, les mots : Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée: à présent, je connais notre impuissance. N'importe: je fais, je ferais des livres; il en faut cela sert tout de même. Vous vous interrogerez sur le caractère pessimiste de cette position
- Jean Paul Sartre, écrivain du XXe siècle affirme à la fin de son autobiographie, les mots : Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée: à présent, je connais notre impuissance. N'importe: je fais, je ferais des livres; il en faut cela sert tout de même. Vous vous interrogerez sur le caractère pessimiste de cette position