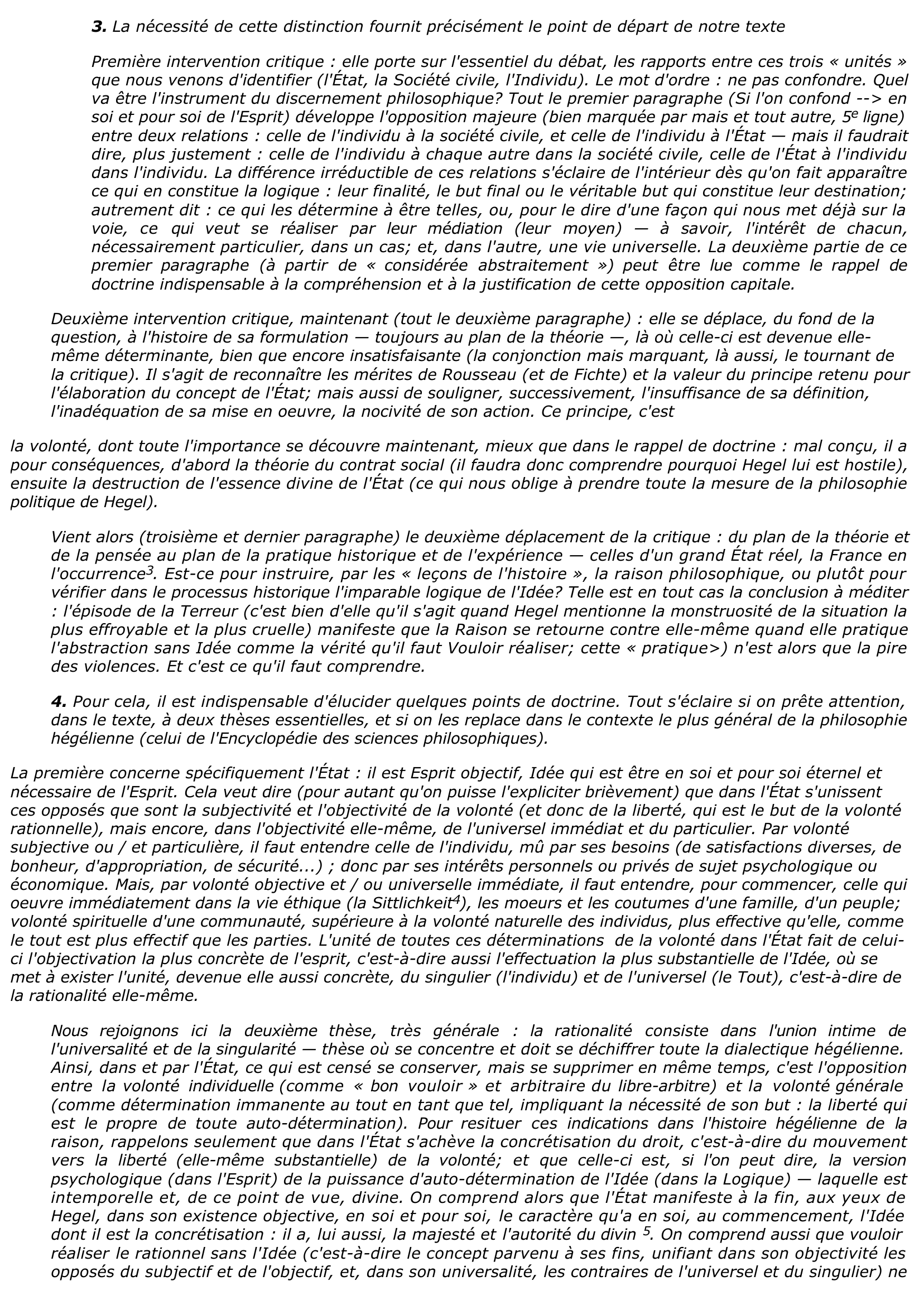HEGEL: Que l'État de Rousseau et de Fichte reste abstrait...
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
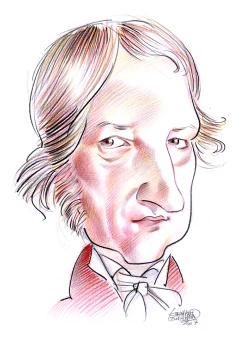
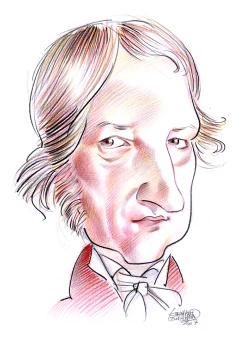
«
3.
La nécessité de cette distinction fournit précisément le point de départ de notre texte
Première intervention critique : elle porte sur l'essentiel du débat, les rapports entre ces trois « unités »que nous venons d'identifier (l'État, la Société civile, l'Individu).
Le mot d'ordre : ne pas confondre.
Quelva être l'instrument du discernement philosophique? Tout le premier paragraphe (Si l'on confond --> ensoi et pour soi de l'Esprit) développe l'opposition majeure (bien marquée par mais et tout autre, 5e ligne) entre deux relations : celle de l'individu à la société civile, et celle de l'individu à l'État — mais il faudraitdire, plus justement : celle de l'individu à chaque autre dans la société civile, celle de l'État à l'individudans l'individu.
La différence irréductible de ces relations s'éclaire de l'intérieur dès qu'on fait apparaîtrece qui en constitue la logique : leur finalité, le but final ou le véritable but qui constitue leur destination;autrement dit : ce qui les détermine à être telles, ou, pour le dire d'une façon qui nous met déjà sur lavoie, ce qui veut se réaliser par leur médiation (leur moyen) — à savoir, l'intérêt de chacun,nécessairement particulier, dans un cas; et, dans l'autre, une vie universelle.
La deuxième partie de cepremier paragraphe (à partir de « considérée abstraitement ») peut être lue comme le rappel dedoctrine indispensable à la compréhension et à la justification de cette opposition capitale.
Deuxième intervention critique, maintenant (tout le deuxième paragraphe) : elle se déplace, du fond de laquestion, à l'histoire de sa formulation — toujours au plan de la théorie —, là où celle-ci est devenue elle-même déterminante, bien que encore insatisfaisante (la conjonction mais marquant, là aussi, le tournant dela critique).
Il s'agit de reconnaître les mérites de Rousseau (et de Fichte) et la valeur du principe retenu pourl'élaboration du concept de l'État; mais aussi de souligner, successivement, l'insuffisance de sa définition,l'inadéquation de sa mise en oeuvre, la nocivité de son action.
Ce principe, c'est
la volonté, dont toute l'importance se découvre maintenant, mieux que dans le rappel de doctrine : mal conçu, il apour conséquences, d'abord la théorie du contrat social (il faudra donc comprendre pourquoi Hegel lui est hostile),ensuite la destruction de l'essence divine de l'État (ce qui nous oblige à prendre toute la mesure de la philosophiepolitique de Hegel).
Vient alors (troisième et dernier paragraphe) le deuxième déplacement de la critique : du plan de la théorie etde la pensée au plan de la pratique historique et de l'expérience — celles d'un grand État réel, la France enl'occurrence 3.
Est-ce pour instruire, par les « leçons de l'histoire », la raison philosophique, ou plutôt pour vérifier dans le processus historique l'imparable logique de l'Idée? Telle est en tout cas la conclusion à méditer: l'épisode de la Terreur (c'est bien d'elle qu'il s'agit quand Hegel mentionne la monstruosité de la situation laplus effroyable et la plus cruelle) manifeste que la Raison se retourne contre elle-même quand elle pratiquel'abstraction sans Idée comme la vérité qu'il faut Vouloir réaliser; cette « pratique>) n'est alors que la piredes violences.
Et c'est ce qu'il faut comprendre.
4.
Pour cela, il est indispensable d'élucider quelques points de doctrine.
Tout s'éclaire si on prête attention,dans le texte, à deux thèses essentielles, et si on les replace dans le contexte le plus général de la philosophiehégélienne (celui de l'Encyclopédie des sciences philosophiques).
La première concerne spécifiquement l'État : il est Esprit objectif, Idée qui est être en soi et pour soi éternel etnécessaire de l'Esprit.
Cela veut dire (pour autant qu'on puisse l'expliciter brièvement) que dans l'État s'unissentces opposés que sont la subjectivité et l'objectivité de la volonté (et donc de la liberté, qui est le but de la volontérationnelle), mais encore, dans l'objectivité elle-même, de l'universel immédiat et du particulier.
Par volontésubjective ou / et particulière, il faut entendre celle de l'individu, mû par ses besoins (de satisfactions diverses, debonheur, d'appropriation, de sécurité...) ; donc par ses intérêts personnels ou privés de sujet psychologique ouéconomique.
Mais, par volonté objective et / ou universelle immédiate, il faut entendre, pour commencer, celle quioeuvre immédiatement dans la vie éthique (la Sittlichkeit 4), les moeurs et les coutumes d'une famille, d'un peuple; volonté spirituelle d'une communauté, supérieure à la volonté naturelle des individus, plus effective qu'elle, commele tout est plus effectif que les parties.
L'unité de toutes ces déterminations de la volonté dans l'État fait de celui- ci l'objectivation la plus concrète de l'esprit, c'est-à-dire aussi l'effectuation la plus substantielle de l'Idée, où se met à exister l'unité, devenue elle aussi concrète, du singulier (l'individu) et de l'universel (le Tout), c'est-à-dire dela rationalité elle-même.
Nous rejoignons ici la deuxième thèse, très générale : la rationalité consiste dans l'union intime de l'universalité et de la singularité — thèse où se concentre et doit se déchiffrer toute la dialectique hégélienne. Ainsi, dans et par l'État, ce qui est censé se conserver, mais se supprimer en même temps, c'est l'oppositionentre la volonté individuelle (comme « bon vouloir » et arbitraire du libre-arbitre) et la volonté générale (comme détermination immanente au tout en tant que tel, impliquant la nécessité de son but : la liberté quiest le propre de toute auto-détermination).
Pour resituer ces indications dans l'histoire hégélienne de laraison, rappelons seulement que dans l'État s'achève la concrétisation du droit, c'est-à-dire du mouvementvers la liberté (elle-même substantielle) de la volonté; et que celle-ci est, si l'on peut dire, la versionpsychologique (dans l'Esprit) de la puissance d'auto-détermination de l'Idée (dans la Logique) — laquelle estintemporelle et, de ce point de vue, divine.
On comprend alors que l'État manifeste à la fin, aux yeux de Hegel, dans son existence objective, en soi et pour soi, le caractère qu'a en soi, au commencement, l'Idée dont il est la concrétisation : il a, lui aussi, la majesté et l'autorité du divin 5.
On comprend aussi que vouloir réaliser le rationnel sans l'Idée (c'est-à-dire le concept parvenu à ses fins, unifiant dans son objectivité les opposés du subjectif et de l'objectif, et, dans son universalité, les contraires de l'universel et du singulier) ne.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'héritage idéaliste en philosophie (Kant, Fichte et Hegel) ?
- LA QUESTION DE L'ESCLAVAGE CHEZ HEGEL ET ROUSSEAU
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- Je suis libre quand je suis auprès de moi (Hegel
- L'indicible chez Bergson et Hegel