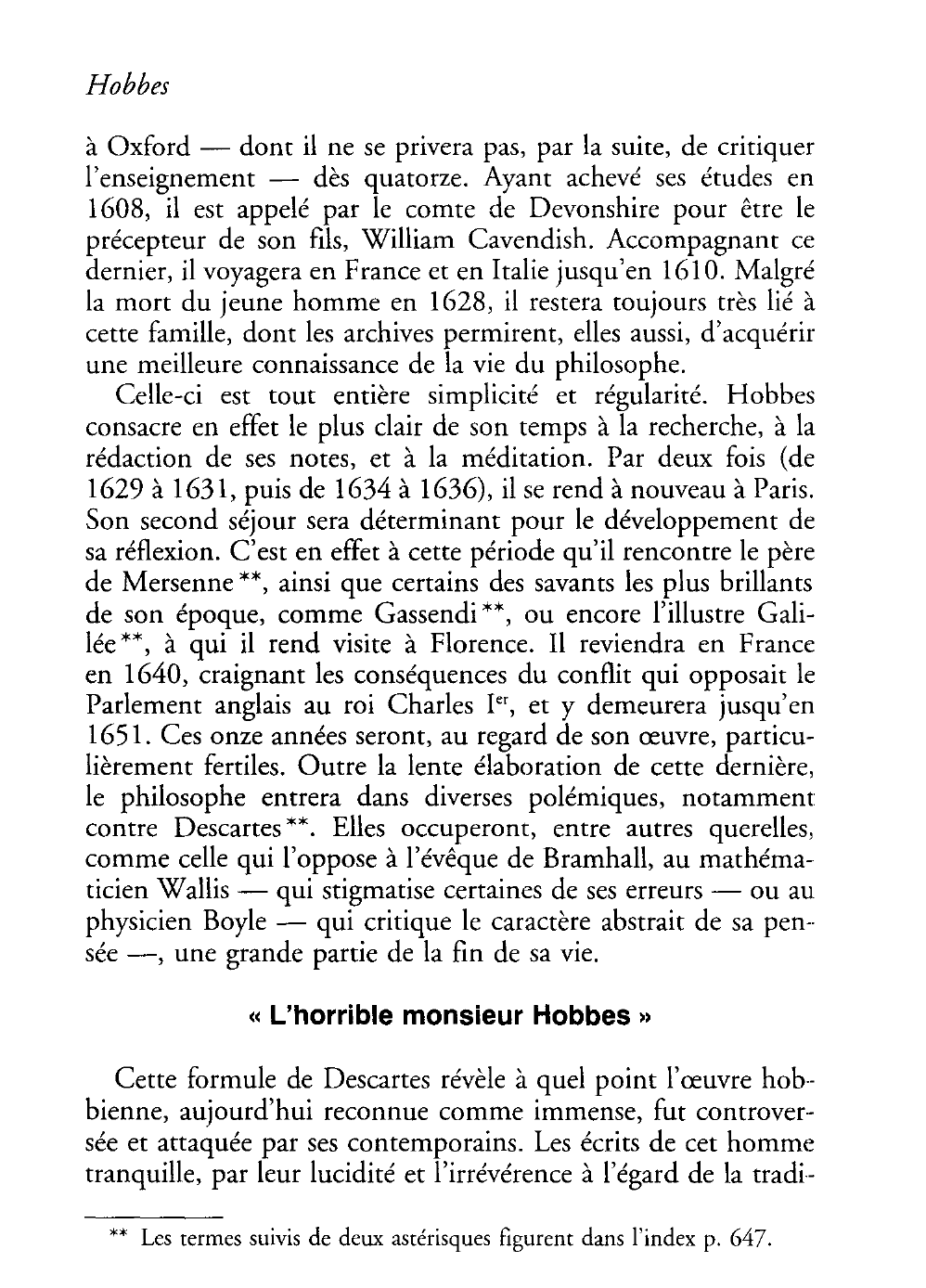HOBBES: Analyse de l'oeuvre
Publié le 03/10/2013

Extrait du document
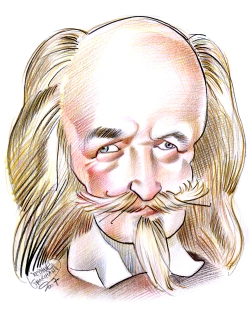
L'un des points les plus importants de l'oeuvre politique de
Hobbes réside en effet dans la séparation établie entre le pouvoir
du souverain et l'autorité divine. La doctrine catholique fait
dépendre strictement le premier de la seconde. La réflexion de
Hobbes aboutit à une affirmation de leur indépendance. Prenant
appui sur une méthode et des observations qu'il veut scientifiques,
il défend l'opinion que tout ce qui concerne l'autorité
civile appartient aux seuls individus, et décrit les mécanismes de
son institution. Ce faisant, il répudie tout simplement l'idée traditionnelle
de la monarchie de droit divin. Cela suffisait amplement
à faire tenir sa doctrine pour séditieuse, notamment dans
une France au sein de laquelle ce principe était encore très profondément
ancré dans les mentalités. Avant de se mettre à dos l'élite
cultivée de sa terre d'exil, Hobbes était dès le commencement de
son exercice en conflit avec les opinions ayant cours dans son pays
natal. Outre ce ferment d'athéisme dénoncé par tous, sa pensée
allait également à l'encontre d'un mode de gouvernement cher
aux Anglais : la monarchie parlementaire. En effet, si le type de
régime monarchique qu'il défendait était délivré de sa filiation
divine, il était en revanche marqué par un absolutisme qui, lui
aussi, choqua les esprits.
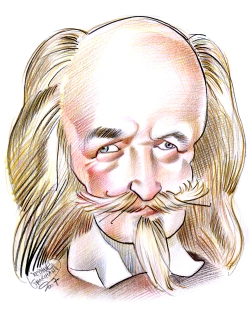
«
Hobbes
à Oxford - dont il ne se privera pas, par la suite, de critiquer
l'enseignement - dès quatorze.
Ayant achevé ses études en
1608, il est appelé par le comte de Devonshire pour être le
précepteur de son fils, William Cavendish.
Accompagnant ce
dernier,
il voyagera en France et en Italie jusqu'en 1610.
Malgré
la
mort du jeune homme en 1628, il restera toujours très lié à
cette famille,
dont les archives permirent, elles aussi, d'acquérir
une meilleure connaissance de la vie du philosophe.
Celle-ci est
tout entière simplicité et régularité.
Hobbes
consacre en effet le plus clair de son temps à la recherche, à la
rédaction de ses notes, et à la méditation.
Par deux fois (de
1629 à 1631, puis de 1634 à 1636), il se rend à nouveau à Paris.
Son second séjour sera déterminant pour le développement de
sa réflexion.
C'est en effet à cette période qu'il rencontre le père
de Mersenne**, ainsi que certains des savants les plus brillants
de son époque, comme Gassendi**, ou encore l'illustre Gali
lée**, à
qui il rend visite à Florence.
Il reviendra en France
en 1640, craignant les conséquences du conflit qui opposait le
Parlement anglais au roi Charles Ier, et y demeurera jusqu'en
1651.
Ces onze années seront, au regard de son œuvre, particu
lièrement fertiles.
Outre la lente élaboration de cette dernière,
le
philosophe entrera dans diverses polémiques, notamment
contre Descartes**.
Elles occuperont, entre autres querelles,
comme celle qui l'oppose à l'évêque de Bramhall, au mathéma
ticien Wallis - qui stigmatise certaines de ses erreurs - ou au
physicien Boyle - qui critique le caractère abstrait de sa pen-·
sée -, une grande partie de la fin de sa vie.
« L'horrible monsieur Hobbes »
Cette formule de Descartes révèle à quel point l'œuvre hob-
bienne, aujourd'hui reconnue comme immense, fut controver·
sée
et attaquée par ses contemporains.
Les écrits de cet homme
tranquille, par leur lucidité et l'irrévérence à l'égard de la tradi-
** Les termes suivis de deux astérisques figurent dans l'index p.
647..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- les contemplations d'Hugo (résumé et analyse de l'oeuvre)
- VOLEUR (le). Roman de Georges Darien (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- VIE DE SAINT LOUIS de Jean, sire de Joinville (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- HISTOIRE DE L’œIL de Georges Bataille (résumé et analyse de l'oeuvre)
- RÈGLE DU JEU (la) de Michel Leiris (résumé et analyse de l'oeuvre)