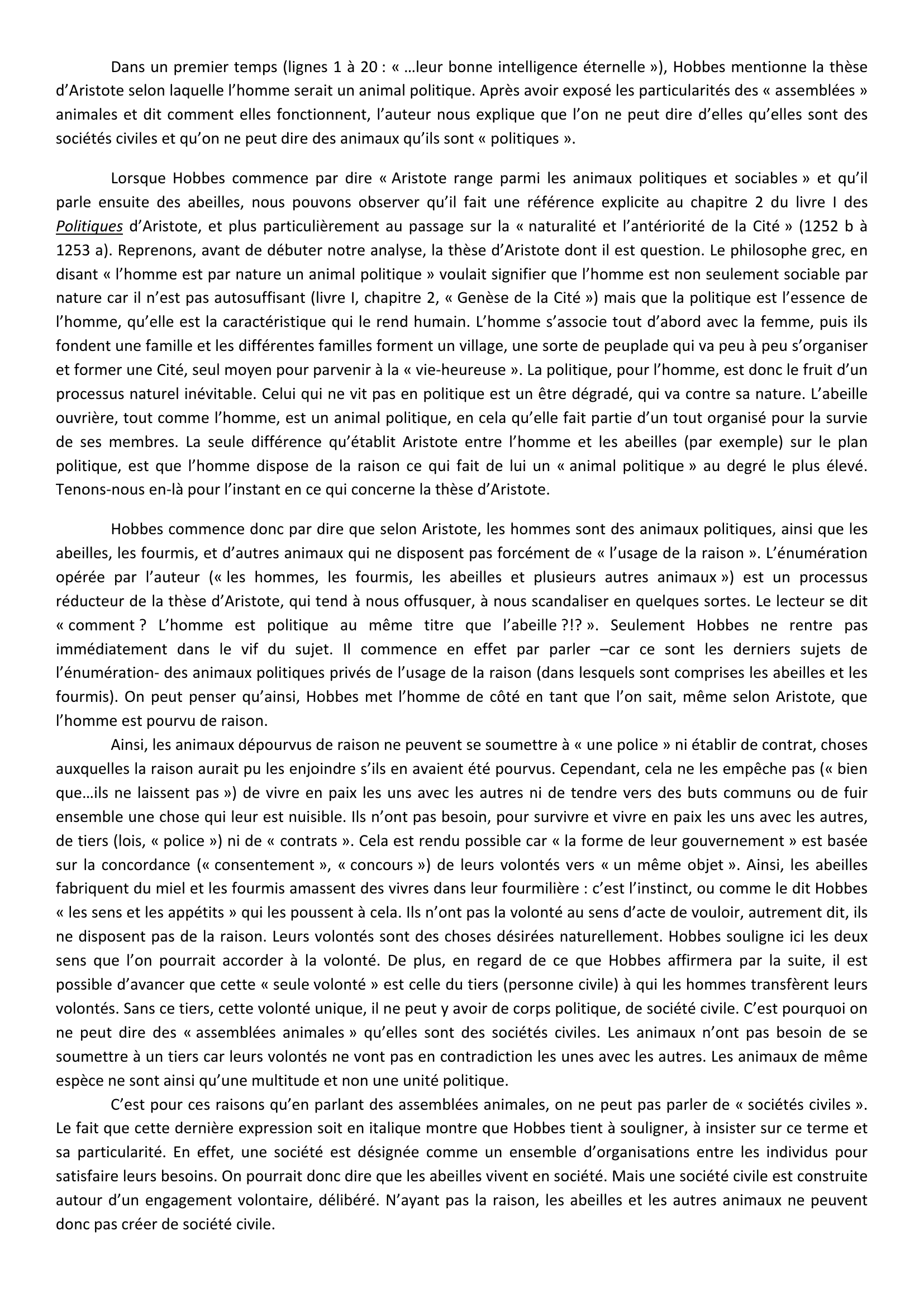Hobbes, De Cive, Section II « L'Empire », chapitre V, paragraphes 5 et 6. Commentaire
Publié le 07/04/2013

Extrait du document
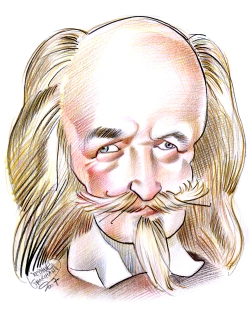
Le texte que nous allons étudier est extrait du chapitre 5 de la section II (§5 et 6) de l’ouvrage de Thomas Hobbes intitulé Du citoyen. Ce livre a été publié en 1642, alors qu’une guerre civile surgit en Angleterre. L’auteur a donc écrit cette œuvre lors d’une période de conflits entre le Parlement et le Roi, qui eut lieu dans son pays d’origine. La démarche politique de Hobbes s’inscrit donc de manière cohérente dans la volonté de répondre aux problèmes politiques de son époque.
Dans ce passage, Hobbes va partir de l’expression aristotélicienne « l’homme est par nature un animal politique « pour montrer qu’au contraire, l’homme n’est pas sociable, n’est pas politique naturellement, mais qu’il l’est par accident. Mais pourquoi peut-on dire que l’homme n’est pas politique, sociable par nature ? Qu’est-ce qui le distingue de l’animal à ce sujet ? En regard de cela, que devra alors faire l’homme pour conserver sa vie et vivre en paix avec ses semblables ?
Hobbes affirmera que c’est pour pouvoir conserver sa vie que l’homme devra sortir de l’état de guerre dans lequel ses appétits naturels le paralysent, et que pour cela, il lui faudra établir des contrats avec ses semblables, mais surtout se soumettre à une seule et unique volonté. Cette volonté sera la représentante de la volonté des individus, qu’ils auront eux-mêmes choisie. Cette volonté unique, qu’il s’agisse d’une assemblée ou d’un souverain, aura pour devoir de garantir aux individus la paix et la sécurité.
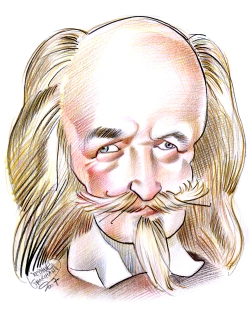
«
Dans un premier temps (lignes 1 à 20 : « …leur bonne intelligence éternelle ») , Hobbes mentionne la thèse
d’Aristote selon laquelle l’homme serait un animal politique .
Après avoir exposé les particularités des « assemblées »
animales et dit comment elles fonctionnent, l’auteur nous explique que l’on ne peut dire d’elles qu’elles sont des
sociétés civiles et qu’on ne peut dire des animaux qu’ils sont « politiques » .
Lorsque Hobbes commence par dire « Aristote range parmi les animaux politiques et sociables » et qu’il
parle ensuite des abeilles, nous pouvons observer qu’il fait une référence explicite au chapitre 2 du livre I des
Politiques d’Aristote, et plus particulièrement au passage sur la « naturalité et l’antériorité de la Cité » (1252 b à
1253 a).
Reprenons, avant de débuter notre analyse, la thèse d’Aristote dont il est question.
Le philosophe grec, en
disant « l’homme est par nature un animal politique » voulait signifier que l’homme est non seulement sociable par
nature car il n’est pas autosuffisant (livre I, chapitre 2, « Genèse de la Cité ») mais que la politique est l’essence de
l’homme, qu’ell e est la caractéristique qui le rend humain.
L’homme s’associe tout d’abord avec la femme, puis ils
fondent une famille et les différentes familles forment un village, une sorte de peuplade qui va peu à peu s’organiser
et former une Cité, seul moyen pour parvenir à la « vie-heureuse ».
La politique, pour l’homme, est donc le fruit d’un
processus naturel inévitable.
Celui qui ne vit pas en politique est un être dégradé, qui va contre sa nature.
L’abeille
ouvrière, tout comme l’homme, est un animal politique, en cela qu’elle fait partie d’un tout organisé pour la survie
de ses membres.
La seule différence qu’établit Aristote entre l’homme et les abeilles (par exemple) sur le plan
politique, est que l’homme dispose de la raison ce qui fait de lui un « animal po litique » au degré le plus élevé.
Tenons -nous en -là pour l’instant en ce qui concerne la thèse d’Aristote.
Hobbes commence donc par dire que selon Aristote, les hommes sont des animaux politiques , ainsi que les
abeilles, les fourmis, et d’autres animaux qui ne disposent pas forcément de « l’usage de la raison ».
L’énumération
opérée par l’auteur (« les hommes, les fourmis, les abeilles et plusieurs autres animaux ») est un processus
réducteur de la thèse d’Aristote, qui tend à nous offusquer, à nous scand aliser en quelques sortes.
Le lecteur se dit
« comment ? L’homme est politique au même titre que l’abeille ?!? ».
Seulement Hobbes ne rentre pas
immédiatement dans le vif du sujet.
Il commence en effet par parler –car ce sont les derniers sujets de
l’énumération- des animaux politiques privés de l’usage de la raison (dans lesquels sont comprises les abeilles et les
fourmis).
On peut penser qu’ainsi, Hobbes met l’homme de côté en tant que l’on sait, même selon Aristote, que
l’homme est pourvu de raison.
Ainsi, les animaux dépourvus de raison ne peuvent se soumettre à « une police » ni établir de contrat, choses
auxquelles la raison aurait pu les enjoindre s’ils en avaient été pourvus.
Cependant, cela ne les empêche pas (« bien
que…ils ne laissent pas ») de v ivre en paix les uns avec les autres ni de tendre vers des buts communs ou de fuir
ensemble une chose qui leur est nuisible.
Ils n’ont pas besoin, pour survivre et vivre en paix les uns avec les autres,
de tiers (lois, « police ») ni de « contrats ».
Cela est rendu possible car « la forme de leur gouvernement » est basée
sur la concordance (« consentement », « concours ») de leurs volontés vers « un même objet ».
Ainsi, les abeilles
fabriquent du miel et les fourmis amassent des vivres dans leur fourmilière : c’est l’instinct, ou comme le dit Hobbes
« les sens et les appétits » qui les poussent à cela.
Ils n’ont pas la volonté au sens d’acte de vouloir, autrement dit , ils
ne disposent pas de la raison.
Leurs volontés sont des choses désirées naturellement.
Hobbes souligne ici les deux
sens que l’on pourrait accorder à la volonté.
De plus, en regard de ce que Hobbes affirmera par la suite, il est
possible d’avancer que cette « seule volonté » est celle du tiers (personne civile) à qui les hommes transfèrent leurs
volontés.
Sans ce tiers, cette volonté unique, il ne peut y avoir de corps politique, de société civile.
C’est pourquoi on
ne peut dire des « assemblées animales » qu’elles sont des sociétés civiles.
Les animaux n’ont pas besoin de se
soumettre à un ti ers car leurs volontés ne vont pas en contradiction les unes avec les autres.
Les animaux de même
espèce ne sont ainsi qu’une multitude et non une unité politique.
C’est pour ces raisons qu’en parlant des assemblées animales, on ne peut pas parler de « sociétés civiles ».
Le fait que cette dernière expression soit en italique mont re que Hobbes tient à souligner, à insister sur ce terme et
sa particularité.
En effet, une société est désignée comme un ensemble d’organisations entre les individus pour
satisfai re leurs besoins.
On pourrait donc dire que les abeilles vivent en société.
Mais une société civile est construite
autour d’un engagement volontaire, délibéré.
N’ayant pas la raison, les abeilles et les autres animaux ne peuvent
donc pas créer de société civile..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse : De cive Le Citoyen, section deuxième, chapitre V, l'Empire de I à IV
- Thomas Hobbes, le Citoyen, chapitre X, § 1 (commentaire)
- Hobbes - Léviathan - chapitre 13 (commentaire): C'est pourquoi tout ce qui est conséquence d'un temps de guerre, où chacun est ennemi de chacun, est aussi conséquence du temps où les hommes vivent sans autre sécurité que celle que leur fournissent leur propre force et leur propre invention
- « 1984 » de George Orwell (première partie, chapitre 1) - commentaire
- Commentaire de la Cyropédie de Xénophon, chapitre VIII