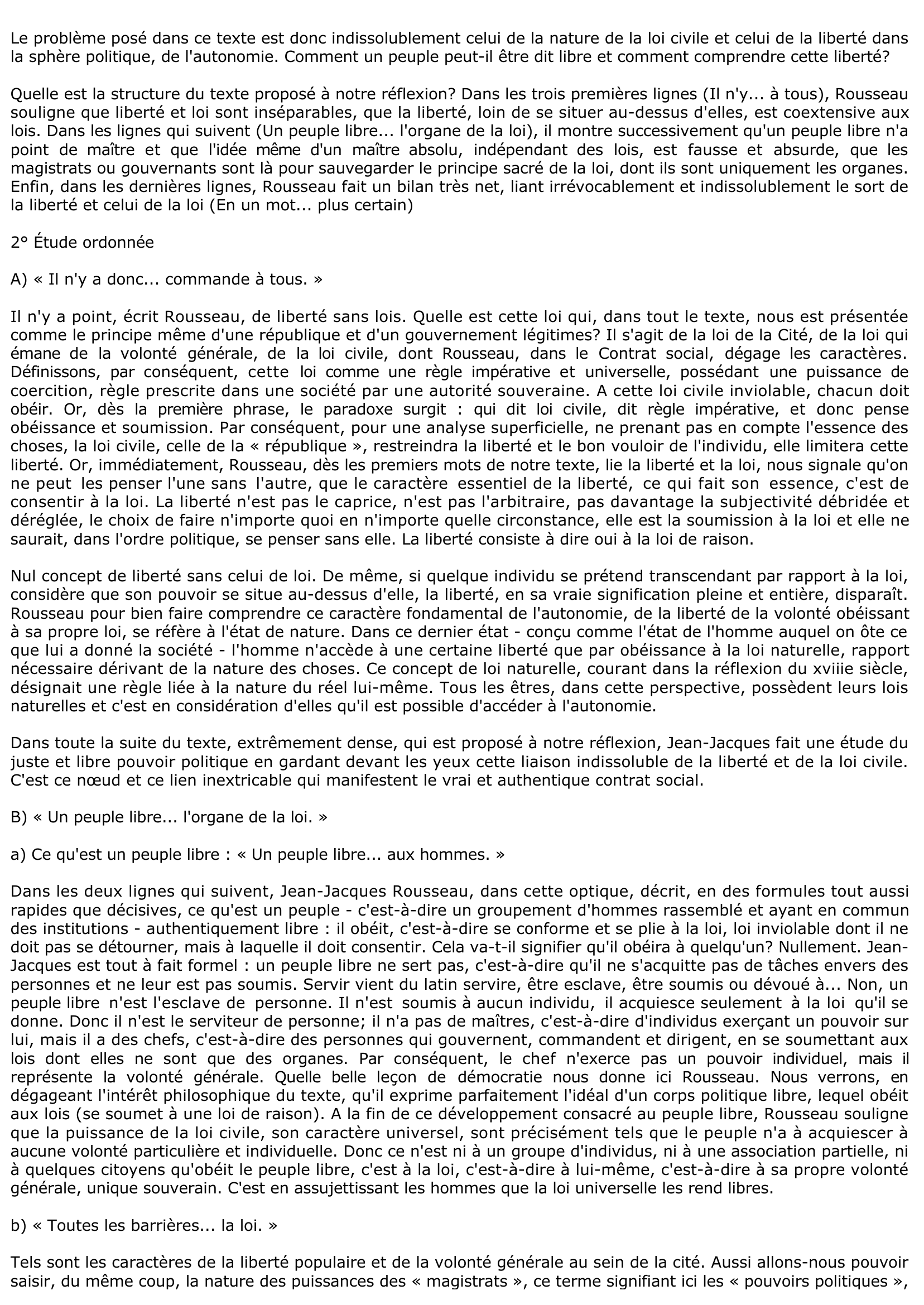Jean-Jacques Rousseau Huitième Lettre de la Montagne
Publié le 11/02/2011

Extrait du document

« Il n'y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu'un est au-dessus des lois : dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas; il a des chefs et non pas des maîtres; il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois : ils en sont les ministres non les arbitres, ils doivent les garder non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'ait son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles; je ne sache rien de plus certain. « Jean-Jacques Rousseau Huitième Lettre de la Montagne.
Voici Vidée générale de ce texte : être libre (politiquement), ce n'est pas agir selon son bon plaisir, mais obéir à la loi et se soumettre à sa toute puissance, toute puissance devant laquelle tout individu, quel qu'il soit, doit s'incliner et que tout gouvernant doit garder et sauvegarder avec le plus grand respect, car il n'est que le serviteur et l'organe de cette loi, il est le gardien de quelque chose qui le dépasse infiniment. Le problème posé dans ce texte est donc indissolublement celui de la nature de la loi civile et celui de la liberté dans la sphère politique, de l'autonomie. Comment un peuple peut-il être dit libre et comment comprendre cette liberté?

«
Le problème posé dans ce texte est donc indissolublement celui de la nature de la loi civile et celui de la liberté dansla sphère politique, de l'autonomie.
Comment un peuple peut-il être dit libre et comment comprendre cette liberté?
Quelle est la structure du texte proposé à notre réflexion? Dans les trois premières lignes (Il n'y...
à tous), Rousseausouligne que liberté et loi sont inséparables, que la liberté, loin de se situer au-dessus d'elles, est coextensive auxlois.
Dans les lignes qui suivent (Un peuple libre...
l'organe de la loi), il montre successivement qu'un peuple libre n'apoint de maître et que l'idée même d'un maître absolu, indépendant des lois, est fausse et absurde, que lesmagistrats ou gouvernants sont là pour sauvegarder le principe sacré de la loi, dont ils sont uniquement les organes.Enfin, dans les dernières lignes, Rousseau fait un bilan très net, liant irrévocablement et indissolublement le sort dela liberté et celui de la loi (En un mot...
plus certain)
2° Étude ordonnée
A) « Il n'y a donc...
commande à tous.
»
Il n'y a point, écrit Rousseau, de liberté sans lois.
Quelle est cette loi qui, dans tout le texte, nous est présentéecomme le principe même d'une république et d'un gouvernement légitimes? Il s'agit de la loi de la Cité, de la loi quiémane de la volonté générale, de la loi civile, dont Rousseau, dans le Contrat social, dégage les caractères.Définissons, par conséquent, cette loi comme une règle impérative et universelle, possédant une puissance decoercition, règle prescrite dans une société par une autorité souveraine.
A cette loi civile inviolable, chacun doitobéir.
Or, dès la première phrase, le paradoxe surgit : qui dit loi civile, dit règle impérative, et donc penseobéissance et soumission.
Par conséquent, pour une analyse superficielle, ne prenant pas en compte l'essence deschoses, la loi civile, celle de la « république », restreindra la liberté et le bon vouloir de l'individu, elle limitera cetteliberté.
Or, immédiatement, Rousseau, dès les premiers mots de notre texte, lie la liberté et la loi, nous signale qu'onne peut les penser l'une sans l'autre, que le caractère essentiel de la liberté, ce qui fait son essence, c'est deconsentir à la loi.
La liberté n'est pas le caprice, n'est pas l'arbitraire, pas davantage la subjectivité débridée etdéréglée, le choix de faire n'importe quoi en n'importe quelle circonstance, elle est la soumission à la loi et elle nesaurait, dans l'ordre politique, se penser sans elle.
La liberté consiste à dire oui à la loi de raison.
Nul concept de liberté sans celui de loi.
De même, si quelque individu se prétend transcendant par rapport à la loi,considère que son pouvoir se situe au-dessus d'elle, la liberté, en sa vraie signification pleine et entière, disparaît.Rousseau pour bien faire comprendre ce caractère fondamental de l'autonomie, de la liberté de la volonté obéissantà sa propre loi, se réfère à l'état de nature.
Dans ce dernier état - conçu comme l'état de l'homme auquel on ôte ceque lui a donné la société - l'homme n'accède à une certaine liberté que par obéissance à la loi naturelle, rapportnécessaire dérivant de la nature des choses.
Ce concept de loi naturelle, courant dans la réflexion du xviiie siècle,désignait une règle liée à la nature du réel lui-même.
Tous les êtres, dans cette perspective, possèdent leurs loisnaturelles et c'est en considération d'elles qu'il est possible d'accéder à l'autonomie.
Dans toute la suite du texte, extrêmement dense, qui est proposé à notre réflexion, Jean-Jacques fait une étude dujuste et libre pouvoir politique en gardant devant les yeux cette liaison indissoluble de la liberté et de la loi civile.C'est ce nœud et ce lien inextricable qui manifestent le vrai et authentique contrat social.
B) « Un peuple libre...
l'organe de la loi.
»
a) Ce qu'est un peuple libre : « Un peuple libre...
aux hommes.
»
Dans les deux lignes qui suivent, Jean-Jacques Rousseau, dans cette optique, décrit, en des formules tout aussirapides que décisives, ce qu'est un peuple - c'est-à-dire un groupement d'hommes rassemblé et ayant en commundes institutions - authentiquement libre : il obéit, c'est-à-dire se conforme et se plie à la loi, loi inviolable dont il nedoit pas se détourner, mais à laquelle il doit consentir.
Cela va-t-il signifier qu'il obéira à quelqu'un? Nullement.
Jean-Jacques est tout à fait formel : un peuple libre ne sert pas, c'est-à-dire qu'il ne s'acquitte pas de tâches envers despersonnes et ne leur est pas soumis.
Servir vient du latin servire, être esclave, être soumis ou dévoué à...
Non, unpeuple libre n'est l'esclave de personne.
Il n'est soumis à aucun individu, il acquiesce seulement à la loi qu'il sedonne.
Donc il n'est le serviteur de personne; il n'a pas de maîtres, c'est-à-dire d'individus exerçant un pouvoir surlui, mais il a des chefs, c'est-à-dire des personnes qui gouvernent, commandent et dirigent, en se soumettant auxlois dont elles ne sont que des organes.
Par conséquent, le chef n'exerce pas un pouvoir individuel, mais ilreprésente la volonté générale.
Quelle belle leçon de démocratie nous donne ici Rousseau.
Nous verrons, endégageant l'intérêt philosophique du texte, qu'il exprime parfaitement l'idéal d'un corps politique libre, lequel obéitaux lois (se soumet à une loi de raison).
A la fin de ce développement consacré au peuple libre, Rousseau souligneque la puissance de la loi civile, son caractère universel, sont précisément tels que le peuple n'a à acquiescer àaucune volonté particulière et individuelle.
Donc ce n'est ni à un groupe d'individus, ni à une association partielle, nià quelques citoyens qu'obéit le peuple libre, c'est à la loi, c'est-à-dire à lui-même, c'est-à-dire à sa propre volontégénérale, unique souverain.
C'est en assujettissant les hommes que la loi universelle les rend libres.
b) « Toutes les barrières...
la loi.
»
Tels sont les caractères de la liberté populaire et de la volonté générale au sein de la cité.
Aussi allons-nous pouvoirsaisir, du même coup, la nature des puissances des « magistrats », ce terme signifiant ici les « pouvoirs politiques »,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jean Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne, Lettre 8
- Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la Montagne, Lettre VIII, Éd. Pléiade.
- LETTRE A D’ALEMBERT SUR LES SPECTACLES Jean-Jacques Rousseau (résumé)
- LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, 1764. Jean-Jacques Rousseau - résumé de l'oeuvre
- Lettre à d Alembert sur les SPECTACLES, par Jean-Jacques Rousseau