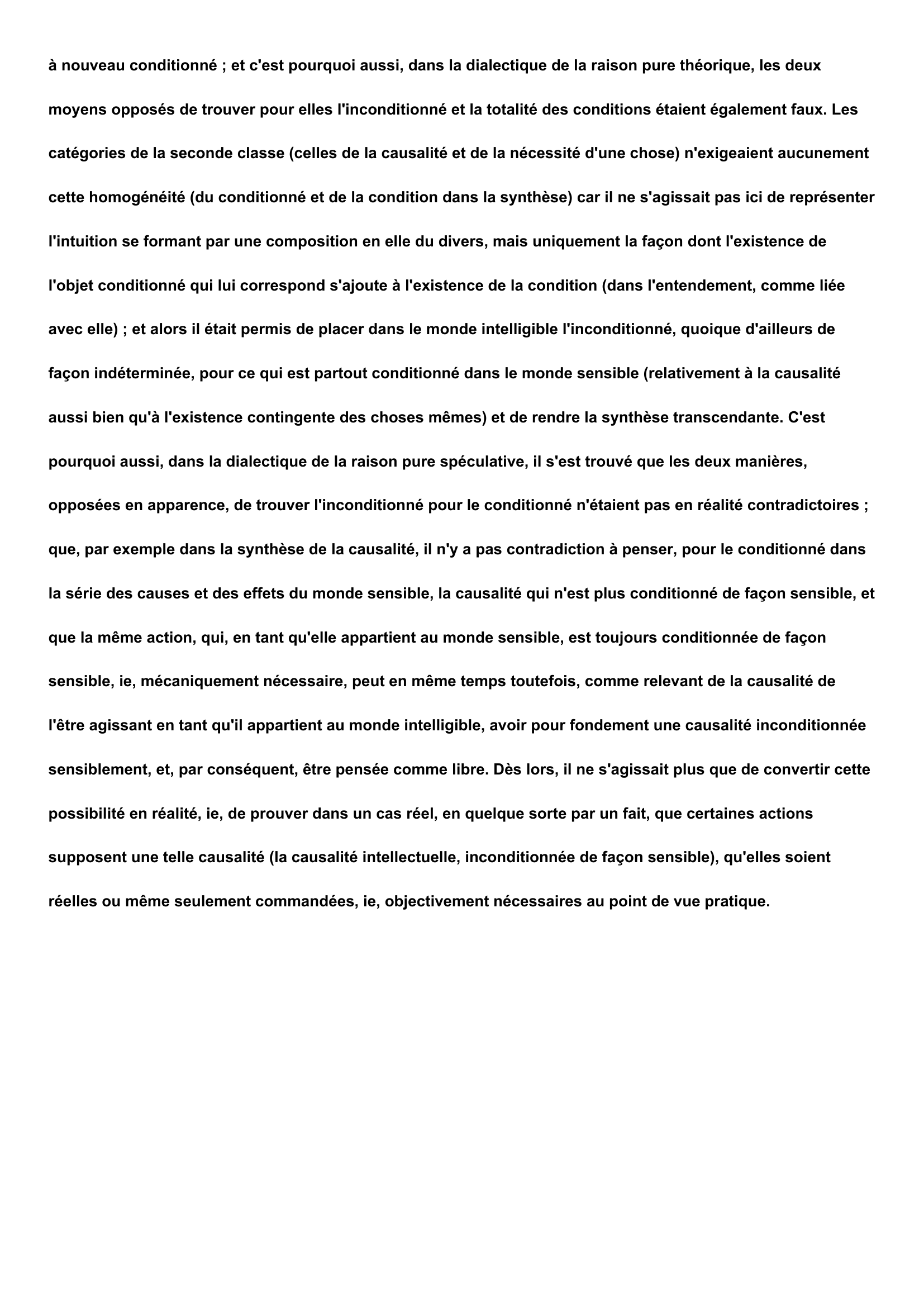KANT
Publié le 15/05/2014

Extrait du document


« à nouveau conditionné ; et c'est pourquoi aussi, dans la dialectique de la raison pure théorique, les deux moyens opposés de trouver pour elles l'inconditionné et la totalité des conditions étaient également faux. Les catégories de la seconde classe (celles de la causalité et de la nécessité d'une chose) n'exigeaient aucunement cette homogénéité (du conditionné et de la condition dans la synthèse) car il ne s'agissait pas ici de représenter l'intuition se formant par une composition en elle du divers, mais uniquement la façon dont l'existence de l'objet conditionné qui lui correspond s'ajoute à l'existence de la condition (dans l'entendement, comme liée avec elle) ; et alors il était permis de placer dans le monde intelligible l'inconditionné, quoique d'ailleurs de façon indéterminée, pour ce qui est partout conditionné dans le monde sensible (relativement à la causalité aussi bien qu'à l'existence contingente des choses mêmes) et de rendre la synthèse transcendante. C'est pourquoi aussi, dans la dialectique de la raison pure spéculative, il s'est trouvé que les deux manières, opposées en apparence, de trouver l'inconditionné pour le conditionné n'étaient pas en réalité contradictoires ; que, par exemple dans la synthèse de la causalité, il n'y a pas contradiction à penser, pour le conditionné dans la série des causes et des effets du monde sensible, la causalité qui n'est plus conditionné de façon sensible, et que la même action, qui, en tant qu'elle appartient au monde sensible, est toujours conditionnée de façon sensible, ie, mécaniquement nécessaire, peut en même temps toutefois, comme relevant de la causalité de l'être agissant en tant qu'il appartient au monde intelligible, avoir pour fondement une causalité inconditionnée sensiblement, et, par conséquent, être pensée comme libre. Dès lors, il ne s'agissait plus que de convertir cette possibilité en réalité, ie, de prouver dans un cas réel, en quelque sorte par un fait, que certaines actions supposent une telle causalité (la causalité intellectuelle, inconditionnée de façon sensible), qu'elles soient réelles ou même seulement commandées, ie, objectivement nécessaires au point de vue pratique.. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- → Support : Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 1785
- Kant, Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ?
- Je dus abolir le savoir afin d'obtenir une place pour la croyance Emmanuel Kant (1724-1804)