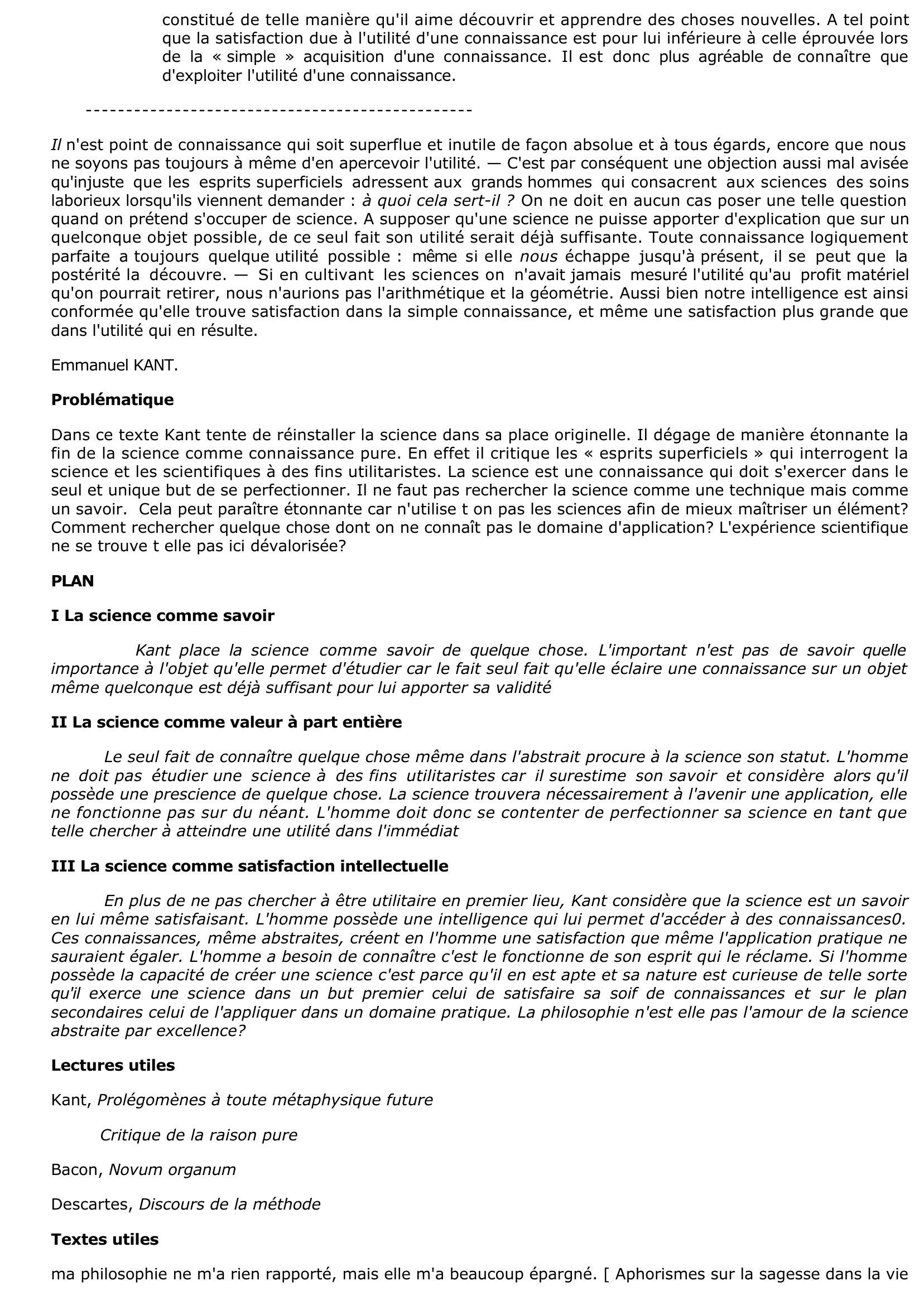Kant: y a-t-il des connaissances superflues ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document

Emmanuel Kant est un philosophe allemand du XVIIIe siècle qui a fait de la connaissance son principal objet d’étude. Il s’est entre autres interrogé sur le rapport de celle-ci à l’utile. Il développe la thèse selon laquelle toute connaissance est utile bien que cette utilité ne soit pas toujours immédiatement perceptible. On entend pourtant fréquemment dire, à propos d’une connaissance, « à quoi cela sert-il ? «. On peut alors se demander, avec Kant : quelle est la validité de cette question ? Comment le scientifique, au sens large du terme (celui qui cherche la connaissance, manipule et/ou transmet la connaissance), doit-il penser le rapport de la connaissance à l’utile ?

«
constitué de telle manière qu'il aime découvrir et apprendre des choses nouvelles.
A tel pointque la satisfaction due à l'utilité d'une connaissance est pour lui inférieure à celle éprouvée lorsde la « simple » acquisition d'une connaissance.
Il est donc plus agréable de connaître qued'exploiter l'utilité d'une connaissance.
------------------------------------------------
Il n'est point de connaissance qui soit superflue et inutile de façon absolue et à tous égards, encore que nousne soyons pas toujours à même d'en apercevoir l'utilité.
— C'est par conséquent une objection aussi mal aviséequ'injuste que les esprits superficiels adressent aux grands hommes qui consacrent aux sciences des soinslaborieux lorsqu'ils viennent demander : à quoi cela sert-il ? On ne doit en aucun cas poser une telle question quand on prétend s'occuper de science.
A supposer qu'une science ne puisse apporter d'explication que sur unquelconque objet possible, de ce seul fait son utilité serait déjà suffisante.
Toute connaissance logiquementparfaite a toujours quelque utilité possible : même si elle nous échappe jusqu'à présent, il se peut que la postérité la découvre.
— Si en cultivant les sciences on n'avait jamais mesuré l'utilité qu'au profit matérielqu'on pourrait retirer, nous n'aurions pas l'arithmétique et la géométrie.
Aussi bien notre intelligence est ainsiconformée qu'elle trouve satisfaction dans la simple connaissance, et même une satisfaction plus grande quedans l'utilité qui en résulte.
Emmanuel KANT.
Problématique
Dans ce texte Kant tente de réinstaller la science dans sa place originelle.
Il dégage de manière étonnante lafin de la science comme connaissance pure.
En effet il critique les « esprits superficiels » qui interrogent lascience et les scientifiques à des fins utilitaristes.
La science est une connaissance qui doit s'exercer dans leseul et unique but de se perfectionner.
Il ne faut pas rechercher la science comme une technique mais commeun savoir.
Cela peut paraître étonnante car n'utilise t on pas les sciences afin de mieux maîtriser un élément?Comment rechercher quelque chose dont on ne connaît pas le domaine d'application? L'expérience scientifiquene se trouve t elle pas ici dévalorisée?
PLAN
I La science comme savoir
Kant place la science comme savoir de quelque chose.
L'important n'est pas de savoir quelle importance à l'objet qu'elle permet d'étudier car le fait seul fait qu'elle éclaire une connaissance sur un objetmême quelconque est déjà suffisant pour lui apporter sa validité
II La science comme valeur à part entière
Le seul fait de connaître quelque chose même dans l'abstrait procure à la science son statut.
L'homme ne doit pas étudier une science à des fins utilitaristes car il surestime son savoir et considère alors qu'ilpossède une prescience de quelque chose.
La science trouvera nécessairement à l'avenir une application, ellene fonctionne pas sur du néant.
L'homme doit donc se contenter de perfectionner sa science en tant quetelle chercher à atteindre une utilité dans l'immédiat
III La science comme satisfaction intellectuelle
En plus de ne pas chercher à être utilitaire en premier lieu, Kant considère que la science est un savoir en lui même satisfaisant.
L'homme possède une intelligence qui lui permet d'accéder à des connaissances0.Ces connaissances, même abstraites, créent en l'homme une satisfaction que même l'application pratique nesauraient égaler.
L'homme a besoin de connaître c'est le fonctionne de son esprit qui le réclame.
Si l'hommepossède la capacité de créer une science c'est parce qu'il en est apte et sa nature est curieuse de telle sortequ'il exerce une science dans un but premier celui de satisfaire sa soif de connaissances et sur le plansecondaires celui de l'appliquer dans un domaine pratique.
La philosophie n'est elle pas l'amour de la scienceabstraite par excellence?
Lectures utiles
Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future
Critique de la raison pure
Bacon, Novum organum
Descartes, Discours de la méthode
Textes utiles
ma philosophie ne m'a rien rapporté, mais elle m'a beaucoup épargné.
[ Aphorismes sur la sagesse dans la vie.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La raison humaine est soumise, dans une partie de ses connaissances, à cette condition singulière qu'elle ne peut éviter certaines questions et qu'elle en est accablée. Elles lui sont suggérées par sa nature même, mais elles ne sauraient les résoudre, parce qu'elles dépassent sa portée. » Kant, Critique de la raison pure, 1781. Commentez.
- « Aucune connaissance ne précède donc en nous, dans le temps, l'expérience et toutes commencent avec elle. Mais, si toutes nos connaissances commencent avec l'expérience, il n'en résulte pas qu'elles dérivent toutes de l'expérience. » Kant, Critique de la raison pure, 1781. Commentez. ?
- ... chez tous les hommes les conditions subjectives de la faculté de juger sont les mêmes ... car sinon les hommes ne pourraient pas se communiquer leurs représentations et leurs connaissances. [ ] Kant, Emmanuel. Commentez cette citation.
- La faculté de penser de l'âme doit contenir les principes réels de toutes ses pensées, et les phénomènes de connaissances qui apparaissent et disparaissent doivent être attribués, suivant toute apparence, à l'accord ou à l'opposition de toute cette activité. Kant, Essai pour introduire en Philosophie le concept de grandeur négative. Vrin, page 55. Commentez cette citation.
- ... chez tous les hommes les conditions subjectives de la faculté de juger sont les mêmes ... car sinon les hommes ne pourraient pas se communiquer leurs représentations et leurs connaissances. Kant, Emmanuel. Commentez cette citation.