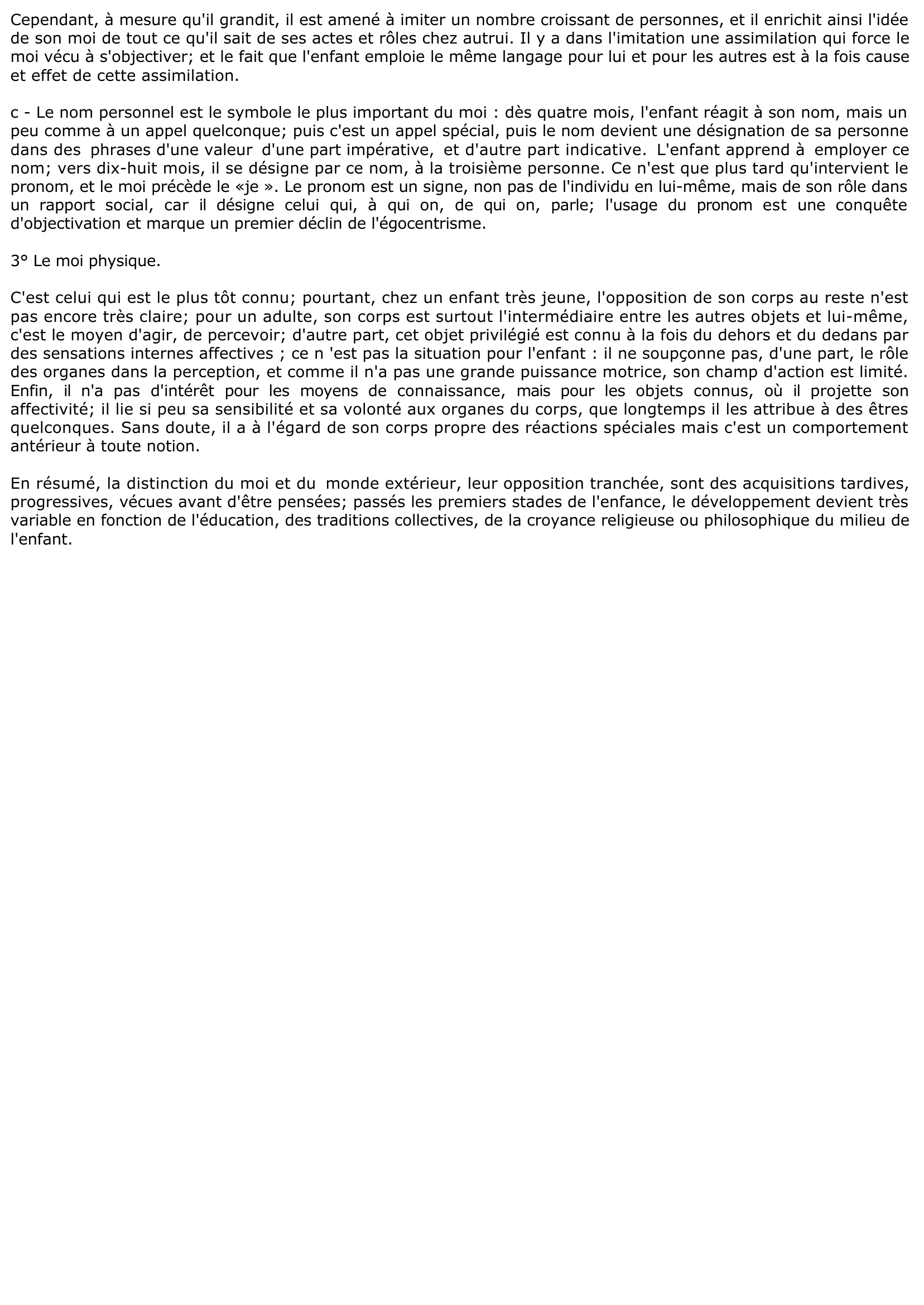LA CONSCIENCE DE SOI ET SON DÉVELOPPEMENT
Publié le 15/03/2011

Extrait du document

A) C'est l'aspect subjectif, intime de la personnalité Le sujet se connaît et se désigne par les mots : je, moi. 1° Analyse. Cette conscience n'est peut-être pas continue, mais toujours présente au premier plan, ou à l'arrière-plan, surtout dans les retours sur soi-même, où l'on pense expressément à soi; il y a une sorte de dédoublement : un moi vu, un moi objet, et un moi-sujet qui voit. Le moi sujet, c'est le « je « et nous le connaissons par une conscience de l'ordre du vécu, ne devenant connaissance que si ce «je « sujet est transformé en « moi «, pensé et objectivé, si bien qu'en toute rigueur, on ne peut pas dire qu'il y a connaissance du «je «.

«
Cependant, à mesure qu'il grandit, il est amené à imiter un nombre croissant de personnes, et il enrichit ainsi l'idéede son moi de tout ce qu'il sait de ses actes et rôles chez autrui.
Il y a dans l'imitation une assimilation qui force lemoi vécu à s'objectiver; et le fait que l'enfant emploie le même langage pour lui et pour les autres est à la fois causeet effet de cette assimilation.
c - Le nom personnel est le symbole le plus important du moi : dès quatre mois, l'enfant réagit à son nom, mais unpeu comme à un appel quelconque; puis c'est un appel spécial, puis le nom devient une désignation de sa personnedans des phrases d'une valeur d'une part impérative, et d'autre part indicative.
L'enfant apprend à employer cenom; vers dix-huit mois, il se désigne par ce nom, à la troisième personne.
Ce n'est que plus tard qu'intervient lepronom, et le moi précède le «je ».
Le pronom est un signe, non pas de l'individu en lui-même, mais de son rôle dansun rapport social, car il désigne celui qui, à qui on, de qui on, parle; l'usage du pronom est une conquêted'objectivation et marque un premier déclin de l'égocentrisme.
3° Le moi physique.
C'est celui qui est le plus tôt connu; pourtant, chez un enfant très jeune, l'opposition de son corps au reste n'estpas encore très claire; pour un adulte, son corps est surtout l'intermédiaire entre les autres objets et lui-même,c'est le moyen d'agir, de percevoir; d'autre part, cet objet privilégié est connu à la fois du dehors et du dedans pardes sensations internes affectives ; ce n 'est pas la situation pour l'enfant : il ne soupçonne pas, d'une part, le rôledes organes dans la perception, et comme il n'a pas une grande puissance motrice, son champ d'action est limité.Enfin, il n'a pas d'intérêt pour les moyens de connaissance, mais pour les objets connus, où il projette sonaffectivité; il lie si peu sa sensibilité et sa volonté aux organes du corps, que longtemps il les attribue à des êtresquelconques.
Sans doute, il a à l'égard de son corps propre des réactions spéciales mais c'est un comportementantérieur à toute notion.
En résumé, la distinction du moi et du monde extérieur, leur opposition tranchée, sont des acquisitions tardives,progressives, vécues avant d'être pensées; passés les premiers stades de l'enfance, le développement devient trèsvariable en fonction de l'éducation, des traditions collectives, de la croyance religieuse ou philosophique du milieu del'enfant..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Un universitaire contemporain, Jean Onimus, réfléchissant sur l'étude de la littérature, écrit : « L'inquiétude c'est la vie même de la conscience. Toute vie suppose effort, dépense de forces. Ce que cherchent les élèves trop souvent, c'est une réponse de catéchisme : "ce qu'il faut penser de..." et, dans leurs devoirs, ce qu'ils disent c'est ce qu'ils croient que l'on doit dire. Or le principe de l'enseignement littéraire est de leur faire admettre qu'il n'y a pas de dogme tout fait e
- Un universitaire contemporain réfléchissant sur l'étude de la littérature écrit : « L'inquiétude c'est la vie même de la conscience. Toute vie suppose effort, dépense de force. Ce que cherchent des élèves, trop souvent, c'est une réponse de catéchisme « ce qu'il faut penser de... » et dans leurs devoirs ce qu'ils disent c'est ce qu'ils croient que l'on doit dire. Or le principe de l'enseignement littéraire est de leur faire admettre qu'il n'y a pas de dogme tout fait et qu'à chacun sa
- Marx " Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. " (Marx, Contribution à la critique de l'économie politique, 1859, Avant-propos, trad. Rubel, Gallimard, Folio/Essais, 1994, p. 488). Commentez cette citation.
- La conscience de soi rend-elle libre ? (Corrigé) Problématisation
- Sujet : Comparez les approches intégration des femmes au développement (IFD) et Genre et Développement (GED) et dites sur quoi se fondent leurs différences au plan idéologique et ce que vous inspire vos expériences professionnelles ou de terrain.