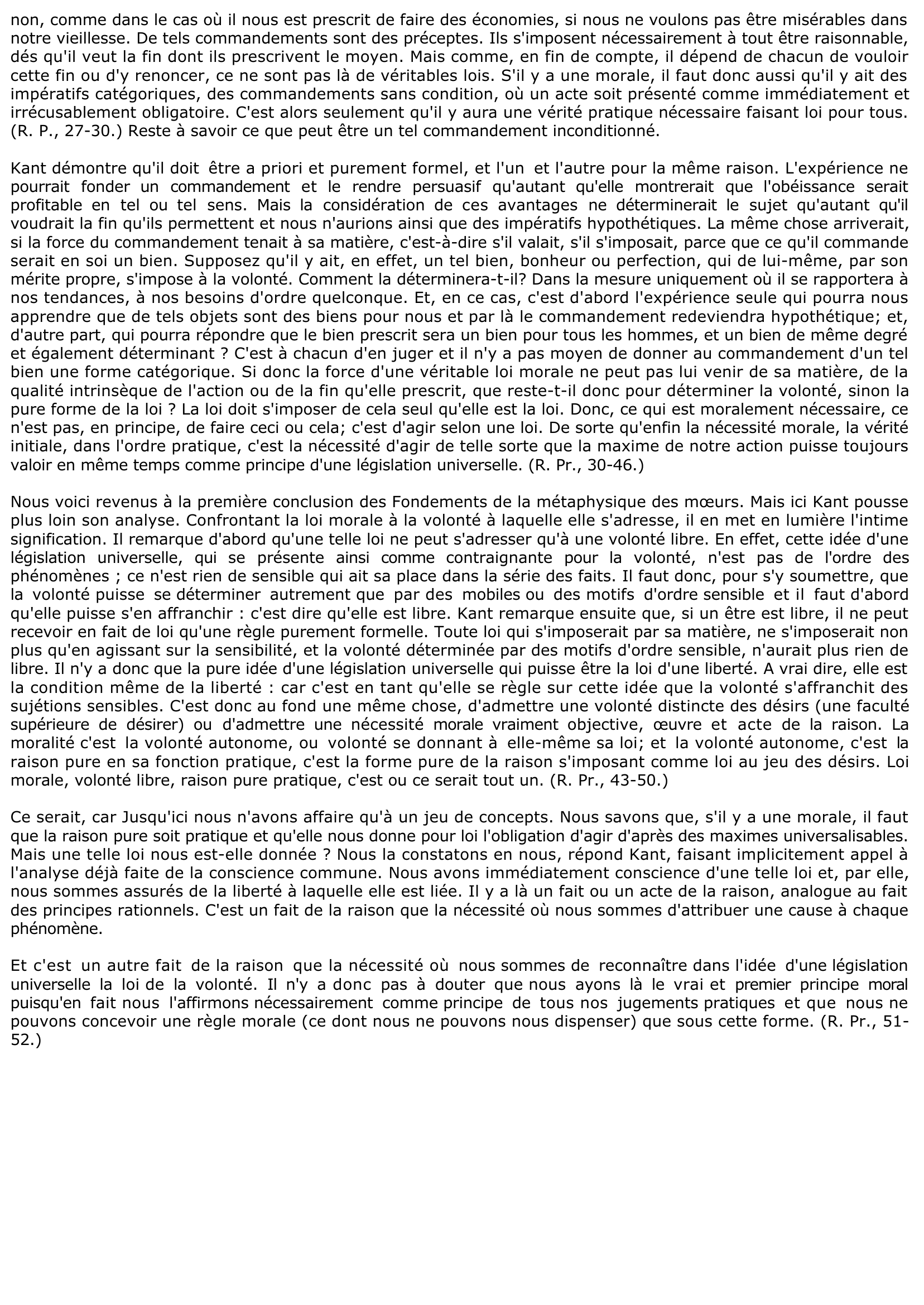La détermination (ou déduction métaphysique) du principe moral - KANT
Publié le 21/03/2011

Extrait du document

Par sa nature même, un principe rationnel ne peut jamais être déterminé que par analyse. On ne le construit pas, on le retrouve. Cette analyse, Kant l'a opérée de deux façons. Dans la première section des Fondements de la métaphysique des mœurs, il la fait porter sur les jugements de la conscience commune pour remonter au principe implicite sur lequel ils se règlent. Dans le chapitre premier de la Critique de la raison pratique, ce que Kant analyse c'est la fonction ou la puissance pratiqua de la raison. Dans le premier cas, il va des conséquences au principe ; dans le second, il va du tout — à savoir de la raison pratique — à la partie, c'est-à-dire à la raison pure pratique. Dans les deux cas c'est la même donnée fondamentale qu'il arrive à mettre en lumière.

«
non, comme dans le cas où il nous est prescrit de faire des économies, si nous ne voulons pas être misérables dansnotre vieillesse.
De tels commandements sont des préceptes.
Ils s'imposent nécessairement à tout être raisonnable,dés qu'il veut la fin dont ils prescrivent le moyen.
Mais comme, en fin de compte, il dépend de chacun de vouloircette fin ou d'y renoncer, ce ne sont pas là de véritables lois.
S'il y a une morale, il faut donc aussi qu'il y ait desimpératifs catégoriques, des commandements sans condition, où un acte soit présenté comme immédiatement etirrécusablement obligatoire.
C'est alors seulement qu'il y aura une vérité pratique nécessaire faisant loi pour tous.(R.
P., 27-30.) Reste à savoir ce que peut être un tel commandement inconditionné.
Kant démontre qu'il doit être a priori et purement formel, et l'un et l'autre pour la même raison.
L'expérience nepourrait fonder un commandement et le rendre persuasif qu'autant qu'elle montrerait que l'obéissance seraitprofitable en tel ou tel sens.
Mais la considération de ces avantages ne déterminerait le sujet qu'autant qu'ilvoudrait la fin qu'ils permettent et nous n'aurions ainsi que des impératifs hypothétiques.
La même chose arriverait,si la force du commandement tenait à sa matière, c'est-à-dire s'il valait, s'il s'imposait, parce que ce qu'il commandeserait en soi un bien.
Supposez qu'il y ait, en effet, un tel bien, bonheur ou perfection, qui de lui-même, par sonmérite propre, s'impose à la volonté.
Comment la déterminera-t-il? Dans la mesure uniquement où il se rapportera ànos tendances, à nos besoins d'ordre quelconque.
Et, en ce cas, c'est d'abord l'expérience seule qui pourra nousapprendre que de tels objets sont des biens pour nous et par là le commandement redeviendra hypothétique; et,d'autre part, qui pourra répondre que le bien prescrit sera un bien pour tous les hommes, et un bien de même degréet également déterminant ? C'est à chacun d'en juger et il n'y a pas moyen de donner au commandement d'un telbien une forme catégorique.
Si donc la force d'une véritable loi morale ne peut pas lui venir de sa matière, de laqualité intrinsèque de l'action ou de la fin qu'elle prescrit, que reste-t-il donc pour déterminer la volonté, sinon lapure forme de la loi ? La loi doit s'imposer de cela seul qu'elle est la loi.
Donc, ce qui est moralement nécessaire, cen'est pas, en principe, de faire ceci ou cela; c'est d'agir selon une loi.
De sorte qu'enfin la nécessité morale, la véritéinitiale, dans l'ordre pratique, c'est la nécessité d'agir de telle sorte que la maxime de notre action puisse toujoursvaloir en même temps comme principe d'une législation universelle.
(R.
Pr., 30-46.)
Nous voici revenus à la première conclusion des Fondements de la métaphysique des mœurs.
Mais ici Kant pousseplus loin son analyse.
Confrontant la loi morale à la volonté à laquelle elle s'adresse, il en met en lumière l'intimesignification.
Il remarque d'abord qu'une telle loi ne peut s'adresser qu'à une volonté libre.
En effet, cette idée d'unelégislation universelle, qui se présente ainsi comme contraignante pour la volonté, n'est pas de l'ordre desphénomènes ; ce n'est rien de sensible qui ait sa place dans la série des faits.
Il faut donc, pour s'y soumettre, quela volonté puisse se déterminer autrement que par des mobiles ou des motifs d'ordre sensible et il faut d'abordqu'elle puisse s'en affranchir : c'est dire qu'elle est libre.
Kant remarque ensuite que, si un être est libre, il ne peutrecevoir en fait de loi qu'une règle purement formelle.
Toute loi qui s'imposerait par sa matière, ne s'imposerait nonplus qu'en agissant sur la sensibilité, et la volonté déterminée par des motifs d'ordre sensible, n'aurait plus rien delibre.
Il n'y a donc que la pure idée d'une législation universelle qui puisse être la loi d'une liberté.
A vrai dire, elle estla condition même de la liberté : car c'est en tant qu'elle se règle sur cette idée que la volonté s'affranchit dessujétions sensibles.
C'est donc au fond une même chose, d'admettre une volonté distincte des désirs (une facultésupérieure de désirer) ou d'admettre une nécessité morale vraiment objective, œuvre et acte de la raison.
Lamoralité c'est la volonté autonome, ou volonté se donnant à elle-même sa loi; et la volonté autonome, c'est laraison pure en sa fonction pratique, c'est la forme pure de la raison s'imposant comme loi au jeu des désirs.
Loimorale, volonté libre, raison pure pratique, c'est ou ce serait tout un.
(R.
Pr., 43-50.)
Ce serait, car Jusqu'ici nous n'avons affaire qu'à un jeu de concepts.
Nous savons que, s'il y a une morale, il fautque la raison pure soit pratique et qu'elle nous donne pour loi l'obligation d'agir d'après des maximes universalisables.Mais une telle loi nous est-elle donnée ? Nous la constatons en nous, répond Kant, faisant implicitement appel àl'analyse déjà faite de la conscience commune.
Nous avons immédiatement conscience d'une telle loi et, par elle,nous sommes assurés de la liberté à laquelle elle est liée.
Il y a là un fait ou un acte de la raison, analogue au faitdes principes rationnels.
C'est un fait de la raison que la nécessité où nous sommes d'attribuer une cause à chaquephénomène.
Et c'est un autre fait de la raison que la nécessité où nous sommes de reconnaître dans l'idée d'une législationuniverselle la loi de la volonté.
Il n'y a donc pas à douter que nous ayons là le vrai et premier principe moralpuisqu'en fait nous l'affirmons nécessairement comme principe de tous nos jugements pratiques et que nous nepouvons concevoir une règle morale (ce dont nous ne pouvons nous dispenser) que sous cette forme.
(R.
Pr., 51-52.).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Justification (ou déduction transcendantale) du principe moral — KANT (critique de la raison pratique)
- Kant et le principe moral du devoir
- Les règles pratiques et l'idéal moral : préparation de la métaphysique des mœurs. — KANT
- KANT: le principe moral du devoir
- → Support : Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 1785