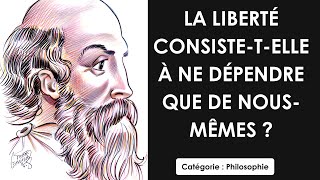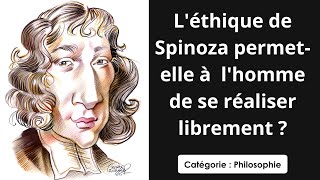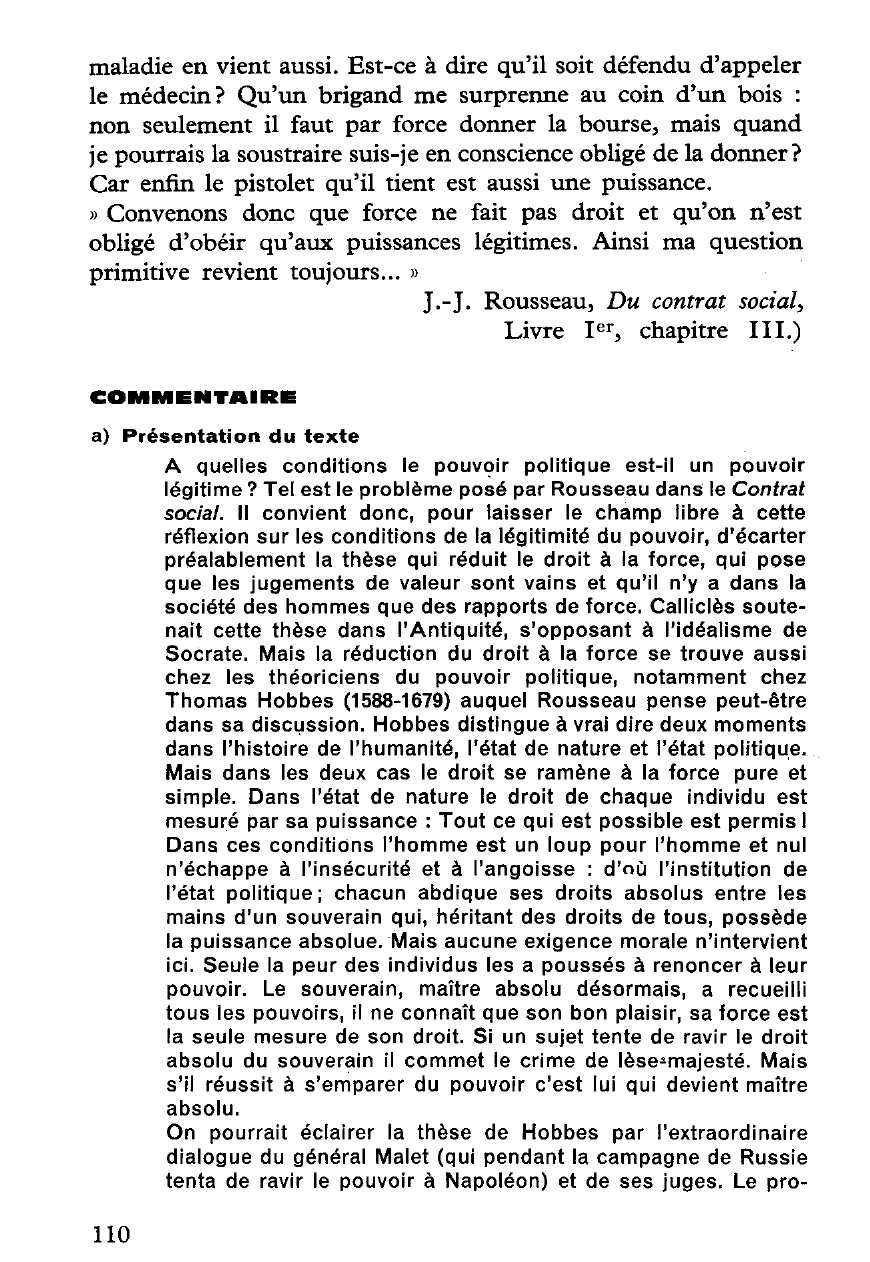LA FORCE ET LE DROIT
Publié le 24/03/2015
Extrait du document


«
maladie en vient aussi.
Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler
le médecin? Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois :
non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand
je pourrais la soustraire suis-je en conscience obligé de la donner?
Car enfin le pistolet qu'il tient est aussi une puissance.
" Convenons donc que force ne fait pas droit et qu'on n'est
obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes.
Ainsi ma question
primitive revient toujours ...
"
J .-J.
Rousseau, Du contrat social,
Livre Jer, chapitre Ill.)
COMMENTAIRE
a) Présentation du texte
110
A quelles conditions le pouvoir politique est-il un pouvoir légitime? Tel est le problème posé par Rousseau dans le Contrat
social.
Il convient donc, pour laisser le champ libre à cette
réflexion sur les conditions de la légitimité du pouvoir, d'écarter préalablement la thèse qui réduit le droit à la force, qui pose
que les jugements de valeur sont vains et qu'il n'y a dans la société des hommes que des rapports de force.
Calliclès soute nait cette thèse dans !'Antiquité, s'opposant à l'idéalisme de Socrate.
Mais la réduction du droit à la force se trouve aussi
chez les théoriciens du pouvoir politique, notamment chez Thomas Hobbes (1588-1679) auquel Rousseau pense peut-être
dans sa diSCIJSSion.
Hobbes distingue à vrai dire deux moments dans l'histoire de l'humanité, l'état de nature et l'état politiqu,e.
Mais dans les deux cas le droit se ramène à la force pure et simple.
Dans l'état de nature le droit de chaque individu est mesuré par sa puissance : Tout ce qui est possible est permis 1 Dans ces conditions l'homme est un loup pour l'homme et nul
n'échappe à l'insécurité et à l'angoisse : d'où l'institution de l'état politique; chacun abdique ses droits absolus entre les mains d'un souverain qui, héritant des droits de tous, possède la puissance absolue.
Mais aucune exigence morale n'intervient ici.
Seule la peur des individus les a poussés à renoncer à leur pouvoir.
Le souverain, maître absolu désormais, a recueilli tous les pouvoirs, il ne connaît que son bon plaisir, sa force est la seule mesure de son droit.
Si un sujet tente de ravir le droit absolu du souverain il commet le crime de lèse•majesté.
Mais s'il réussit à s'emparer du pouvoir c'est lui qui devient maître
absolu.
On pourrait éclairer la thèse de Hobbes par l'extraordinaire dialogue du général Malet (qui pendant la campagne de Russie
tenta de ravir le pouvoir à Napoléon) et de ses juges.
Le pro-
.
'
..
..
•
•
• ..
• •
..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- De manière traditionnelle le droit constitutionnel a pour objet l’Etat et la Constitution. Pourquoi ?
- Révision DIE DUE PARTIE I - les caractéristiques du droit de l’UE
- Droit public des biens - Commentaire d’arrêt Conseil d'Etat, 18 septembre 2015, société Prest’Air req. N° 387315
- Droit et marché du travail
- Le droit est-il toujours juste ?