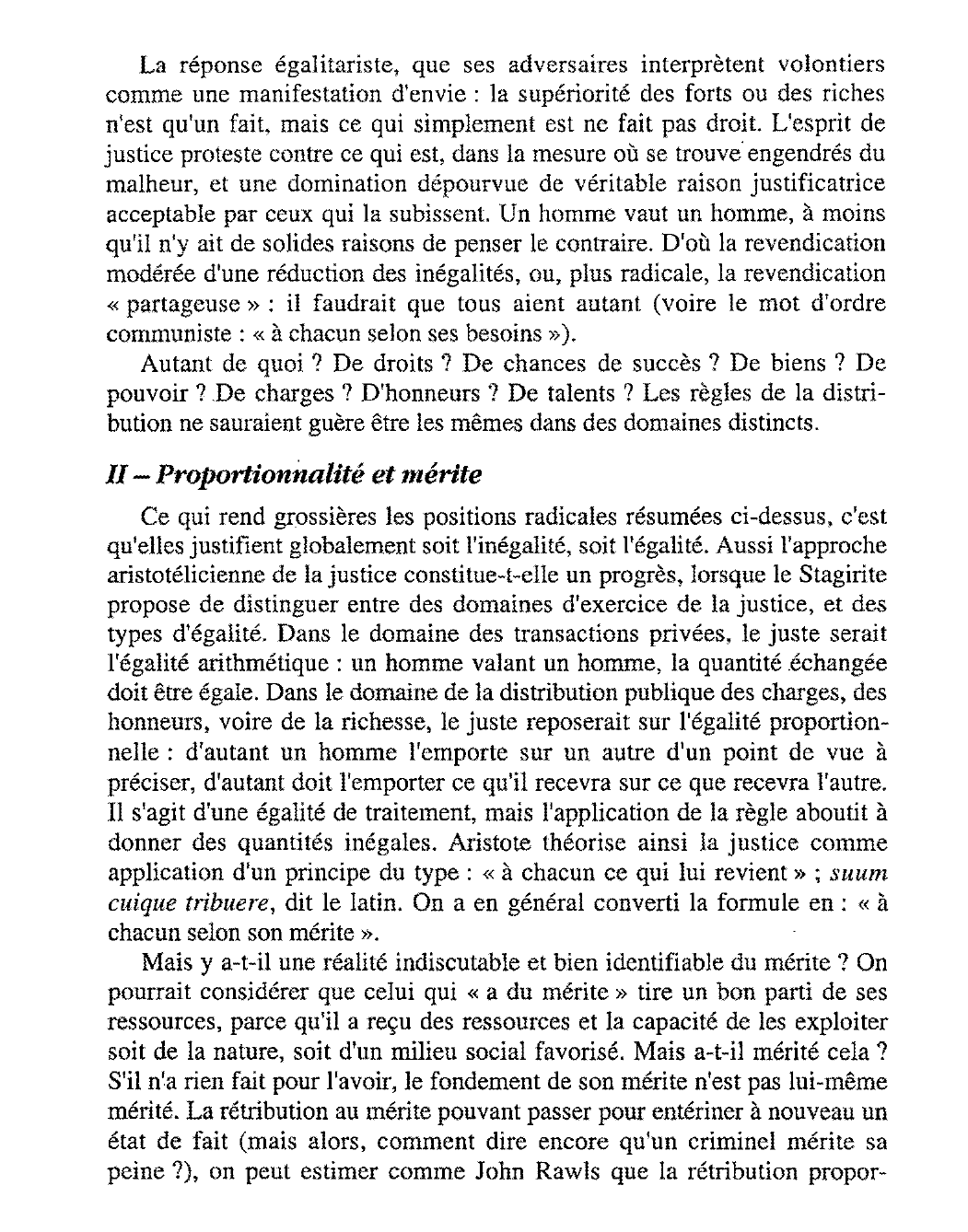La justice est-elle une pratique égalitaire ?
Publié le 01/02/2020

Extrait du document

PLAN
Introduction : divergences, consensus I - Aristocratisme et égalitarisme Il - Proportionnalité et mérite III - La distribution en question Conclusion : la part de l'égalité

«
54 La justice
La réponse égalitariste, que ses adversaires interprètent volontiers
comme une manifestation d'envie : la supériorité des forts ou des riches
n'est qu'un fait, mais ce qui simplement est ne fait pas droit.
L'esprit de
justice proteste contre ce qui est, dans la mesure où se trouve· engendrés du
malheur, et une domination dépourvue de véritable raison justificatrice
acceptable par ceux qui la subissent.
Un homme vaut un homme, à moins
qu'il n'y ait de solides raisons de penser le contraire.
D'où la revendication
modérée d'une réduction des inégalités, ou, plus radicale, la revendication
«partageuse» : il faudrait que tous aient autant (voire le mot d'ordre
communiste : « à chacun selon ses besoins » ).
Autant de quoi ? De droits ? De chances de succès ? De biens ? De
pouvoir ? De charges ? D'honneurs ? De talents ? Les règles de la distri
bution ne sauraient guère être les mêmes dans des domaines distincts.
II -Proportionnalité et mérite
Ce qui rend grossières les positions radicales résumées ci-dessus, c'est
qu'elles justifient globalement soit l'inégalité, soit l'égalité.
Aussi l'approche
aristotélicienne de la justice constitue-t-elle un progrès, lorsque le Stagirite
propose de distinguer entre des domaines d'exercice de la justice, et des
types d'égalité.
Dans le domaine des transactions privées, le juste serait
l'égalité arithmétique : un homme valant un homme, la quantité .échangée
doit être égale.
Dans le domaine de la distribution publique des charges, des
honneurs, voire de la richesse, le juste reposerait sur l'égalité proportion
nelle : d'autant un homme l'emporte sur un autre d'un point de vue à
préciser, d'autant doit l'emporter ce qu'il recevra sur ce que recevra l'autre.
Il s'agit d'une égalité de traitement, mais l'application de la règle aboutit à
donner des quantités inégales.
Aristote théorise ainsi la justice comme
application d'un principe du type : « à chacun ce qui lui revient » ; suum
cuique tribuere, dit le latin.
On a en général converti la formule en : « à
chacun selon son mérite».
Mais y a-t-il une réalité indiscutable et bien identifiable du mérite ? On
pourrait considérer que celui qui « a du mérite » tire un bon parti de ses
ressources, parce qu'il a reçu des ressources et la capacité de les exploiter
soit de la nature, soit d'un milieu social favorisé.
Mais a-t-il mérité cela ?
S'il n'a rien fait pour l'avoir, le fondement de son mérite n'est pas lui-même
mérité.
La rétribution au mérite pouvant passer pour entériner à nouveau un
état de fait (mais alors, comment dire encore qu'un criminel mérite sa
peine ?), on peut estimer comme John Rawls que la rétribution propor-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La justice est-elle une pratique égalitaire ?
- Entre la justice et ma mère, je préfère ma mère - Camus
- les inégalités sont elles compatibles avec la notion de justice sociale?
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- En quoi une pratique sportive permet-elle de réduire le stress ?