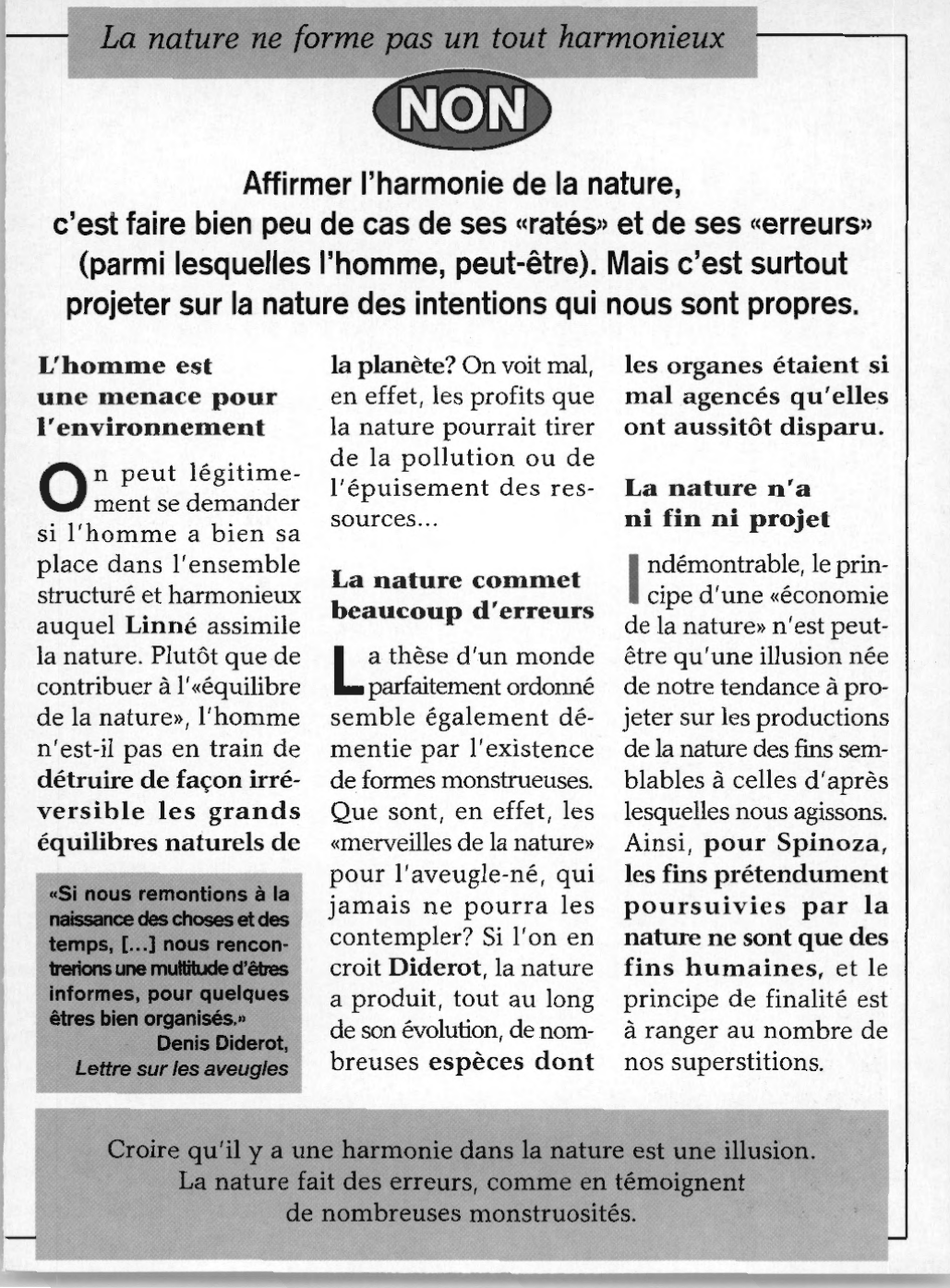La nature forme-t-elle un tout harmonieux ?
Publié le 08/03/2004

Extrait du document
«
H La.
nature ne forme TJllS un tout harmonieux
•U·H•
Affirmer l'harmonie de la nature,
c'est faire bien peu de cas de ses ccratés» et de ses ((erreurs»
(parmi lesquelles l'homme, peut-être).
Mais c'est surtout
projeter sur
la nature des intentions qui nous sont propres.
L'homme est la planète? On voit mal, les organes étaient si
une menace pour en effet, l es profits que mal agencés qu'elles
l'environnement la nature pourrait tirer ont aussitôt disparu.
on peut légitim e- de la pollution ou de
ment se demander l 'épuisement des res- La nature n 'a
si l
'homme a bien sa sources ...
ni fin ni projet
place dans l'ensemble La nature commet 1 ndémontrable , le prin-
structuré
et harm onieux beaucoup d'erreurs cipe d' une «économie
auquel Linné assimi le de la nature» n'est peut-
l a nature.
Plutôt
que de La thèse d'un monde être qu'une illusion née
con tribu
er à !'«équilibre parfaitement ordonné de notre tendance à pro-
de la nature», l'homm e semble également dé- jeter sur les productions
n'est-il
pas en train de mentie par l 'existence de la natur e des fins sem-
détruire de façon irré- de formes monstrueuses.
blables à celles d'après
versib le le s grands Que sont , en effet , les lesquelles nous agissons.
éq uilibres naturels de «merveilles de la nature » Ainsi, pour Spinoza,
•SI nous remontions à la pour l'aveugle-né, qui les fins prétendument
1 1 adlsct....lltdls jamais ne pourra les poursuivies par la
temps , [ ••• ) nous renc:on· contemp ler ? Si l'on e n nature ne sont que des
ftllmtl ...
,....cr..._ croit Did erot, la nature fins humaines , et le Informes, pour quelques a produit , tout au long principe de finalité est ......
bien orgenld1 • de son évolution, de nom- à ranger au nombre de Denis Diderot, Letlr8 SUI' les aveugles breuses espèces dont nos superstitions.
Croire qu'il y a une harmonie dans la nature est une illusion .
La nature fait des erreurs, comme en têmoignent
de nombreuses monstruositês..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Il me semble que nous soyons parvenus à cette époque prédite par Descartes où les hommes em-ploieraient la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres et de tous les autres corps, en même façon que les métiers d'artisan et se rendraient ainsi, maitres de la nature. Mais, par un renversement étrange, cette domination collective se transforme en asservissement dès que l'on descend à l'échelle de l'individu et en un asservissement assez proche de celui que comporte la vi
- La forme «reptile»: une réussite originale de la Nature.
- Partagez-vous le jugement suivant de Flaubert (1853) : «Nous nous étonnons des bonshommes du siècle de Louis XIV, mais ils n'étaient pas des hommes d'énorme génie ; on n'a aucun de ces ébahissements, en les lisant, qui vous fassent croire en eux à une nature plus qu'humaine, comme à la lecture d'Homère, de Rabelais, de Shakespeare surtout, non ! Mais quelle conscience ! Comme ils se sont efforcés de trouver pour leurs pensées les expressions justes ! Quel travail ! Quelles natures ! Co
- Expliquez et discutez l'esthétique qui se dégage de ces lignes de Buffon (Discours de réception à l'Académie française, 1753): «Pourquoi les ouvrages de la Nature sont-ils si parfaits ? C'est que chaque ouvrage est un tout, et qu'elle travaille sur un plan éternel dont elle ne s'écarte jamais ; elle prépare en silence les germes de ses productions ; elle ébauche par un acte unique la forme primitive de tout être vivant ; elle la développe, elle la perfectionne par un mouvement continu
- Commenter cette phrase de Rousseau, en tête des Confessions : « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et qui n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. »