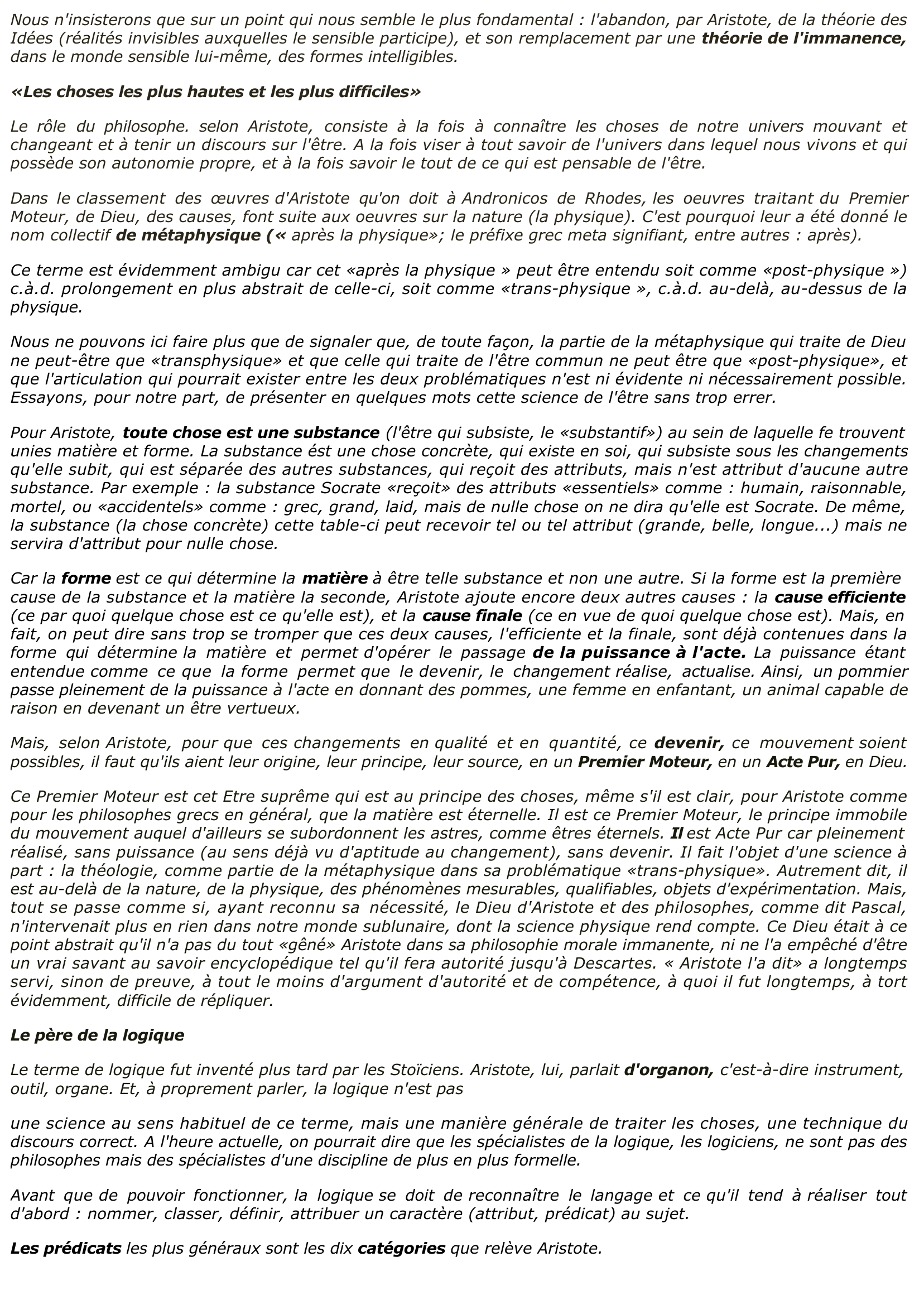La philosophie d'Aristote
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
Nous n'insisterons que sur un point qui nous semble le plus fondamental : l'abandon, par Aristote, de la théorie desIdées (réalités invisibles auxquelles le sensible participe), et son remplacement par une théorie de l'immanence, dans le monde sensible lui-même, des formes intelligibles.
«Les choses les plus hautes et les plus difficiles»
Le rôle du philosophe.
selon Aristote, consiste à la fois à connaître les choses de notre univers mouvant etchangeant et à tenir un discours sur l'être.
A la fois viser à tout savoir de l'univers dans lequel nous vivons et quipossède son autonomie propre, et à la fois savoir le tout de ce qui est pensable de l'être.
Dans le classement des œuvres d'Aristote qu'on doit à Andronicos de Rhodes, les oeuvres traitant du PremierMoteur, de Dieu, des causes, font suite aux oeuvres sur la nature (la physique).
C'est pourquoi leur a été donné lenom collectif de métaphysique (« après la physique»; le préfixe grec meta signifiant, entre autres : après).
Ce terme est évidemment ambigu car cet «après la physique » peut être entendu soit comme «post-physique »)c.à.d.
prolongement en plus abstrait de celle-ci, soit comme «trans-physique », c.à.d.
au-delà, au-dessus de laphysique.
Nous ne pouvons ici faire plus que de signaler que, de toute façon, la partie de la métaphysique qui traite de Dieune peut-être que «transphysique» et que celle qui traite de l'être commun ne peut être que «post-physique», etque l'articulation qui pourrait exister entre les deux problématiques n'est ni évidente ni nécessairement possible.Essayons, pour notre part, de présenter en quelques mots cette science de l'être sans trop errer.
Pour Aristote, toute chose est une substance (l'être qui subsiste, le «substantif») au sein de laquelle fe trouvent unies matière et forme.
La substance ést une chose concrète, qui existe en soi, qui subsiste sous les changementsqu'elle subit, qui est séparée des autres substances, qui reçoit des attributs, mais n'est attribut d'aucune autresubstance.
Par exemple : la substance Socrate «reçoit» des attributs «essentiels» comme : humain, raisonnable,mortel, ou «accidentels» comme : grec, grand, laid, mais de nulle chose on ne dira qu'elle est Socrate.
De même,la substance (la chose concrète) cette table-ci peut recevoir tel ou tel attribut (grande, belle, longue...) mais neservira d'attribut pour nulle chose.
Car la forme est ce qui détermine la matière à être telle substance et non une autre.
Si la forme est la première cause de la substance et la matière la seconde, Aristote ajoute encore deux autres causes : la cause efficiente (ce par quoi quelque chose est ce qu'elle est), et la cause finale (ce en vue de quoi quelque chose est).
Mais, en fait, on peut dire sans trop se tromper que ces deux causes, l'efficiente et la finale, sont déjà contenues dans laforme qui détermine la matière et permet d'opérer le passage de la puissance à l'acte.
La puissance étant entendue comme ce que la forme permet que le devenir, le changement réalise, actualise.
Ainsi, un pommierpasse pleinement de la puis sance à l'acte en donnant des pommes, une femme en enfantant, un animal capable de raison en devenant un être vertueux.
Mais, selon Aristote, pour que ces changements en qualité et en quantité, ce devenir, ce mouvement soient possibles, il faut qu'ils aient leur origine, leur principe, leur source, en un Premier Moteur, en un Acte Pur, en Dieu.
Ce Premier Moteur est cet Etre suprême qui est au principe des choses, même s'il est clair, pour Aristote commepour les philosophes grecs en général, que la matière est éternelle.
Il est ce Premier Moteur, le principe immobiledu mouvement auquel d'ailleurs se subordonnent les astres, comme êtres éternels.
Il est Acte Pur car pleinement réalisé, sans puissance (au sens déjà vu d'aptitude au changement), sans devenir.
Il fait l'objet d'une science àpart : la théologie, comme partie de la métaphysique dans sa problématique «trans-physique».
Autrement dit, ilest au-delà de la nature, de la physique, des phénomènes mesurables, qualifiables, objets d'expérimentation.
Mais,tout se passe comme si, ayant reconnu sa nécessité, le Dieu d'Aristote et des philosophes, comme dit Pascal,n'intervenait plus en rien dans notre monde sublunaire, dont la science physique rend compte.
Ce Dieu était à cepoint abstrait qu'il n'a pas du tout «gêné» Aristote dans sa philosophie morale immanente, ni ne l'a empêché d'êtreun vrai savant au savoir encyclopédique tel qu'il fera autorité jusqu'à Descartes.
« Aristote l'a dit» a longtempsservi, sinon de preuve, à tout le moins d'argument d'autorité et de compétence, à quoi il fut longtemps, à tortévidemment, difficile de répliquer.
Le père de la logique
Le terme de logique fut inventé plus tard par les Stoïciens.
Aristote, lui, parlait d'organon, c'est-à-dire instrument, outil, organe.
Et, à proprement parler, la logique n'est pas
une science au sens habituel de ce terme, mais une manière générale de traiter les choses, une technique dudiscours correct.
A l'heure actuelle, on pourrait dire que les spécialistes de la logique, les logiciens, ne sont pas desphilosophes mais des spécialistes d'une discipline de plus en plus formelle.
Avant que de pouvoir fonctionner, la logique se doit de reconnaître le langage et ce qu'il tend à réaliser toutd'abord : nommer, classer, définir, attribuer un caractère (attribut, prédicat) au sujet.
Les prédicats les plus généraux sont les dix catégories que relève Aristote.
1..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte : L'origine de la philosophie (Aristote)
- Aristote - philosophie.
- Aristote, Histoire des animaux (extrait) Médecine exceptée, l'histoire de la biologie trouve ses racines dans l'oeuvre d'Aristote relative à la philosophie des êtres vivants.
- GASSENDI, abbé Pierre Gassend dit (1592-1655) Philosophe et mathématicien, adversaire de la philosophie d'Aristote et de Descartes, il est partisan d'une morale épicurienne, fondée sur le plaisir de la sérénité.
- GASSENDI, abbé Pierre Gassend dit (1592-1655) Philosophe et mathématicien, adversaire de la philosophie d'Aristote et de Descartes, il est partisan d'une morale épicurienne, fondée sur le plaisir de la sérénité.