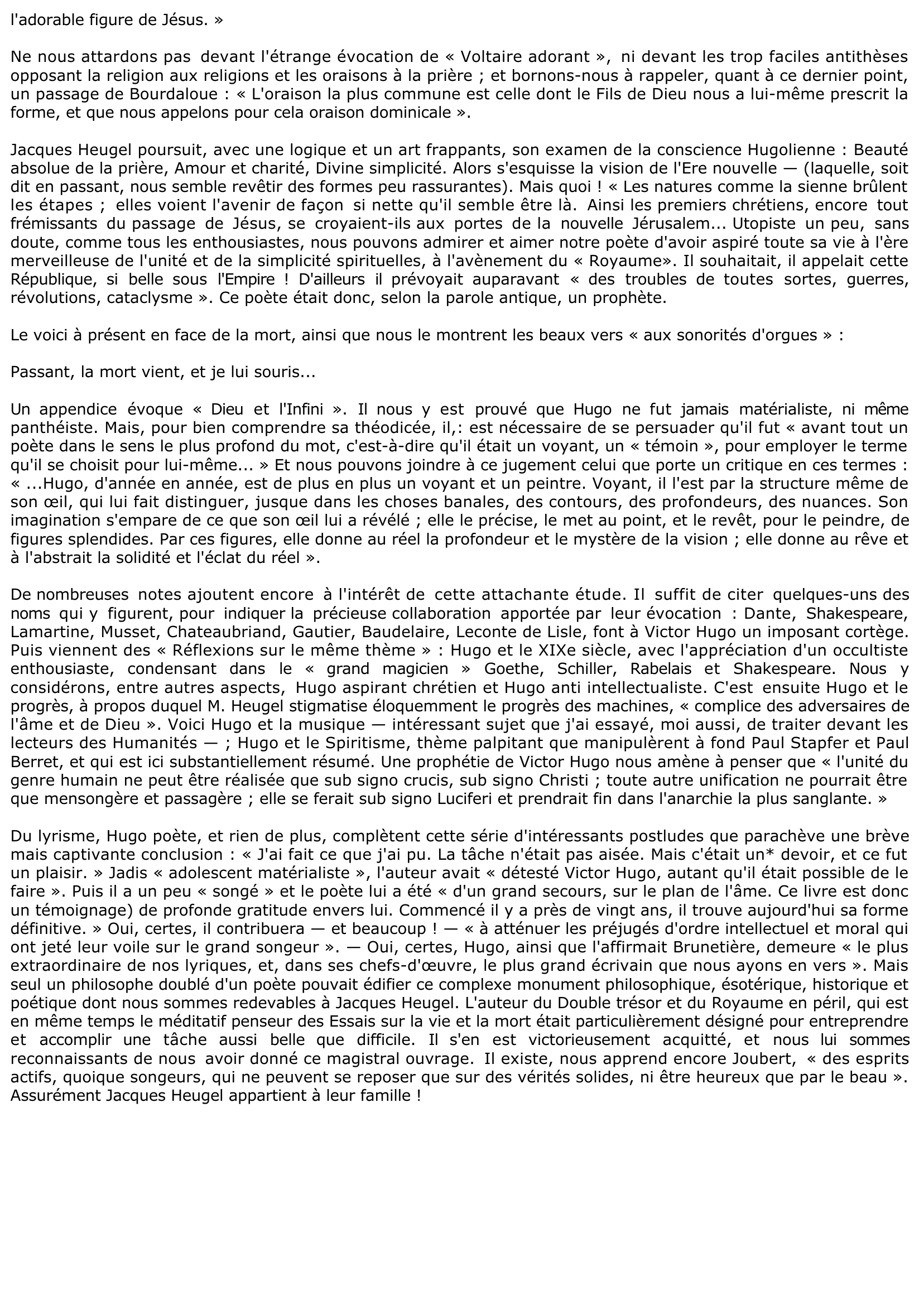LA PHILOSOPHIE DE VICTOR HUGO
Publié le 04/03/2011

Extrait du document

Viennent ensuite « La légende des siècles et la Fin de Satan «. Nouvelle étape proposée à notre admirative attention, et qu'accompagne une éloquente et pénétrante analyse de la pensée du poète. Le troisième poème achevant le triptyque est consacré à « Dieu «. Il est « presque uniquement lyrique et mystique. L'âme, ici, parle en son propre nom, nous conte sa propre histoire, ses initiations successives au mystère de la divinité, et nous fait assister à l'éclosion graduelle de son moi dans la lumière divine. « Sans doute la théologie Hugolienne ne saurait être pleinement approuvée par l'Eglise catholique. Mais quelle âme chrétienne ne serait touchée par l'admirable hommage rendu au Christ, qui « ne se montre ni à la curiosité, ni à l'intérêt, ni à la raison, ni à la volonté, ni au délire « :

«
l'adorable figure de Jésus.
»
Ne nous attardons pas devant l'étrange évocation de « Voltaire adorant », ni devant les trop faciles antithèsesopposant la religion aux religions et les oraisons à la prière ; et bornons-nous à rappeler, quant à ce dernier point,un passage de Bourdaloue : « L'oraison la plus commune est celle dont le Fils de Dieu nous a lui-même prescrit laforme, et que nous appelons pour cela oraison dominicale ».
Jacques Heugel poursuit, avec une logique et un art frappants, son examen de la conscience Hugolienne : Beautéabsolue de la prière, Amour et charité, Divine simplicité.
Alors s'esquisse la vision de l'Ere nouvelle — (laquelle, soitdit en passant, nous semble revêtir des formes peu rassurantes).
Mais quoi ! « Les natures comme la sienne brûlentles étapes ; elles voient l'avenir de façon si nette qu'il semble être là.
Ainsi les premiers chrétiens, encore toutfrémissants du passage de Jésus, se croyaient-ils aux portes de la nouvelle Jérusalem...
Utopiste un peu, sansdoute, comme tous les enthousiastes, nous pouvons admirer et aimer notre poète d'avoir aspiré toute sa vie à l'èremerveilleuse de l'unité et de la simplicité spirituelles, à l'avènement du « Royaume».
Il souhaitait, il appelait cetteRépublique, si belle sous l'Empire ! D'ailleurs il prévoyait auparavant « des troubles de toutes sortes, guerres,révolutions, cataclysme ».
Ce poète était donc, selon la parole antique, un prophète.
Le voici à présent en face de la mort, ainsi que nous le montrent les beaux vers « aux sonorités d'orgues » :
Passant, la mort vient, et je lui souris...
Un appendice évoque « Dieu et l'Infini ».
Il nous y est prouvé que Hugo ne fut jamais matérialiste, ni mêmepanthéiste.
Mais, pour bien comprendre sa théodicée, il,: est nécessaire de se persuader qu'il fut « avant tout unpoète dans le sens le plus profond du mot, c'est-à-dire qu'il était un voyant, un « témoin », pour employer le termequ'il se choisit pour lui-même...
» Et nous pouvons joindre à ce jugement celui que porte un critique en ces termes :« ...Hugo, d'année en année, est de plus en plus un voyant et un peintre.
Voyant, il l'est par la structure même deson œil, qui lui fait distinguer, jusque dans les choses banales, des contours, des profondeurs, des nuances.
Sonimagination s'empare de ce que son œil lui a révélé ; elle le précise, le met au point, et le revêt, pour le peindre, defigures splendides.
Par ces figures, elle donne au réel la profondeur et le mystère de la vision ; elle donne au rêve età l'abstrait la solidité et l'éclat du réel ».
De nombreuses notes ajoutent encore à l'intérêt de cette attachante étude.
Il suffit de citer quelques-uns desnoms qui y figurent, pour indiquer la précieuse collaboration apportée par leur évocation : Dante, Shakespeare,Lamartine, Musset, Chateaubriand, Gautier, Baudelaire, Leconte de Lisle, font à Victor Hugo un imposant cortège.Puis viennent des « Réflexions sur le même thème » : Hugo et le XIXe siècle, avec l'appréciation d'un occultisteenthousiaste, condensant dans le « grand magicien » Goethe, Schiller, Rabelais et Shakespeare.
Nous yconsidérons, entre autres aspects, Hugo aspirant chrétien et Hugo anti intellectualiste.
C'est ensuite Hugo et leprogrès, à propos duquel M.
Heugel stigmatise éloquemment le progrès des machines, « complice des adversaires del'âme et de Dieu ».
Voici Hugo et la musique — intéressant sujet que j'ai essayé, moi aussi, de traiter devant leslecteurs des Humanités — ; Hugo et le Spiritisme, thème palpitant que manipulèrent à fond Paul Stapfer et PaulBerret, et qui est ici substantiellement résumé.
Une prophétie de Victor Hugo nous amène à penser que « l'unité dugenre humain ne peut être réalisée que sub signo crucis, sub signo Christi ; toute autre unification ne pourrait êtreque mensongère et passagère ; elle se ferait sub signo Luciferi et prendrait fin dans l'anarchie la plus sanglante.
»
Du lyrisme, Hugo poète, et rien de plus, complètent cette série d'intéressants postludes que parachève une brèvemais captivante conclusion : « J'ai fait ce que j'ai pu.
La tâche n'était pas aisée.
Mais c'était un* devoir, et ce futun plaisir.
» Jadis « adolescent matérialiste », l'auteur avait « détesté Victor Hugo, autant qu'il était possible de lefaire ».
Puis il a un peu « songé » et le poète lui a été « d'un grand secours, sur le plan de l'âme.
Ce livre est doncun témoignage) de profonde gratitude envers lui.
Commencé il y a près de vingt ans, il trouve aujourd'hui sa formedéfinitive.
» Oui, certes, il contribuera — et beaucoup ! — « à atténuer les préjugés d'ordre intellectuel et moral quiont jeté leur voile sur le grand songeur ».
— Oui, certes, Hugo, ainsi que l'affirmait Brunetière, demeure « le plusextraordinaire de nos lyriques, et, dans ses chefs-d'œuvre, le plus grand écrivain que nous ayons en vers ».
Maisseul un philosophe doublé d'un poète pouvait édifier ce complexe monument philosophique, ésotérique, historique etpoétique dont nous sommes redevables à Jacques Heugel.
L'auteur du Double trésor et du Royaume en péril, qui esten même temps le méditatif penseur des Essais sur la vie et la mort était particulièrement désigné pour entreprendreet accomplir une tâche aussi belle que difficile.
Il s'en est victorieusement acquitté, et nous lui sommesreconnaissants de nous avoir donné ce magistral ouvrage.
Il existe, nous apprend encore Joubert, « des espritsactifs, quoique songeurs, qui ne peuvent se reposer que sur des vérités solides, ni être heureux que par le beau ».Assurément Jacques Heugel appartient à leur famille !.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Vini, Vidi, Vixi », Les Contemplations, Victor Hugo
- lecture linéaire: Victor Hugo Pauca meae (livre 4)
- Victor Hugo, Les Contemplations 1856 IV « Pauca Meae », 12 « A quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt »
- Victor Hugo, Les Contemplations 1856 I, « Aurore », 5, « A André Chénier »
- Proposition de correction : Victor Hugo, Notre Dame de Paris, (1831) ch. VIII, t. 7