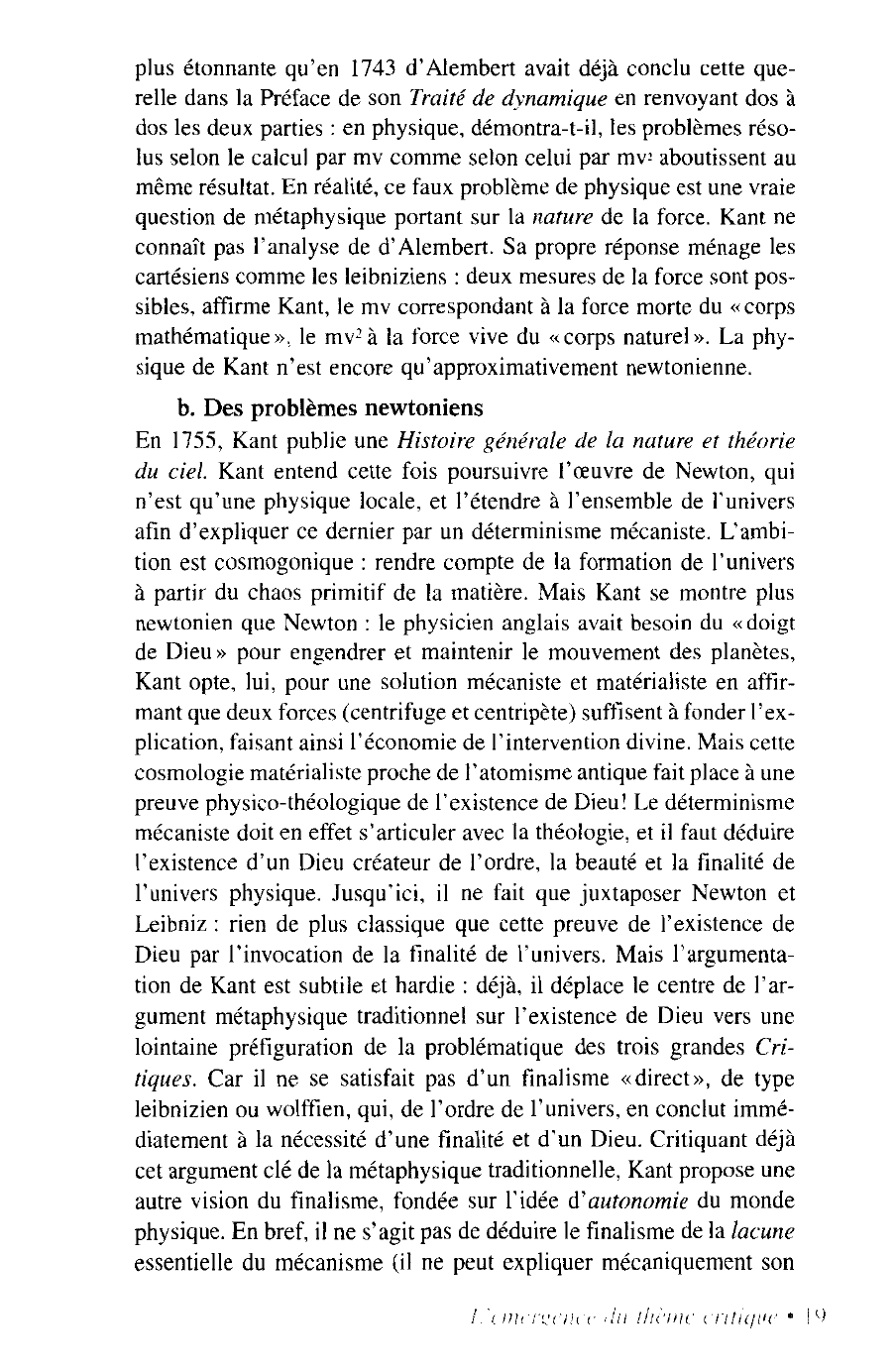LA PHILOSOPHIE PRÉCRITIQUE DE KANT
Publié le 26/03/2015

Extrait du document

En bref, la pensée métaphysique classique, surtout dans sa version wolffienne, ne semblait pas distinguer de façon absolument décisive l'être d'une substance d'une autre de ses «propriétés« : un cheval peut être grand (c'est donc une propriété de ce cheval que d'être grand ; en termes de logique, l'on dira : c'est un prédicat), mais le fait qu'un cheval existe réellement n'est pas une propriété parmi d'autres («être« n'est donc pas un prédicat comme les autres, c'est-à-dire comme «être grand«, «être marron«, etc.).
La question de l'espace et le point de vue transcendantal Lorsque Kant publie, en 1768, Du premier principe de la différence des régions dans l'espace, il ne fait d'abord que s'immiscer dans un débat très vif de l'époque entre les leibniziens et les newtoniens sur la question de la définition de l'espace.
Trois ans plus tôt, en 1765, a été publiée la correspondance entre Leibniz et le newtonien Clarke dans laquelle étaient établies les positions des partis adverses : l'espace était selon Leibniz un ordre de coexistence des substances et, selon Newton, un réceptacle mathématique absolu des corps.
C'est cette dernière définition qui va marquer Kant : admirateur de Newton, lecteur en outre des très newtoniennes Réflexions sur l'espace et le temps de Euler de 1748, Kant est convaincu que les principes absolus de la nouvelle physique requièrent l'idée d'un espace absolu.
Sa propre analyse peut être brièvement décrite de la façon suivante : soient mes deux mains ; l'une est ma main gauche, l'autre ma main droite ; elles sont symétriques, mais non juxtaposables : par quoi diffèrent-elles?
Quel est le principe de cette différence désignée par les adjectifs «gauche« et «droite«?
Elles ne diffèrent pas, dit Kant, par leurs propriétés intrinsèques (elles sont deux volumes symétriques, elles ont les mêmes rapports internes).
Ce qui fonde leur différence, ce sont leurs rapports externes: leur position par rapport à un repère absolu, qui est l'espace lui-même.
Cet exemple, qui est l'un de ceux de ce que Kant nomme le problème des volumes non congruents, permet de comprendre qu'il existe bien un espace absolu originaire, qui n'est pas un simple ordre de coexistence des substances entre elles, mais bien un espace qui existe indépendamment de toute matière et qui, comme l'écrit Kant, «comporte une réalité qui lui est propre«.
Or, ce diagnostic de stricte obédience newtonienne comporte une conséquence qui va avoir une influence déterminante sur la formation de la philosophie kantienne : l'espace absolu originaire est bien la condition de possibilité de ce qui nous est donné dans l'expérience sensible.
tel objet en faisant abstraction de sa position (de sa «région«, comme le dit Kant) dans l'espace, et donc encore moins de sa position par rapport à nous.
En définitive, les conditions de l'objet sont les conditions de son rapport à nous.
Ce qui émerge ici, c'est l'idée d'une subjectivité transcendantale: celle des conditions de possibilité de l'objet qui sont inscrites en nous, et non dans l'objet lui-même.
L'idée d'espace permet de découvrir cette notion de condition de possibilité (l'espace est celle du donné sensible) qui fonde le point de vue transcendantal.
Sera transcendantale une condition a priori (donc antérieure à l'expérience sensible) qui rend une connaissance possible.

«
plus étonnante qu'en 1743 d'Alembert avait déjà conclu cette que
relle dans la Préface de son
Traité de dynamique en renvoyant dos à
dos les deux parties : en physique, démontra-t-il, les problèmes réso
lus selon
Je calcul par mv comme selon celui par mv' aboutissent au
même résultat.
En réalité, ce faux problème de physique est une vraie
question de métaphysique portant sur la
nature de la force.
Kant ne
connaît pas J'analyse de d'Alembert.
Sa propre réponse ménage les
cartésiens comme les Jeibniziens : deux mesures de la force sont pos
sibles, affirme Kant, le mv correspondant à la force morte du
«corps
mathématique»,
Je mv 2 à la force vive du «corps naturel».
La phy
sique de Kant
n'est encore qu'approximativement newtonienne.
b.
Des problèmes newtoniens
En 1755, Kant publie une Histoire générale de la nature et théorie
du ciel.
Kant entend cette fois poursuivre J'œuvre de Newton, qui
n'est qu'une physique locale, et l'étendre à l'ensemble de l'univers
afin d'expliquer ce dernier par
un déterminisme mécaniste.
L'ambi
tion est cosmogonique : rendre compte de la formation de l'univers
à partir du chaos primitif de la matière.
Mais Kant se montre plus
newtonien que Newton : le physicien anglais avait besoin du
«doigt
de Dieu» pour engendrer et maintenir le mouvement des planètes,
Kant opte, lui, pour une solution mécaniste et matérialiste en affir
mant que deux forces (centrifuge et centripète) suffisent à fonder l'ex
plication.
faisant ainsi l'économie de l'intervention divine.
Mais cette
cosmologie matérialiste proche de l'atomisme antique fait place à une
preuve physico-théologique de l'existence de Dieu' Le déterminisme
mécaniste doit en effet s'articuler avec la théologie, et
il faut déduire
l'existence
d'un Dieu créateur de l'ordre, la beauté et la finalité de
l'univers physique.
Jusqu'ici,
il ne fait que juxtaposer Newton et
Leibniz: rien de plus classique que cette preuve de l'existence de
Dieu par l'invocation de la finalité de l'univers.
Mais l'argumenta
tion de Kant est subtile et
hardie: déjà.
il déplace Je centre de l'ar
gument métaphysique traditionnel sur J 'existence de Dieu vers une
lointaine préfiguration de la problématique des trois grandes
Cri
tiques.
Car il ne se satisfait pas d'un finalisme «direct», de type
leibnizien ou wolffien, qui, de l'ordre de l'univers, en conclut immé
diatement à la nécessité
d'une finalité et d'un Dieu.
Critiquant déjà
cet argument clé de la métaphysique traditionnelle, Kant propose une
autre vision du finalisme, fondée sur l'idée
d'autonomie du monde
physique.
En bref,
il ne s'agit pas de déduire le finalisme de la lacune
essentielle du mécanisme (il ne peut expliquer mécaniquement son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Emmanuel Kant: CONCEPT DE GRANDEUR NÉGATIVE (LE) ou ESSAI POUR INTRODUIRE DANS LA PHILOSOPHIE LE CONCEPT DE GRANDEUR NÉGATIVE
- PROLÉGOMÈNES À TOUTE Métaphysique FUTURE Emmanuel KANT (philosophie - étude d'une oeuvre)
- Commentaire de philosophie: Emmanuel Kant, Réflexions sur l’éducation
- Commentaire de philosophie : Kant, extrait de la Critique de la faculté de juger (1790)
- La philosophie de Kant par rapport à Leibniz