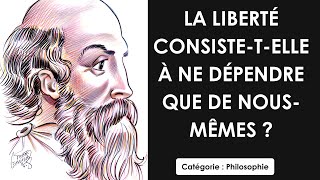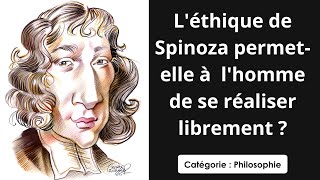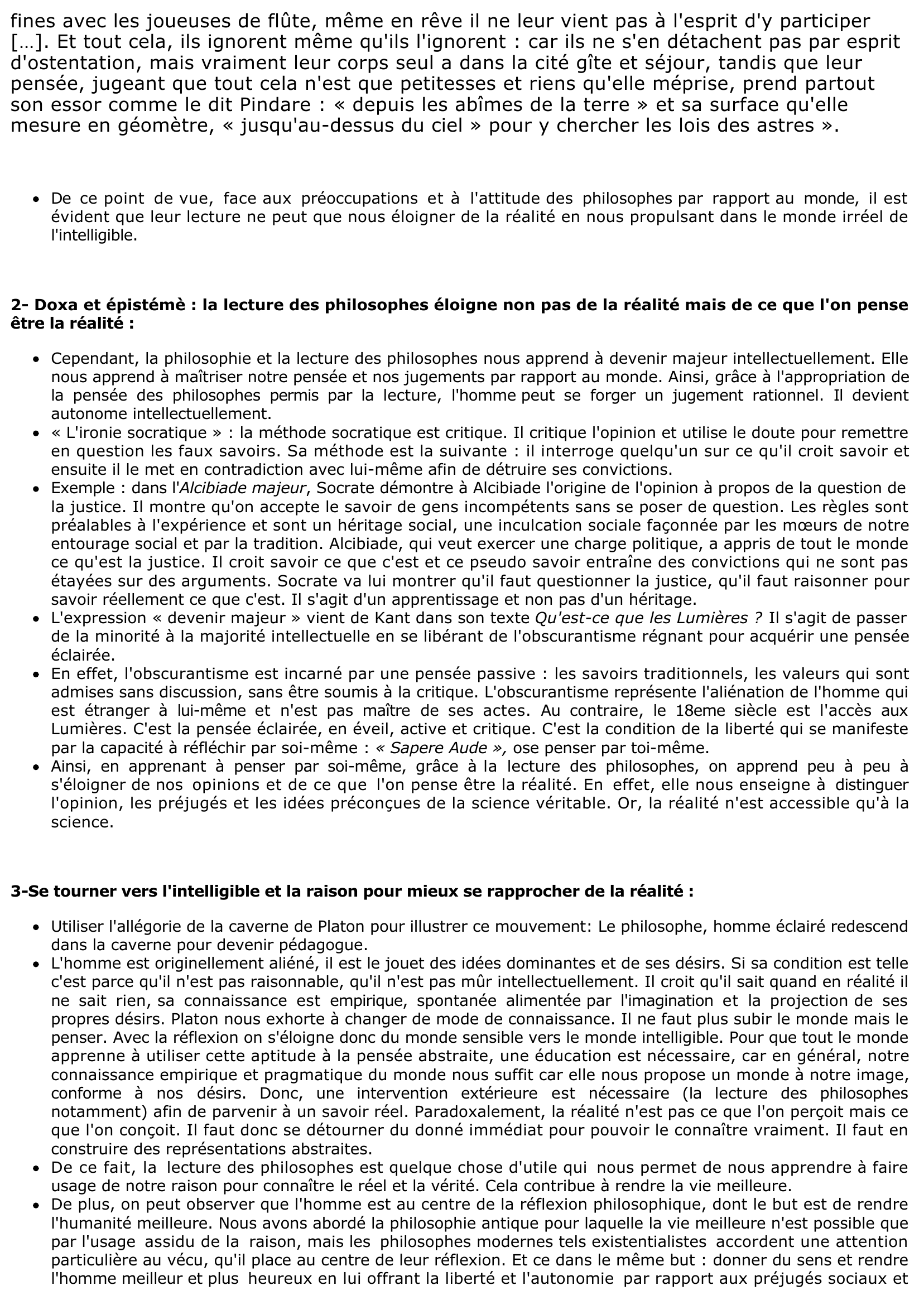La philosophie tourne-t-elle le dos à la réalité ?
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
fines avec les joueuses de flûte, même en rêve il ne leur vient pas à l'esprit d'y participer[…].
Et tout cela, ils ignorent même qu'ils l'ignorent : car ils ne s'en détachent pas par espritd'ostentation, mais vraiment leur corps seul a dans la cité gîte et séjour, tandis que leurpensée, jugeant que tout cela n'est que petitesses et riens qu'elle méprise, prend partoutson essor comme le dit Pindare : « depuis les abîmes de la terre » et sa surface qu'ellemesure en géomètre, « jusqu'au-dessus du ciel » pour y chercher les lois des astres ».
De ce point de vue, face aux préoccupations et à l'attitude des philosophes par rapport au monde, il estévident que leur lecture ne peut que nous éloigner de la réalité en nous propulsant dans le monde irréel del'intelligible.
2- Doxa et épistémè : la lecture des philosophes éloigne non pas de la réalité mais de ce que l'on penseêtre la réalité :
Cependant, la philosophie et la lecture des philosophes nous apprend à devenir majeur intellectuellement.
Ellenous apprend à maîtriser notre pensée et nos jugements par rapport au monde.
Ainsi, grâce à l'appropriation dela pensée des philosophes permis par la lecture, l'homme peut se forger un jugement rationnel.
Il devientautonome intellectuellement.« L'ironie socratique » : la méthode socratique est critique.
Il critique l'opinion et utilise le doute pour remettreen question les faux savoirs.
Sa méthode est la suivante : il interroge quelqu'un sur ce qu'il croit savoir etensuite il le met en contradiction avec lui-même afin de détruire ses convictions.Exemple : dans l' Alcibiade majeur , Socrate démontre à Alcibiade l'origine de l'opinion à propos de la question de la justice.
Il montre qu'on accepte le savoir de gens incompétents sans se poser de question.
Les règles sontpréalables à l'expérience et sont un héritage social, une inculcation sociale façonnée par les mœurs de notreentourage social et par la tradition.
Alcibiade, qui veut exercer une charge politique, a appris de tout le mondece qu'est la justice.
Il croit savoir ce que c'est et ce pseudo savoir entraîne des convictions qui ne sont pasétayées sur des arguments.
Socrate va lui montrer qu'il faut questionner la justice, qu'il faut raisonner poursavoir réellement ce que c'est.
Il s'agit d'un apprentissage et non pas d'un héritage.L'expression « devenir majeur » vient de Kant dans son texte Qu'est-ce que les Lumières ? Il s'agit de passer de la minorité à la majorité intellectuelle en se libérant de l'obscurantisme régnant pour acquérir une penséeéclairée.En effet, l'obscurantisme est incarné par une pensée passive : les savoirs traditionnels, les valeurs qui sontadmises sans discussion, sans être soumis à la critique.
L'obscurantisme représente l'aliénation de l'homme quiest étranger à lui-même et n'est pas maître de ses actes.
Au contraire, le 18eme siècle est l'accès auxLumières.
C'est la pensée éclairée, en éveil, active et critique.
C'est la condition de la liberté qui se manifestepar la capacité à réfléchir par soi-même : « Sapere Aude », ose penser par toi-même. Ainsi, en apprenant à penser par soi-même, grâce à la lecture des philosophes, on apprend peu à peu às'éloigner de nos opinions et de ce que l'on pense être la réalité.
En effet, elle nous enseigne à distinguerl'opinion, les préjugés et les idées préconçues de la science véritable.
Or, la réalité n'est accessible qu'à lascience.
3-Se tourner vers l'intelligible et la raison pour mieux se rapprocher de la réalité :
Utiliser l'allégorie de la caverne de Platon pour illustrer ce mouvement: Le philosophe, homme éclairé redescenddans la caverne pour devenir pédagogue.L'homme est originellement aliéné, il est le jouet des idées dominantes et de ses désirs.
Si sa condition est tellec'est parce qu'il n'est pas raisonnable, qu'il n'est pas mûr intellectuellement.
Il croit qu'il sait quand en réalité ilne sait rien, sa connaissance est empirique, spontanée alimentée par l'imagination et la projection de sespropres désirs.
Platon nous exhorte à changer de mode de connaissance.
Il ne faut plus subir le monde mais lepenser.
Avec la réflexion on s'éloigne donc du monde sensible vers le monde intelligible.
Pour que tout le mondeapprenne à utiliser cette aptitude à la pensée abstraite, une éducation est nécessaire, car en général, notreconnaissance empirique et pragmatique du monde nous suffit car elle nous propose un monde à notre image,conforme à nos désirs.
Donc, une intervention extérieure est nécessaire (la lecture des philosophesnotamment) afin de parvenir à un savoir réel.
Paradoxalement, la réalité n'est pas ce que l'on perçoit mais ceque l'on conçoit.
Il faut donc se détourner du donné immédiat pour pouvoir le connaître vraiment.
Il faut enconstruire des représentations abstraites.De ce fait, la lecture des philosophes est quelque chose d'utile qui nous permet de nous apprendre à faireusage de notre raison pour connaître le réel et la vérité.
Cela contribue à rendre la vie meilleure.De plus, on peut observer que l'homme est au centre de la réflexion philosophique, dont le but est de rendrel'humanité meilleure.
Nous avons abordé la philosophie antique pour laquelle la vie meilleure n'est possible quepar l'usage assidu de la raison, mais les philosophes modernes tels existentialistes accordent une attentionparticulière au vécu, qu'il place au centre de leur réflexion.
Et ce dans le même but : donner du sens et rendrel'homme meilleur et plus heureux en lui offrant la liberté et l'autonomie par rapport aux préjugés sociaux et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PHILOSOPHIE DE LA RÉALITÉ d Eugen Dühring (résumé)
- Le mot « réalité » en philosophie
- La philosophie n'a-t-elle aucune emprise sur la réalité ?
- Hegel, Principes de la philosophie du droit, La vie éthique § 260, Vrin, p. 264 : L'État réalité effective de la liberté
- La valeur de la philosophie doit en réalité surtout résider dans son caractère incertain même. RUSSELL