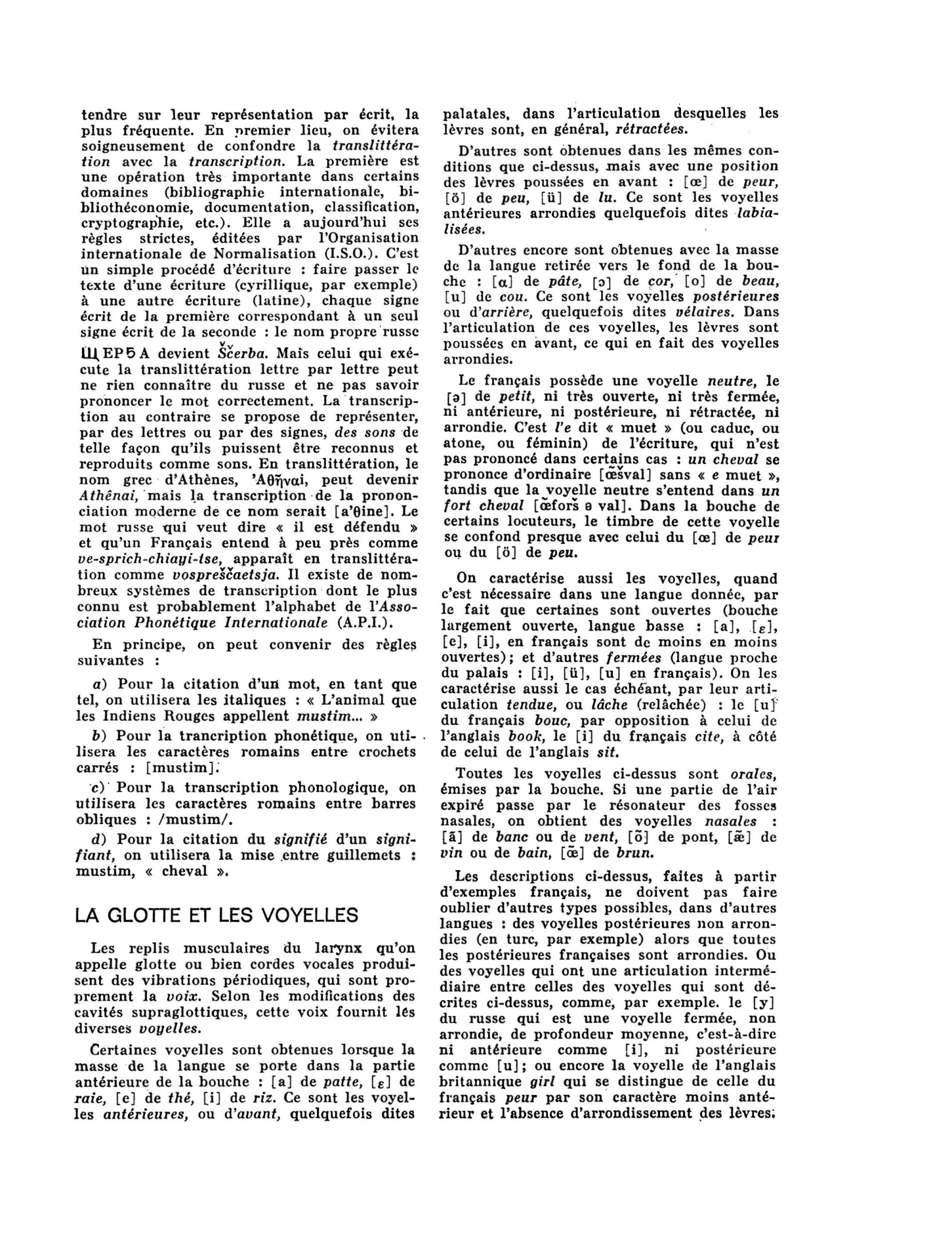LA PHONETIQUE, AUXILIAIRE DE LA LINGUISTIQUE
Publié le 22/10/2011

Extrait du document
La raréfaction de l'air qui aboutit aux implosives peut se réaliser entre deux occlusions buccales. On peut, par exemple, appuyer l'ensemble du dos et de la pointe de la langue contre la voûte du palais, puis créer une zone de vide en déprimant la partie centrale de l'organe; une implosion peut alors se produire lorsqu'on relâche l'occlusion antérieure.
«
tendre sur leur représentation par écrit, la plus fréquente.
En !'remier lieu, on évitera soigneusement de confondre la translittéra tion avec la transcription.
La premi ère est une opération très importante dans certains domaines (bibliographie internationale, bi bliothéconomie, documentation, classification, cryptographie, etc.).
Elle a aujourd'hui ses règles strictes, éditées par l'Organisation internationale de Normali sation (I.S.O.).
C'est ùn simple procédé d'écriture : faire passer lC' texte d'une écriture (cyrillique , par exemple )
à une autre écriture (latine), chaque signe écrit de la première corre spondant à un seul signe écrit d e la seconde : le nom propre ·russe
W.
EP 6 A devient Scerba.
Mais celui qui exé cute la translittération lettre par lettre peut ne rien connaître du russe et ne pas savoir prononcer le mot correctement.
La · transcrip tion au contraire se propose de représenter, par des lettres ou par des signes, des sons de telle façon qu'ils puissent être reconnus et reproduits comme sons.
En translittération, le nom grec · d'Athènes , 'A61)vai, peut devenir A thênai, ·mais ~a transcription ·de la pronon ciation mqderne de ce nom serait [a'Oine].
Le mot russe qui veut dire « il est défendu » et qu'un Français entend à peu près comme ve-sprich-chiayi-tse, apparaît en translittéra tion comme vosprescaetsja.
Il existe de nom breux systèmes de transcription · dont le plus connu e st probablement l'alphabet de l' Asso
ciation Phonétique Internationale (A.P.I.).
En principe, on peut convenir des règles suivantes :
a) Pour la citation d'un mot, en tant que tel, on utilisera les italiques : « L'aniinal que les Indiens Rouges appellent mustim ...
»
b) Pour la trancription phonétique, on uti- .
lisera les caractères romains entre crochets carrés : [mustim];
·c) · Pour la transcription phonologique, on utilisera les caractères romains entre barres obliques : /mustim/.
d) Pour la citation du signifié d'un signi fiant, on utilisera la mise .entre guillemets : mustim, « cheval » .
LA GLOTTE ET LES VOYELLES
Les replis muscula.ires du larynx qu'on appelle glotte ou bien cordes vocales produi sent des vibrations périodiques, qui sont pro prement la voix.
Selon les modifications des cavités supraglottiques, cette voix fournit les diverses voy elles.
Certaines voyelles sont obtenues lorsque la masse ·de la langue se porte dans la partie antérieure de la bouche : [a] de patte, [el de raie, [e] de thé, [i] de riz.
Ce sont les voyel les antérieures, ou d 'avant, quelquefois dites
palatales, dans l'articulation desquelles les lèvres sont, en général, rétractées.
D 'autres sont obtenues dans les mêmes con ditions que ci-dessus , mais avec une position des lèvres poussées en avant : [œ ) de peur, [ô] de peu, [ü] de lu.
Ce sont les voyelles antérieures arrondies quelquefois dites labia
lisées.
D'autres encore sont o ·btenues avec la masse de la langue retirée vers le fond de la bou che : [a ] de pâte , [:>] de çor, · [o] de beau, [u] de cou.
Ce sont les voyelles postérieures ou d'arrièr e, quelquefois dites vélaires .
Dans l'articulation de ces voyelles, les lèvres sont poussées en avant, ce qui en fait des voyelles arrondies.
Le français possède une voyelle neutre, le [a] de petit, ni très ouverte, ni très fermée, ni antérieure, ni postérieure, ni rétractée, ni arrondie.
C'est l'e dit « muet » (ou caduc, ou atone, ou féminin) de l'écriture, qui n'est pas prononcé dans certains cas : un cheval se prononce d'ordinaire [resval] sans « e muet », tandis que la voyelle neutre s'entend dans un fort cheval [Œfors a val].
Dans la bouche de certains locuteurs, le timbre de cette voyelle se confond presque avec celui du [œ] de peuz ou du [ô] de peu.
On caractérise aussi les voyelles, quand c'est nécessaire dans une langue donnée, par le fait que certaines sont ouvertes (bouche largement ouverte, langue basse : [a], [el , [e], [i], en français sont de moins en moins ouvertes); et d'autres fermées (langue proche du palais : [i], [ü], [u] en français).
On les caractérise aussi le cas échéant, par leur arti culation tendue, ou lâche (relâchée) : le [uf du français bouc, par opposition à celui de l'anglais book, le [i] du fr~,tnçais cite, à côté de celui de l'anglais sit.
Toutes les voyelles ci-dessus sont orales, émises par la bouche.
Si une partie de l'air expiré passe par le résonateur des fosses nasales, on obtient des voyelles nasales : [a] de banc ou de vent, [o] de pont, [re] de vin ou de bain, [re] de brun.
Les descriptions ci~dessus, faites à partir d'exemples français, ne doivent pas faire oublier d'autres types possibles, dans d'autres langues : des voyelles postérieures non anon dies (en turè, par exemple) alors que toutes les postérieures françaises sont arrondies.
Ou des voyelles qui ont une articulation intermé diaire entre celles des voyelles qui sont dé crites ci-dessus, comme, par exemple.
le [y] du russe qui est une voyelle fermée, non arrondie, de profondeur moyenne, c'est-à-dire ni antérieure comme [i], ni postérieure comme [u]; ou encore la voyelle de l'anglais britannique girl qui se distingue de celle du français peur par son · caractère moins anté rieur et l'absence d'arrondissement ~es lèvres;.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- auxiliaire (grammaire) - Langues et Linguistique.
- LINGUISTIQUE S4 – UE 5 CONTRÔLE CONTINU N°2 - CORRIGE
- linguistique victor hugo
- linguistique
- Tu écris le pronom pe rsonnel sujet qui m anque : Tu complè tes ave c l' auxiliaire avoir ou êt re .