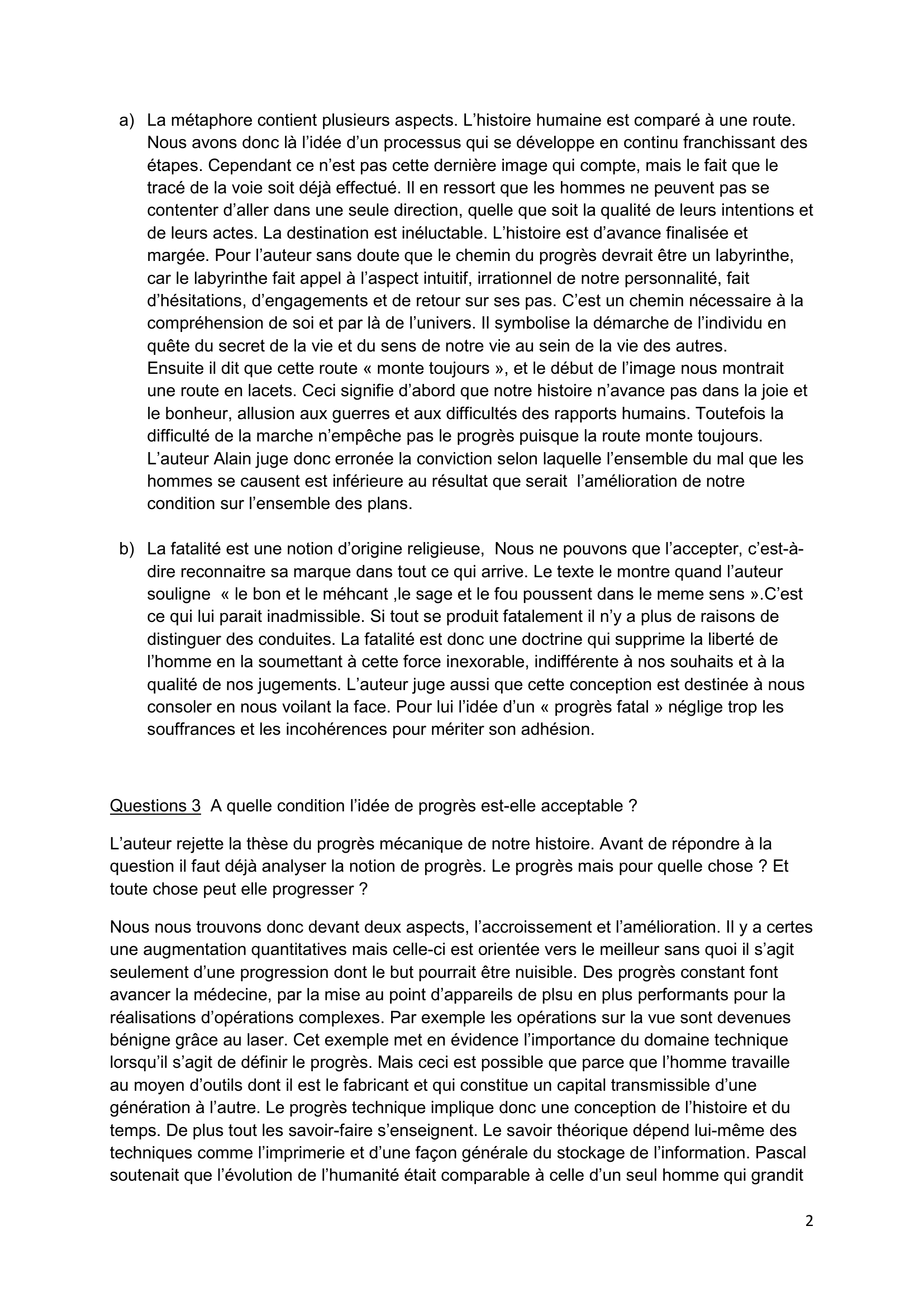La route en lacets (Alain)
Publié le 03/04/2014

Extrait du document
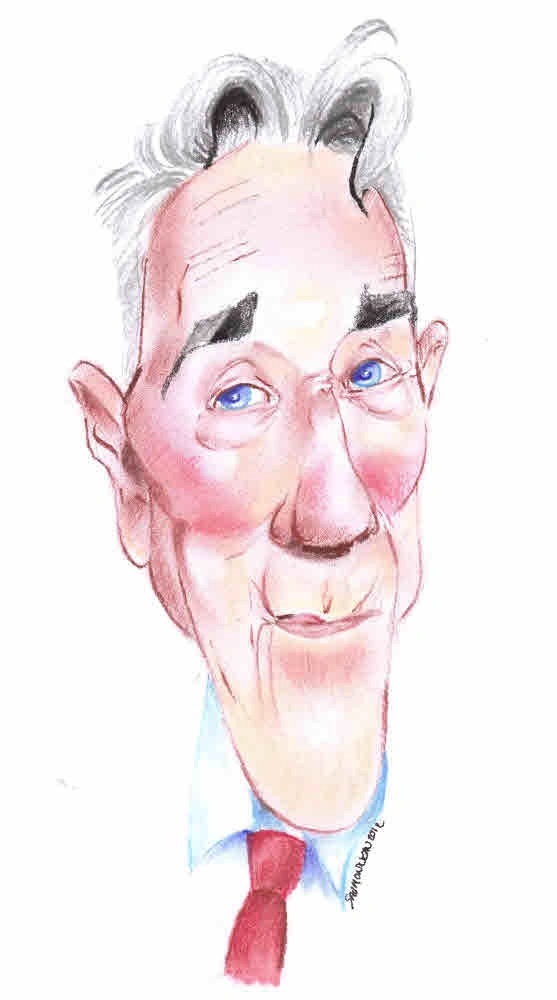
« La route en lacets qui monte. Belle image du progrès. Mais pourtant elle ne me semble pas bonne. Ce que je vois de faux, en cette image, c'est cette route tracée d'avance et qui monte toujours ; cela veut dire que l'empire des sots et des violents nous pousse encore vers une plus grande perfection, quelles que soient les apparences ; et qu'en bref l'humanité marche à son destin par tous les moyens, et souvent fouettée et humiliée, mais avançant toujours. Le bon et le méchant, le sage et le fou poussent dans le même sens, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non. Je reconnais ici le grand jeu des dieux supérieurs, qui font que tout serve leurs desseins. Mais grand merci. Je n'aimerais point cette mécanique, si j'y croyais. Tolstoï* aime aussi à se connaître lui-même comme un faible atome en de grands tourbillons. Et Pangloss**, avant ceux-là, louait la Providence, de ce qu'elle fait sortir un petit bien de tant de maux. Pour moi, je ne puis croire à un progrès fatal ; je ne m'y fierais point. «
ALAIN
Question 1 : Quel est l’idée directrice du texte ? Quelles sont les étapes de l’argumentation ?
L’idée directrice de de ce texte est la critique et mise à mal de cette allégation d’un progrès inéluctable de l’histoire de l’humanité. L’auteur là développe en se servant d’une image dont il va démontrer l’inexactitude qu’elle représente pour lui. Certains mots, telle que « destin «, «fatal «, « Providence « qui font partie du vocabulaire religieux mettent en évidence un lien divin quant à l’affirmation d’un progrès inéluctable. L’auteur y fait référence lorsqu’il dit « le grand jeu des dieux supérieurs «.Nous pourrions penser que les idées qui soutiennent une telle idée seraient des formes déguisées de croyance. Peut-être une transposition de ces religions à notre philosophie moderne.
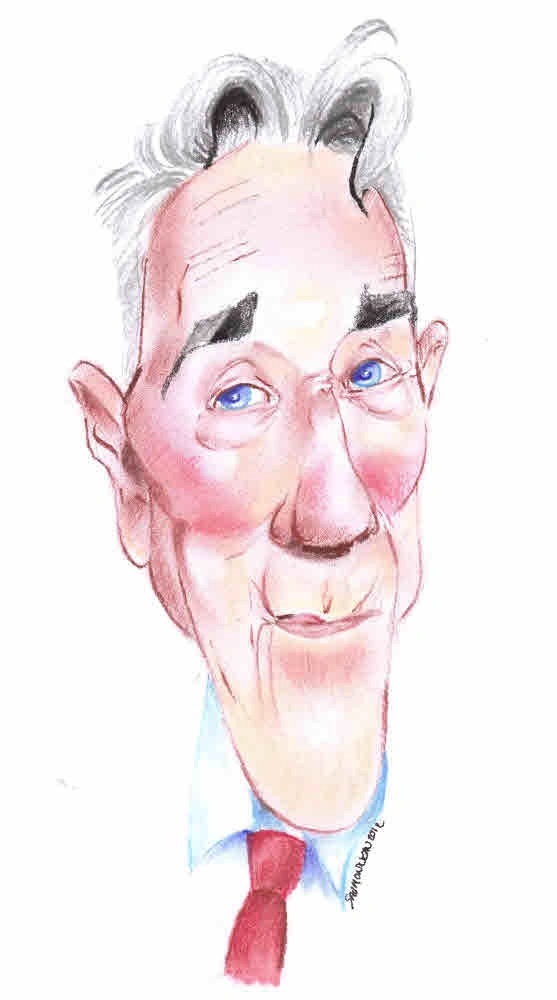
«
a) La métaphore contient plusieurs aspects.
L’histoire humaine est comparé à une route.
Nous avons donc là l’idée d’un processus qui se développe en continu franchissant des
étapes.
Cependant ce n’est pas cette dernière image qui compte, mais le fait que le
tracé de la voie soit déjà effectué.
Il en ressort que les hommes ne peuvent pas se
contenter d’aller dans une seule direction, quelle que soit la qualité de leurs intentions et
de leurs actes.
La destination est inéluctable.
L’ histoire est d’avance finalisée et
margée.
Pour l’auteur sans doute que le chemin du progrès devrait être un labyrinthe,
car le labyrinthe fait appel à l’aspect intuitif, irrationnel de notre personnalité, fait
d’hésitations, d’engagements et de retour sur ses pas.
C’est un chemin nécessaire à la
compréhension de soi et par là de l’univers.
Il symbolise la démarche de l’individu en
quête du secret de la vie et du sens de notre vie au sein de la vie des autres.
Ensuite il dit que cette route « monte toujours », et le début de l’image nous montrait
une route en lacets.
Ceci signifie d’abord que notre histoire n’avance pas dans la joie et
le bonheur, allusion aux guerres et aux difficultés des rapports humains.
Toutefois la
difficulté de la marche n’empêche pas le progrès puisque la route monte toujours.
L’auteur Alain juge donc erronée la conviction selon laquelle l’ensemble du mal que les
hommes se causent est inférieure au résultat que serait l’amélioration de notre
condition sur l’ensemble des plans.
b) La fatalité est une notion d’origine religieuse, Nous ne pouvons que l’accepter, c’est -à -
dire reconnaitre sa marque dans tout ce qui arrive.
Le texte le montre quand l’auteur
souligne « le bon et le méhcant ,le sage et le fou poussent dans le meme sens » .C’est
ce qui lui parait inadmissible.
Si tout se produit fatalement il n’y a plus de raisons de
distinguer des conduites.
La fatalité est donc une doctrine qui supprime la liberté de
l’homme en la soumettant à cette force inexorable, indifférente à nos souhaits et à la
qualité de nos jugements.
L’auteur juge aussi que cette conception est destinée à nous
consoler en nous voilant la face.
Pour lui l’idée d’un « progrès fatal » néglige trop les
souffrances et les incohérences pour mériter son adhésion.
Ques tions 3 A quelle condition l’idée de progrès est -elle acceptable ?
L’auteur rejette la thèse du progrès mécanique de notre histoire.
Avant de répondre à la
question il faut déjà analyser la notion de progrès.
Le progrès mais pour quelle chose ? Et
toute chose peut elle progresser ?
Nous nous trouvons donc devant deux aspects, l’accroissement et l’amélioration.
Il y a certes
une augmentation quantitatives mais celle- ci est orientée vers le meilleur sans quoi il s’agit
seulement d’une progression dont le but pourrait être nuisible.
Des progrès constant font
avancer la médecine, par la mise au point d’appareils de plsu en plus performants pour la
réalisations d’opérations complexes.
Par exemple les opérations sur la vue sont devenues
bénigne grâce au laser.
C et exemple met en évidence l’importance du domaine technique
lorsqu’il s’agit de définir le progrès.
Mais ceci est possible que parce que l’homme travaille
au moyen d’outils dont il est le fabricant et qui constitue un capital transmissible d’une
génération à l’autre.
Le progrès technique implique donc une conception de l’histoire et du
temps.
De plus tout les savoir -faire s’enseignent.
Le savoir théorique dépend lui -même des
techniques comme l’imprimerie et d’une façon générale du stockage de l’information.
Pascal
soutenait que l’évolution de l’humanité était comparable à celle d’un seul homme qui grandit
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le progrès n'est pas une « route en lacets » - ALAIN
- Alain: La route en lacets.
- Il est bon d'avoir un peu de mal à vivre et de ne pas suivre une route tout unie. Alain. Commentez cette citation.
- Il est bon d'avoir un peu de mal à vivre et de ne pas suivre une route tout unie. Propos sur le bonheur (1928) Alain, Emile-Auguste Chartier, dit. Commentez cette citation.
- [Artisan et artiste] Alain