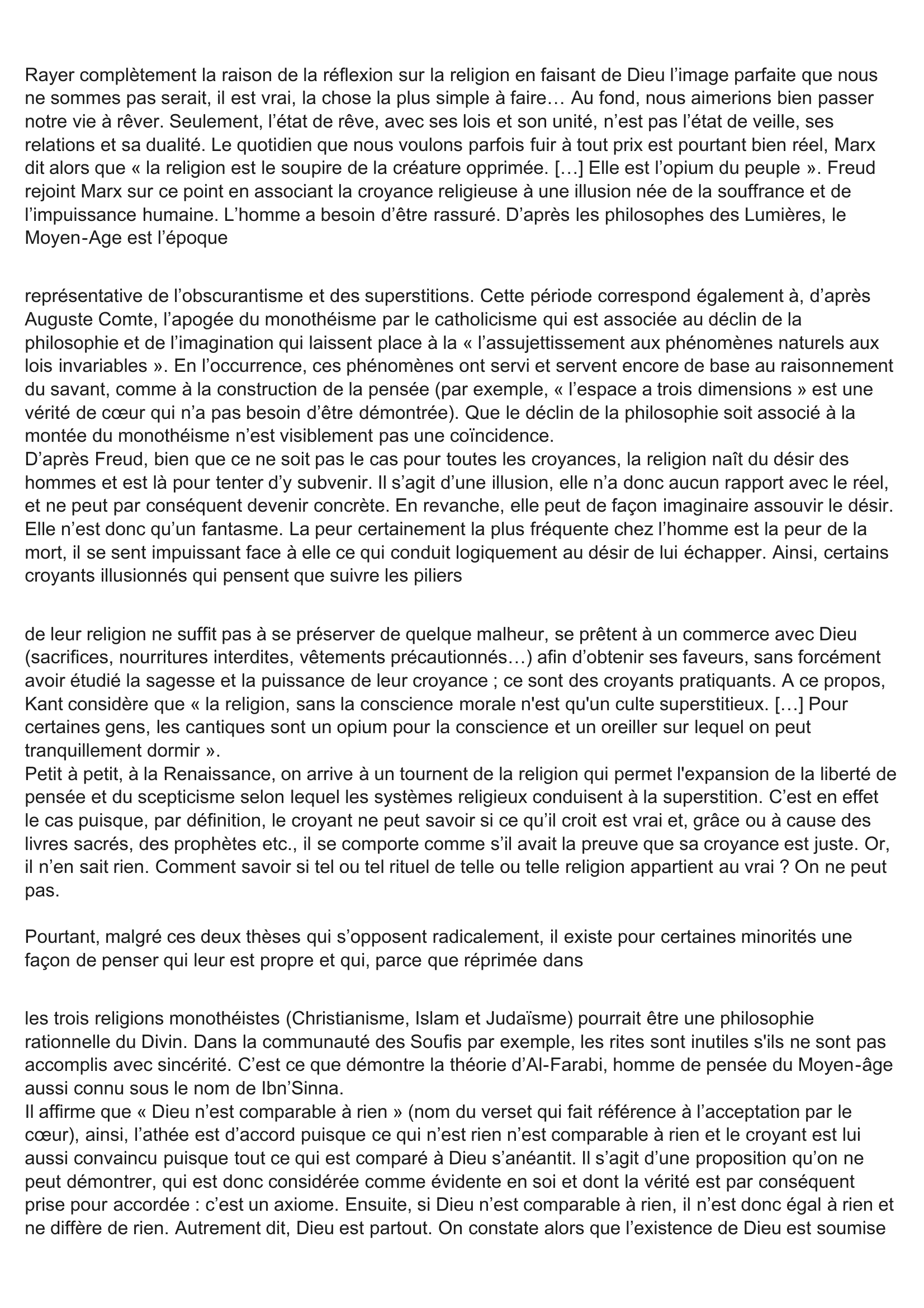« Le croyant est-il fou ? »
Publié le 20/12/2012

Extrait du document

Cette découverte doit faire prendre conscience au croyant que s’il aime Dieu, il l’aime sans rien connaître
de lui et à tous les autres hommes de leur
faire comprendre qu’aucun homme d’Eglise ni aucune Religion ne peut connaître les vérités qu’ils
prétendent nous transmettre. De tels propos ramènent au premier plan la liberté de l’homme, exonéré de
toute influence, de choisir sa voie vis-à-vis de Dieu. Peut-on imaginer une société où chaque homme
serait totalement libre de vivre sa vie spirituelle comme il l’entend ? Un monde où il aurait le choix d’avoir
Dieu à ses côtés, ou non, sans qu’aucune autorité l’en empêche ou tente de le corrompre ? D’une façon
peut-être utopique, cette société pourrait ressembler à celle qui existait lorsque les trois religions
monothéistes n’étaient pas en rivalité et qu’avaient lieux des réunions de partage sur l’existence de
l’homme dans le monde, et où toute référence à un quelconque livre sacré était interdite afin de ne pas
altérer la réflexion.

«
Rayer complètement la raison de la réflexion sur la religion en faisant de Dieu l’image parfaite que nous
ne sommes pas serait, il est vrai, la chose la plus simple à faire… Au fond, nous aimerions bien passer
notre vie à rêver.
Seulement, l’état de rêve, avec ses lois et son unité, n’est pas l’état de veille, ses
relations et sa dualité.
Le quotidien que nous voulons parfois fuir à tout prix est pourtant bien réel, Marx
dit alors que « la religion est le soupire de la créature opprimée.
[…] Elle est l’opium du peuple ».
Freud
rejoint Marx sur ce point en associant la croyance religieuse à une illusion née de la souffrance et de
l’impuissance humaine.
L’homme a besoin d’être rassuré.
D’après les philosophes des Lumières, le
Moyen -Age est l’époque
représentative de l’obscurantisme et des superstitions.
Cette période correspond également à, d’après
Auguste Comte, l’apogée du monothéisme par le catholicisme qui est associée au déclin de la
philosophie et de l’imagination qui laissent place à la « l’assujettissement aux phénomènes naturels aux
lois invariables ».
En l’occurrence, ces phénomènes ont servi et servent encore de base au raisonnement
du savant, comme à la construction de la pensée (par exemple, « l’espace a trois dimensions » est une
vérité de cœur qui n’a pas besoin d’être démontrée).
Que le déclin de la philosophie soit associé à la
montée du monothéisme n’est visiblement pas une coïncidence.
D’après Freud, bien que ce ne soit pas le cas pour toutes les croyances, la religion naît du désir des
hommes et est là pour tenter d’y subvenir.
Il s’agit d’une illusion, elle n’a donc aucun rapport avec le réel,
et ne peut par conséquent devenir concrète.
En revanche, elle peut de façon imaginaire assouvir le désir.
Elle n’est donc qu’un fantasme.
La peur certainement la plus fréquente chez l’homme est la peur de la
mort, il se sent impuissant face à elle ce qui conduit logiquement au désir de lui échapper.
Ainsi, certains
croyants illusionnés qui pensent que suivre les piliers
de leur religion ne suffit pas à se préserver de quelque malheur, se prêtent à un commerce avec Dieu
(sacrifices, nourritures interdites, vêtements précautionnés…) afin d’obtenir ses faveurs, sans forcément
avoir étudié la sagesse et la puissance de leur croyance ; ce sont des croyants pratiquants.
A ce propos,
Kant considère que « la religion, sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux.
[…] Pour
certaines gens, les cantiques sont un opium pour la conscience et un oreiller sur lequel on peut
tranquillement dormir ».
Petit à petit, à la Renaissance, on arrive à un tournent de la religion qui permet l'expansion de la liberté de
pensée et du scepticisme selon lequel les systèmes religieux conduisent à la superstition.
C’est en effet
le cas puisque, par définition, le croyant ne peut savoir si ce qu’il croit est vrai et, grâce ou à cause des
livres sacrés, des prophètes etc., il se comporte comme s’il avait la preuve que sa croyance est juste.
Or,
il n’en sait rien.
Comment savoir si tel ou tel rituel de telle ou telle religion appartient au vrai ? On ne peut
pas.
Pourtant, malgré ces deux thèses qui s’opposent radicalement, il existe pour certaines minorités une
façon de penser qui leur est propre et qui, parce que réprimée dans
les trois religions monothéistes (Christianisme, Islam et Judaïsme) pourrait être une philosophie
rationnelle du Divin.
Dans la communauté des Soufis par exemple, les rites sont inutiles s'ils ne sont pas
accomplis avec sincérité.
C’est ce que démontre la théorie d’Al-Farabi, homme de pensée du Moyen -âge
aussi connu sous le nom de Ibn’Sinna.
Il affirme que « Dieu n’est comparable à rien » (nom du verset qui fait référence à l’acceptation par le
cœur), ainsi, l’athée est d’accord puisque ce qui n’est rien n’est comparable à rien et le croyant est lui
aussi convaincu puisque tout ce qui est comparé à Dieu s’anéantit.
Il s’agit d’une proposition qu’on ne
peut démontrer, qui est donc considérée comme évidente en soi et dont la vérité est par conséquent
prise pour accordée : c’est un axiome.
Ensuite, si Dieu n’est comparable à rien, il n’est donc égal à rien et
ne diffère de rien.
Autrement dit, Dieu est partout.
On constate alors que l’existence de Dieu est soumise.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Introduction « ô je fus comme fou » de Victor Hugo :
- AMOUR FOU (l') d'André Breton
- FOU D'ELSA (Le) de LoUis ARAGON (résumé & analyse)
- Fou D'Elsa (le) de Louis Aragon (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Le Fou d'Elsa d'Aragon (résumé & analyse)