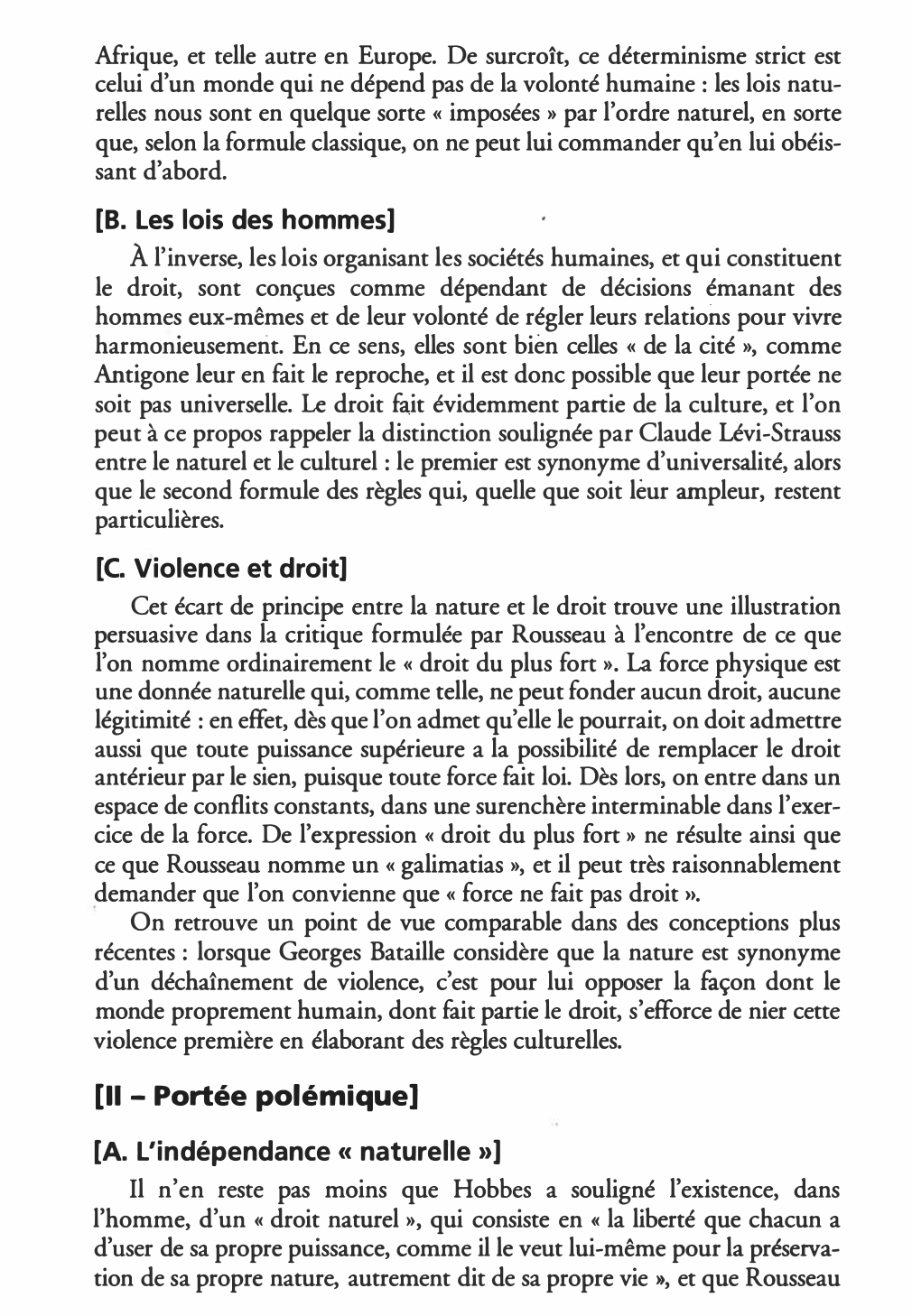Le droit n'est-il que culturel ?
Publié le 14/07/2012

Extrait du document

Le droit n'est-il que culturel ?

«
Afrique,
et telle autre en Europe.
De surcroît, ce déterminisme strict est
celui d'un monde qui ne dépend pas de la volonté humaine : les lois natu
relles nous sont en quelque sorte « imposées » par l'ordre naturel, en sone
que, selon la formule classique, on ne peut lui commander qu'en lui obéis
sant d'abord.
[B.
Les lois des homme s]
À l'inverse, les lois organisant les sociétés humaines, et qui constituent
le droit, sont conçues comme dépendant de décisions émanant des
hommes eux-mêmes et de leur volonté de régler leurs relations pour vivre
harmonieusement.
En ce sens, elles sont bièn celles « de la cité », comme
Antigone leur en fait le reproche, et il est donc possible que leur portée ne
soit pas universelle.
Le droit fait évidemment partie de la culture, et l'on
peut à ce propos rappeler la distinction soulignée par Claude Lévi-Strauss
entre le naturel et le culturel :le premier est synonyme d'universalité, alors
que le second formule des règles qui, quelle que soit lèur ampleur, restent
particulières.
[C.
Violenc e et droit]
Cet écart de principe entre la nature et le droit trouve une illustration
persuasive dans la critique formulée par Rousseau à l'encontre de ce que
l'on nomme ordinairement le« droit du plus fon ».
La force physique est
une donnée naturelle qui, comme telle, ne peut fonder aucun droit, aucune
légitimité : en effet, dès que l'on admet qu'elle le pourrait, on doit admettre
aussi que toute puissance supérieure a la possibilité de remplacer le droit
antérieur par le sien, puisque toute force fait loi.
Dès lors, on entre dans un
espace de conflits constants, dans une surenchère interminable dans l' exer
cice de la force.
De l'expression « droit du plus fon » ne résulte ainsi que
ce que Rousseau nomme un « galimatias », et il peut très raisonnablement
demander que l'on convienne que« fo rce ne fait pas droit >>.
On retrouve un point de vue comparable dans des conceptions plus
récentes : lorsque Georges Bataille considère que la nature est synonyme
d'un décha înement de violence, c'est pour lui opposer la façon dont le
monde proprement humain, dont fait partie le droit, s'eff orce de nier cette
violence première en élaborant des règles culturelles.
[Il -Portée po lémique]
[A.
L'ind épendanc e.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation de droit : La hiérarchie des normes
- De manière traditionnelle le droit constitutionnel a pour objet l’Etat et la Constitution. Pourquoi ?
- Révision DIE DUE PARTIE I - les caractéristiques du droit de l’UE
- Droit public des biens - Commentaire d’arrêt Conseil d'Etat, 18 septembre 2015, société Prest’Air req. N° 387315
- Droit et marché du travail