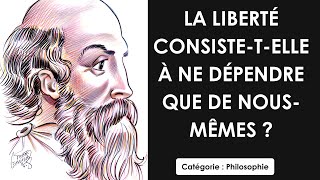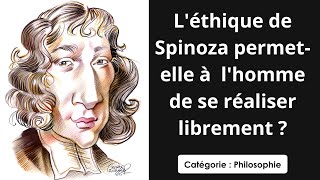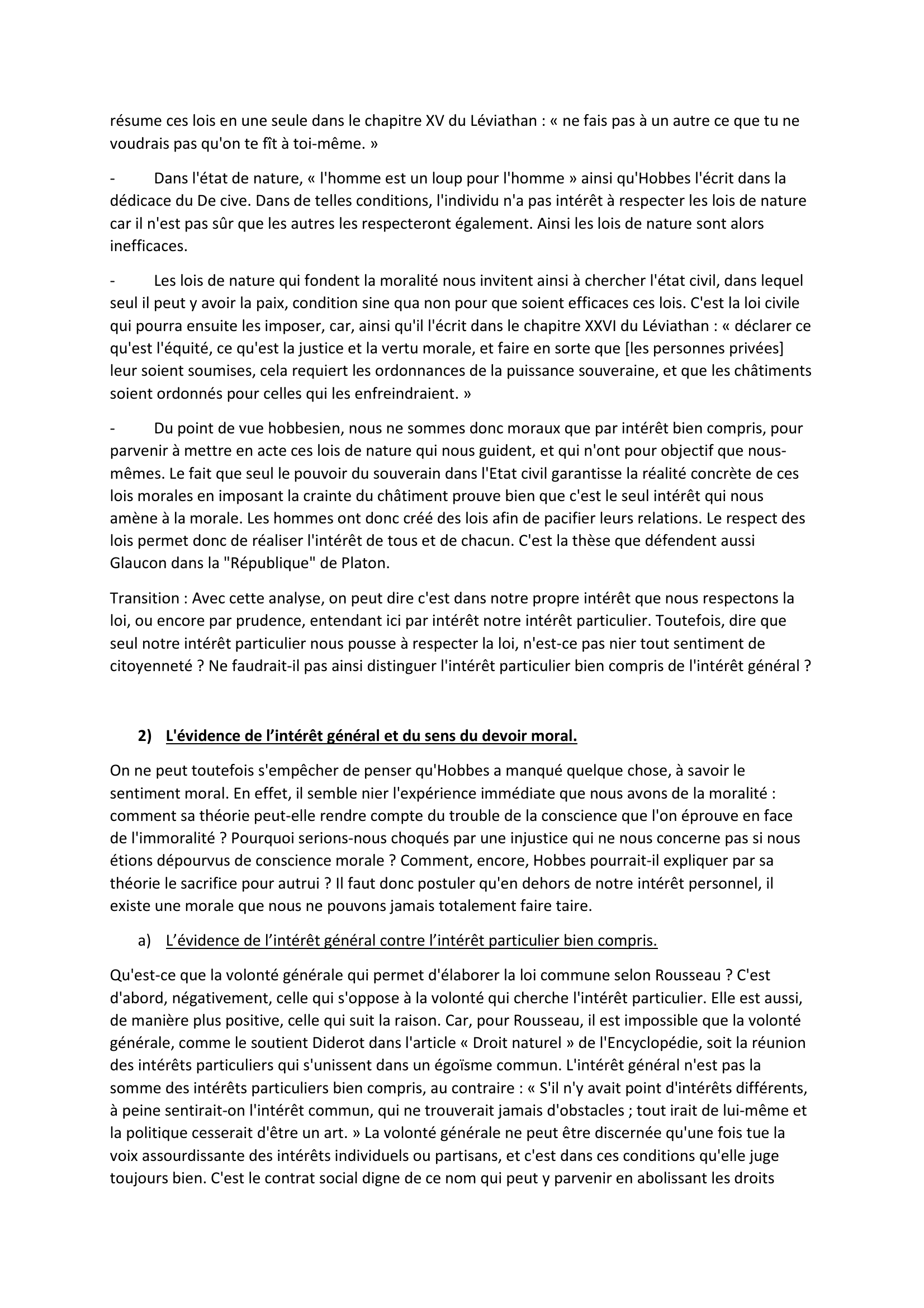Le respect de la loi est-il réductible à l'intérêt bien compris ?
Publié le 03/08/2005
Extrait du document
BIEN (lat. bene, bien; bonus, bon)
Phi. Ce qui est objet d'approbation ou de satisfaction. Pour les Anciens, le Bien est la finalité naturelle de la volonté, étant d'abord ce qui fait du bien, le profitable. Le problème éthique essentiel est alors de distinguer les « faux biens », les biens trompeurs qu'on recherche tant qu'on ignore qu'ils n'en sont pas, des « vrais biens », ceux qui nous sont vraiment utiles. Mot Le Bien se définit comme la norme suprême dans l'ordre éthique, ce vers quoi doit tendre toute action morale.
INTÉRÊT (lat. interest, il importe)
Désigne ce qui est utile à un individu (l'intérêt personnel) ou bien l'ensemble des intérêts communs aux différents individu qui composent une société (l'intérêt général qui n'est donc pas la somme des intérêts particuliers). Les morales de l'intérêt, dites utilitaristes, définissent le Bien par l'utile, tandis que la morale formelle de Kant juge la moralité d'un acte à l'intention désintéressée de l'agent et non à ses conséquences effectives. En ce sens, le devoir exclut le souci de ce qui est utile à soi, même si parfois obligation morale et intérêt coïncident.
Épist. Les lois scientifiques établissent entre les faits des rapports mesurables, universels, nécessaires, qui autorisent la prévision. Voir déterminisme. Mor. La loi morale est la règle normative dictée à l'homme par sa raison pratique. Elle énonce le principe d'action universel et obligatoire auquel tout être raisonnable doit conformer ses actes pour réaliser son autonomie. devoir, impératif. Phi. pol. La loi civile est la règle ou l'ensemble des règles coercitives établies par l'autorité souveraine d'une société. droit positif. La loi naturelle droit naturel.
RESPECT (lat. respectus, considération, égard)
Sentiment que suscite la libre reconnaissance d'une valeur morale, et qui constitue, selon Kant, le mobile de la raison pratique. Le respect se distingue donc de tout autre sentiment en ce qu'il n'est pas un effet de la sensibilité mais l'effet de la loi morale sur le sujet qui se détermine à lui obéir par lui-même (autonomie). C'est ainsi que le respect, en tant qu'obéissance libre, s'oppose à la crainte. devoir.
BIEN: Au sens éthique, ce qui est conforme à l'idéal de la moralité, qui doit être recherché pour lui-même indépendamment de son utilité. Il mérite l'approbation d'une conscience droite. Sa possession seule peut procurer le bonheur (ou souverain Bien).
« résum e cesloisen une seule dansle chapitre X V du L éviathan :« ne faispasà un autre ce que tu ne voudraispasqu'on te fîtà toi-m êm e.» - Dansl'étatde nature,« l'hom m e estun loup pourl'hom m e » ainsiqu'Hobbesl'écritdansla dédicace du De cive.Dansde tellesconditions,l'individu n'apasintérêtà respecterlesloisde nature cariln'estpassû rque lesautreslesrespecterontégalem ent.A insilesloisde nature sontalors inefficaces. - L esloisde nature quifondentlam oralité nousinvitentainsià chercherl'étatcivil,danslequel seulilpeuty avoirlapaix,condition sine quanon pourque soientefficacesceslois.C 'estlaloicivile quipourraensuite lesim poser,car,ainsiqu'ill'écritdansle chapitre X X VIdu L éviathan :« déclarerce qu'estl'équité,ce qu'estlajustice etlavertu m orale,etfaire en sorte que [lespersonnesprivées] leursoientsoum ises,celarequiertlesordonnancesde lapuissance souveraine,etque leschâtim ents soientordonnéspourcellesquilesenfreindraient.» - Du pointde vue hobbesien,nousne som m esdoncm oraux que parintérêtbien com pris,pour parvenirà m ettre en acte cesloisde nature quinousguident,etquin'ontpourobjectifque nous- m êm es.L e faitque seulle pouvoirdu souverain dansl'Etatcivilgarantisse laréalité concrète de ces loism oralesen im posantlacrainte du châtim entprouve bien que c'estle seulintérêtquinous am ène à lam orale.L eshom m esontdonccréé desloisafin de pacifierleursrelations.L e respectdes loisperm etdoncde réaliserl'intérêtde tousetde chacun.C 'estlathèse que défendentaussi Glaucon dansla"R épublique" de P laton. T ransition :A veccette analyse,on peutdire c'estdansnotre propre intérêtque nousrespectonsla loi,ou encore parprudence,entendanticiparintérêtnotre intérêtparticulier.T outefois,dire que seulnotre intérêtparticuliernouspousse à respecterlaloi,n'est-ce pasniertoutsentim entde citoyenneté ? N e faudrait-ilpasainsidistinguerl'intérêtparticulierbien com prisde l'intérêtgénéral? 2) L 'évidence de l’intérêtgénéraletdu sensdu devoirm oral. O n ne peuttoutefoiss'em pêcherde penserqu'Hobbesam anqué quelque chose,à savoirle sentim entm oral.En effet,ilsem ble nierl'expérience im m édiate que nousavonsde lam oralité : com m entsathéorie peut-elle rendre com pte du trouble de laconscience que l'on éprouve en face de l'im m oralité ? P ourquoiserions-nouschoquésparune injustice quine nousconcerne passinous étionsdépourvusde conscience m orale ? C om m ent,encore,Hobbespourrait-ilexpliquerparsa théorie le sacrifice pourautrui? Ilfautdoncpostulerqu'en dehorsde notre intérêtpersonnel,il existe une m orale que nousne pouvonsjam aistotalem entfaire taire. a) L ’évidence de l’intérêtgénéralcontre l’intérêtparticulierbien com pris. Q u'est-ce que lavolonté générale quiperm etd'élaborerlaloicom m une selon R ousseau ? C 'est d'abord,négativem ent,celle quis'oppose à lavolonté quicherche l'intérêtparticulier.Elle estaussi, de m anière pluspositive,celle quisuitlaraison.C ar,pourR ousseau,ilestim possible que lavolonté générale,com m e le soutientDiderotdansl'article « Droitnaturel» de l'Encyclopédie,soitlaréunion desintérêtsparticuliersquis'unissentdansun égoïsm e com m un.L 'intérêtgénéraln'estpasla som m e desintérêtsparticuliersbien com pris,au contraire :« S 'iln'y avaitpointd'intérêtsdifférents, à peine sentirait-on l'intérêtcom m un,quine trouveraitjam aisd'obstacles;toutiraitde lui-m êm e et lapolitique cesseraitd'être un art.» L avolonté générale ne peutêtre discernée qu'une foistue la voix assourdissante desintérêtsindividuelsou partisans,etc'estdanscesconditionsqu'elle juge toujoursbien.C 'estle contratsocialdigne de ce nom quipeuty parveniren abolissantlesdroits. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La loi d'intérêt dans la vie psychologique.
- Être en conformité avec la loi, dans ses actes ou ses revendications, suffit-il pour mesurer ce qui est juste, ce qui est dû à l'autre ? La justice n'exige-t-elle pas autre chose que le respect du droit ?
- L'idéal de justice, doit il passer avant le respect de la loi ?
- Le droit est-il réductible à l'intérêt ?
- La loi d'intérêt dans la vie psychologique.