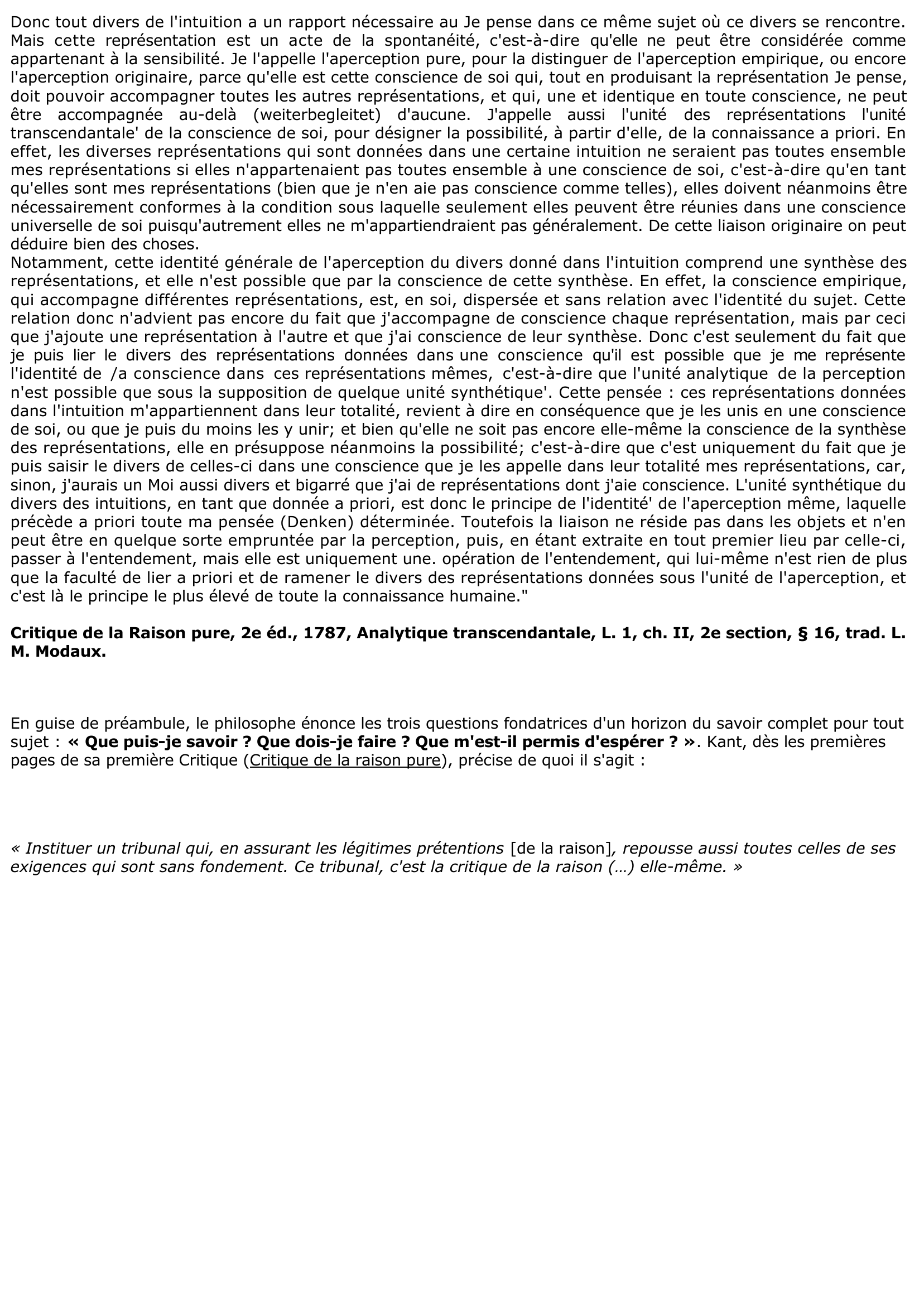Le sujet chez Kant
Publié le 20/08/2011

Extrait du document

Seul l'homme est sujet ! Descartes et à sa suite Kant (1724 - 1804), nous permettrons de bien comprendre cela : l'homme a en effet cette particularité de se positionner, consciemment, comme sujet connaissant face à l'objet connu ; l'animal ou le végétal en sont incapables.
Cette conscience de soi – unité du sujet qui dit « Je « – donne à Kant l'idée directrice de son œuvre inaugurale de l'esprit du « siècle des Lumières «. Il s'agit d'opérer une « critique « complète du sujet rationnel : comprendre – en discernant et en légitimant ses potentiels de connaissance (raison pure), d'action (raison pratique) et de jugement (faculté de juger) – l'exacte nature des facultés humaines que sont l' « entendement « et la « raison «.

«
Donc tout divers de l'intuition a un rapport nécessaire au Je pense dans ce même sujet où ce divers se rencontre.Mais cette représentation est un acte de la spontanéité, c'est-à-dire qu'elle ne peut être considérée commeappartenant à la sensibilité.
Je l'appelle l'aperception pure, pour la distinguer de l'aperception empirique, ou encorel'aperception originaire, parce qu'elle est cette conscience de soi qui, tout en produisant la représentation Je pense,doit pouvoir accompagner toutes les autres représentations, et qui, une et identique en toute conscience, ne peutêtre accompagnée au-delà (weiterbegleitet) d'aucune.
J'appelle aussi l'unité des représentations l'unitétranscendantale' de la conscience de soi, pour désigner la possibilité, à partir d'elle, de la connaissance a priori.
Eneffet, les diverses représentations qui sont données dans une certaine intuition ne seraient pas toutes ensemblemes représentations si elles n'appartenaient pas toutes ensemble à une conscience de soi, c'est-à-dire qu'en tantqu'elles sont mes représentations (bien que je n'en aie pas conscience comme telles), elles doivent néanmoins êtrenécessairement conformes à la condition sous laquelle seulement elles peuvent être réunies dans une conscienceuniverselle de soi puisqu'autrement elles ne m'appartiendraient pas généralement.
De cette liaison originaire on peutdéduire bien des choses.Notamment, cette identité générale de l'aperception du divers donné dans l'intuition comprend une synthèse desreprésentations, et elle n'est possible que par la conscience de cette synthèse.
En effet, la conscience empirique,qui accompagne différentes représentations, est, en soi, dispersée et sans relation avec l'identité du sujet.
Cetterelation donc n'advient pas encore du fait que j'accompagne de conscience chaque représentation, mais par cecique j'ajoute une représentation à l'autre et que j'ai conscience de leur synthèse.
Donc c'est seulement du fait queje puis lier le divers des représentations données dans une conscience qu'il est possible que je me représentel'identité de /a conscience dans ces représentations mêmes, c'est-à-dire que l'unité analytique de la perceptionn'est possible que sous la supposition de quelque unité synthétique'.
Cette pensée : ces représentations donnéesdans l'intuition m'appartiennent dans leur totalité, revient à dire en conséquence que je les unis en une consciencede soi, ou que je puis du moins les y unir; et bien qu'elle ne soit pas encore elle-même la conscience de la synthèsedes représentations, elle en présuppose néanmoins la possibilité; c'est-à-dire que c'est uniquement du fait que jepuis saisir le divers de celles-ci dans une conscience que je les appelle dans leur totalité mes représentations, car,sinon, j'aurais un Moi aussi divers et bigarré que j'ai de représentations dont j'aie conscience.
L'unité synthétique dudivers des intuitions, en tant que donnée a priori, est donc le principe de l'identité' de l'aperception même, laquelleprécède a priori toute ma pensée (Denken) déterminée.
Toutefois la liaison ne réside pas dans les objets et n'enpeut être en quelque sorte empruntée par la perception, puis, en étant extraite en tout premier lieu par celle-ci,passer à l'entendement, mais elle est uniquement une.
opération de l'entendement, qui lui-même n'est rien de plusque la faculté de lier a priori et de ramener le divers des représentations données sous l'unité de l'aperception, etc'est là le principe le plus élevé de toute la connaissance humaine."
Critique de la Raison pure, 2e éd., 1787, Analytique transcendantale, L.
1, ch.
II, 2e section, § 16, trad.
L.M.
Modaux.
En guise de préambule, le philosophe énonce les trois questions fondatrices d'un horizon du savoir complet pour toutsujet : « Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? » .
Kant, dès les premières pages de sa première Critique ( Critique de la raison pure ), précise de quoi il s'agit :
« Instituer un tribunal qui, en assurant les légitimes prétentions [de la raison] , repousse aussi toutes celles de ses exigences qui sont sans fondement.
Ce tribunal, c'est la critique de la raison (…) elle-même.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- → Support : Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 1785
- Kant, Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ?
- Je dus abolir le savoir afin d'obtenir une place pour la croyance Emmanuel Kant (1724-1804)