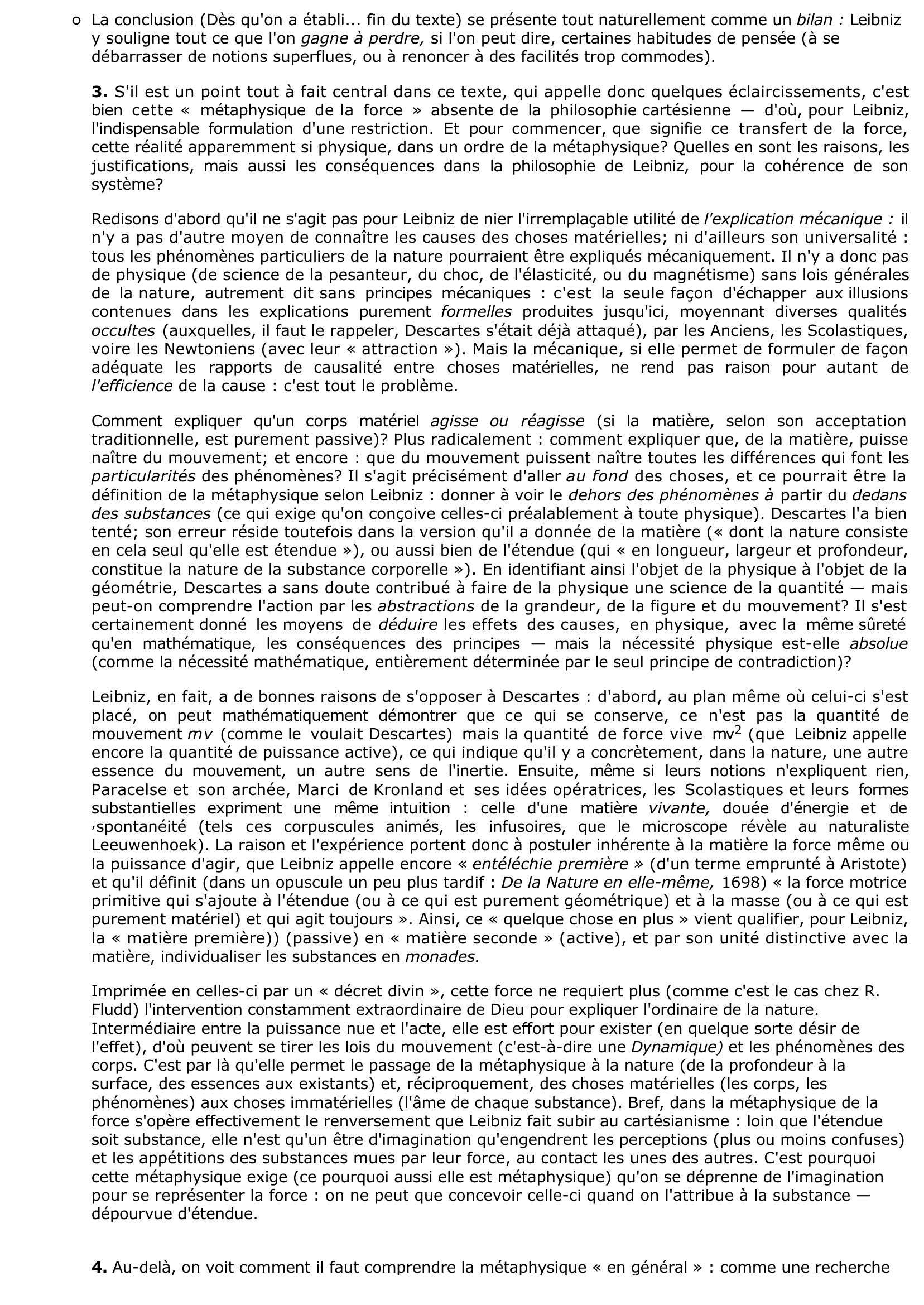LEIBNIZ: Descartes et le mouvement...
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
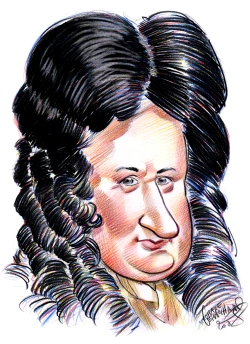
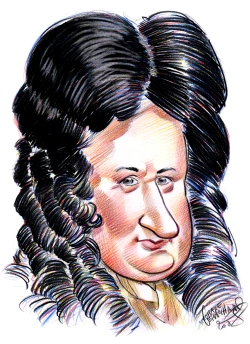
«
La conclusion (Dès qu'on a établi...
fin du texte) se présente tout naturellement comme un bilan : Leibniz y souligne tout ce que l'on gagne à perdre, si l'on peut dire, certaines habitudes de pensée (à se débarrasser de notions superflues, ou à renoncer à des facilités trop commodes).
3.
S'il est un point tout à fait central dans ce texte, qui appelle donc quelques éclaircissements, c'estbien cette « métaphysique de la force » absente de la philosophie cartésienne — d'où, pour Leibniz,l'indispensable formulation d'une restriction.
Et pour commencer, que signifie ce transfert de la force,cette réalité apparemment si physique, dans un ordre de la métaphysique? Quelles en sont les raisons, lesjustifications, mais aussi les conséquences dans la philosophie de Leibniz, pour la cohérence de sonsystème?
Redisons d'abord qu'il ne s'agit pas pour Leibniz de nier l'irremplaçable utilité de l'explication mécanique : il n'y a pas d'autre moyen de connaître les causes des choses matérielles; ni d'ailleurs son universalité :tous les phénomènes particuliers de la nature pourraient être expliqués mécaniquement.
Il n'y a donc pasde physique (de science de la pesanteur, du choc, de l'élasticité, ou du magnétisme) sans lois généralesde la nature, autrement dit sans principes mécaniques : c'est la seule façon d'échapper aux illusionscontenues dans les explications purement formelles produites jusqu'ici, moyennant diverses qualités occultes (auxquelles, il faut le rappeler, Descartes s'était déjà attaqué), par les Anciens, les Scolastiques, voire les Newtoniens (avec leur « attraction »).
Mais la mécanique, si elle permet de formuler de façonadéquate les rapports de causalité entre choses matérielles, ne rend pas raison pour autant del'efficience de la cause : c'est tout le problème.
Comment expliquer qu'un corps matériel agisse ou réagisse (si la matière, selon son acceptation traditionnelle, est purement passive)? Plus radicalement : comment expliquer que, de la matière, puissenaître du mouvement; et encore : que du mouvement puissent naître toutes les différences qui font lesparticularités des phénomènes? Il s'agit précisément d'aller au fond des choses, et ce pourrait être la définition de la métaphysique selon Leibniz : donner à voir le dehors des phénomènes à partir du dedans des substances (ce qui exige qu'on conçoive celles-ci préalablement à toute physique).
Descartes l'a bien tenté; son erreur réside toutefois dans la version qu'il a donnée de la matière (« dont la nature consisteen cela seul qu'elle est étendue »), ou aussi bien de l'étendue (qui « en longueur, largeur et profondeur,constitue la nature de la substance corporelle »).
En identifiant ainsi l'objet de la physique à l'objet de la géométrie, Descartes a sans doute contribué à faire de la physique une science de la quantité — maispeut-on comprendre l'action par les abstractions de la grandeur, de la figure et du mouvement? Il s'est certainement donné les moyens de déduire les effets des causes, en physique, avec la même sûreté qu'en mathématique, les conséquences des principes — mais la nécessité physique est-elle absolue (comme la nécessité mathématique, entièrement déterminée par le seul principe de contradiction)?
Leibniz, en fait, a de bonnes raisons de s'opposer à Descartes : d'abord, au plan même où celui-ci s'estplacé, on peut mathématiquement démontrer que ce qui se conserve, ce n'est pas la quantité demouvement mv (comme le voulait Descartes) mais la quantité de force vive mv 2 (que Leibniz appelle encore la quantité de puissance active), ce qui indique qu'il y a concrètement, dans la nature, une autreessence du mouvement, un autre sens de l'inertie.
Ensuite, même si leurs notions n'expliquent rien,Paracelse et son archée, Marci de Kronland et ses idées opératrices, les Scolastiques et leurs formessubstantielles expriment une même intuition : celle d'une matière vivante, douée d'énergie et de ,spontanéité (tels ces corpuscules animés, les infusoires, que le microscope révèle au naturalisteLeeuwenhoek).
La raison et l'expérience portent donc à postuler inhérente à la matière la force même oula puissance d'agir, que Leibniz appelle encore « entéléchie première » (d'un terme emprunté à Aristote) et qu'il définit (dans un opuscule un peu plus tardif : De la Nature en elle-même, 1698) « la force motrice primitive qui s'ajoute à l'étendue (ou à ce qui est purement géométrique) et à la masse (ou à ce qui estpurement matériel) et qui agit toujours ».
Ainsi, ce « quelque chose en plus » vient qualifier, pour Leibniz,la « matière première)) (passive) en « matière seconde » (active), et par son unité distinctive avec lamatière, individualiser les substances en monades.
Imprimée en celles-ci par un « décret divin », cette force ne requiert plus (comme c'est le cas chez R.Fludd) l'intervention constamment extraordinaire de Dieu pour expliquer l'ordinaire de la nature.Intermédiaire entre la puissance nue et l'acte, elle est effort pour exister (en quelque sorte désir del'effet), d'où peuvent se tirer les lois du mouvement (c'est-à-dire une Dynamique) et les phénomènes des corps.
C'est par là qu'elle permet le passage de la métaphysique à la nature (de la profondeur à lasurface, des essences aux existants) et, réciproquement, des choses matérielles (les corps, lesphénomènes) aux choses immatérielles (l'âme de chaque substance).
Bref, dans la métaphysique de laforce s'opère effectivement le renversement que Leibniz fait subir au cartésianisme : loin que l'étenduesoit substance, elle n'est qu'un être d'imagination qu'engendrent les perceptions (plus ou moins confuses)et les appétitions des substances mues par leur force, au contact les unes des autres.
C'est pourquoicette métaphysique exige (ce pourquoi aussi elle est métaphysique) qu'on se déprenne de l'imaginationpour se représenter la force : on ne peut que concevoir celle-ci quand on l'attribue à la substance —dépourvue d'étendue.
4.
Au-delà, on voit comment il faut comprendre la métaphysique « en général » : comme une recherche.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LEIBNIZ, Remarques sur Descartes. EXPLICATION DE TEXTE
- Philosophie : la notion d'évidence chez Descartes et Leibniz Introduction
- Philosophie : la notion d'évidence chez Descartes et Leibniz
- LEIBNIZ CONTRE DESCARTES.
- DESCARTES: La figure, la grandeur, le mouvement, le lieu, le temps