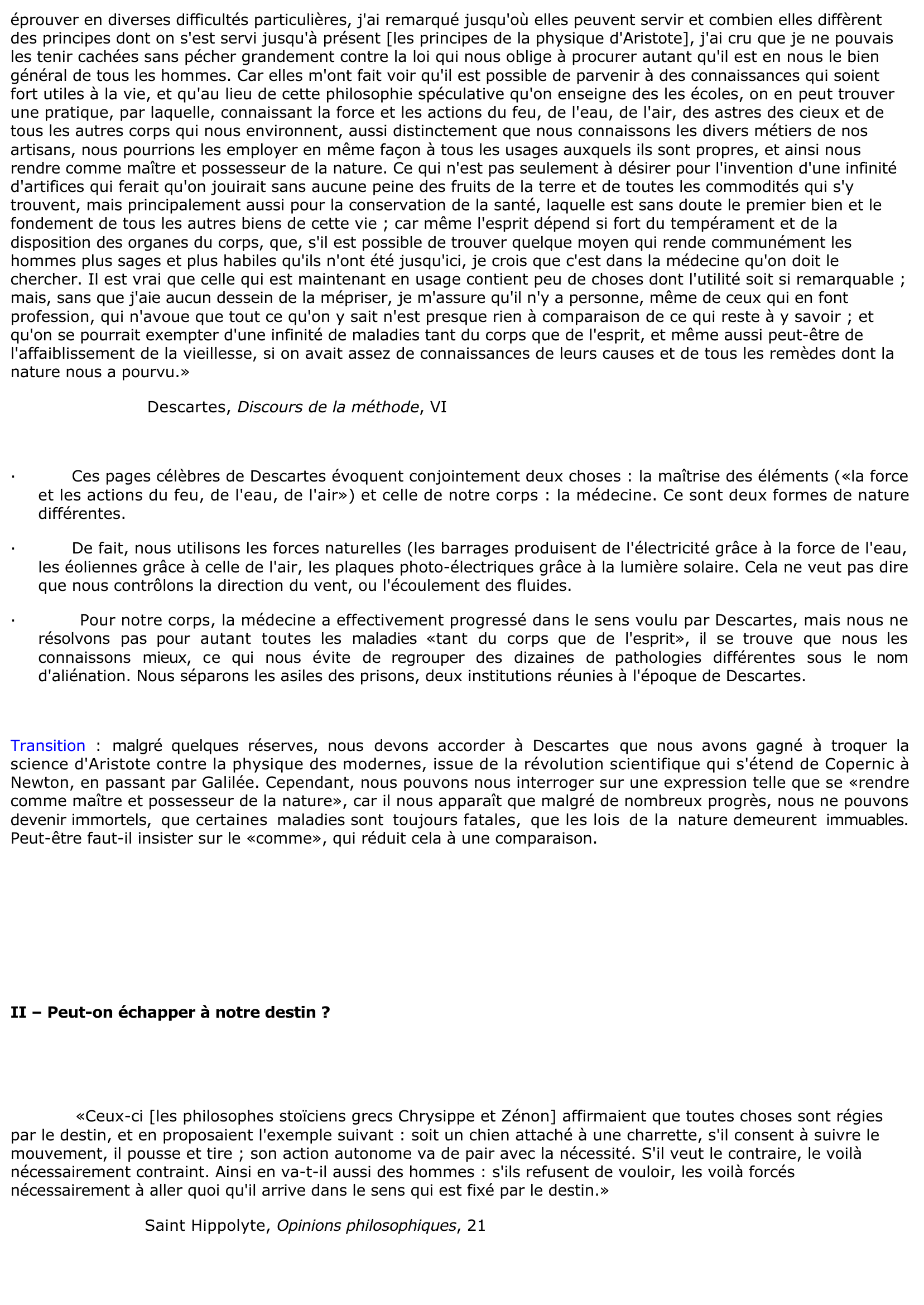Les sciences nous rendent-elles maîtres de notre destin ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
«
éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent servir et combien elles diffèrentdes principes dont on s'est servi jusqu'à présent [les principes de la physique d'Aristote], j'ai cru que je ne pouvaisles tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le biengénéral de tous les hommes.
Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soientfort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne des les écoles, on en peut trouverune pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres des cieux et detous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nosartisans, nous pourrions les employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nousrendre comme maître et possesseur de la nature.
Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinitéd'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'ytrouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et lefondement de tous les autres biens de cette vie ; car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de ladisposition des organes du corps, que, s'il est possible de trouver quelque moyen qui rende communément leshommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit lechercher.
Il est vrai que celle qui est maintenant en usage contient peu de choses dont l'utilité soit si remarquable ;mais, sans que j'aie aucun dessein de la mépriser, je m'assure qu'il n'y a personne, même de ceux qui en fontprofession, qui n'avoue que tout ce qu'on y sait n'est presque rien à comparaison de ce qui reste à y savoir ; etqu'on se pourrait exempter d'une infinité de maladies tant du corps que de l'esprit, et même aussi peut-être del'affaiblissement de la vieillesse, si on avait assez de connaissances de leurs causes et de tous les remèdes dont lanature nous a pourvu.»
Descartes, Discours de la méthode , VI
· Ces pages célèbres de Descartes évoquent conjointement deux choses : la maîtrise des éléments («la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air») et celle de notre corps : la médecine.
Ce sont deux formes de naturedifférentes.
· De fait, nous utilisons les forces naturelles (les barrages produisent de l'électricité grâce à la force de l'eau, les éoliennes grâce à celle de l'air, les plaques photo-électriques grâce à la lumière solaire.
Cela ne veut pas direque nous contrôlons la direction du vent, ou l'écoulement des fluides.
· Pour notre corps, la médecine a effectivement progressé dans le sens voulu par Descartes, mais nous ne résolvons pas pour autant toutes les maladies «tant du corps que de l'esprit», il se trouve que nous lesconnaissons mieux, ce qui nous évite de regrouper des dizaines de pathologies différentes sous le nomd'aliénation.
Nous séparons les asiles des prisons, deux institutions réunies à l'époque de Descartes.
Transition : malgré quelques réserves, nous devons accorder à Descartes que nous avons gagné à troquer la science d'Aristote contre la physique des modernes, issue de la révolution scientifique qui s'étend de Copernic àNewton, en passant par Galilée.
Cependant, nous pouvons nous interroger sur une expression telle que se «rendrecomme maître et possesseur de la nature», car il nous apparaît que malgré de nombreux progrès, nous ne pouvonsdevenir immortels, que certaines maladies sont toujours fatales, que les lois de la nature demeurent immuables.Peut-être faut-il insister sur le «comme», qui réduit cela à une comparaison.
II – Peut-on échapper à notre destin ?
«Ceux-ci [les philosophes stoïciens grecs Chrysippe et Zénon] affirmaient que toutes choses sont régiespar le destin, et en proposaient l'exemple suivant : soit un chien attaché à une charrette, s'il consent à suivre lemouvement, il pousse et tire ; son action autonome va de pair avec la nécessité.
S'il veut le contraire, le voilànécessairement contraint.
Ainsi en va-t-il aussi des hommes : s'ils refusent de vouloir, les voilà forcésnécessairement à aller quoi qu'il arrive dans le sens qui est fixé par le destin.»
Saint Hippolyte, Opinions philosophiques , 21.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les sciences nous rendent-elles maîtres de notre destin ?
- Les hommes sont-ils maîtres de leur propre destin ?
- Sujet Les sciences rendent elle inutiles la recherche philosophique ?
- Les sciences rendent elle inutiles la recherche philosophique ?
- Lénine par Hélène Carrère d'Encausse Maître de Recherche à la Fondation Nationale des Sciences Politiques Le destin de Lénine, de son véritable nom Vladimir Ilitch Oulianov, son existence, se confondent avec la révolution, aussi loin qu'on les considère.