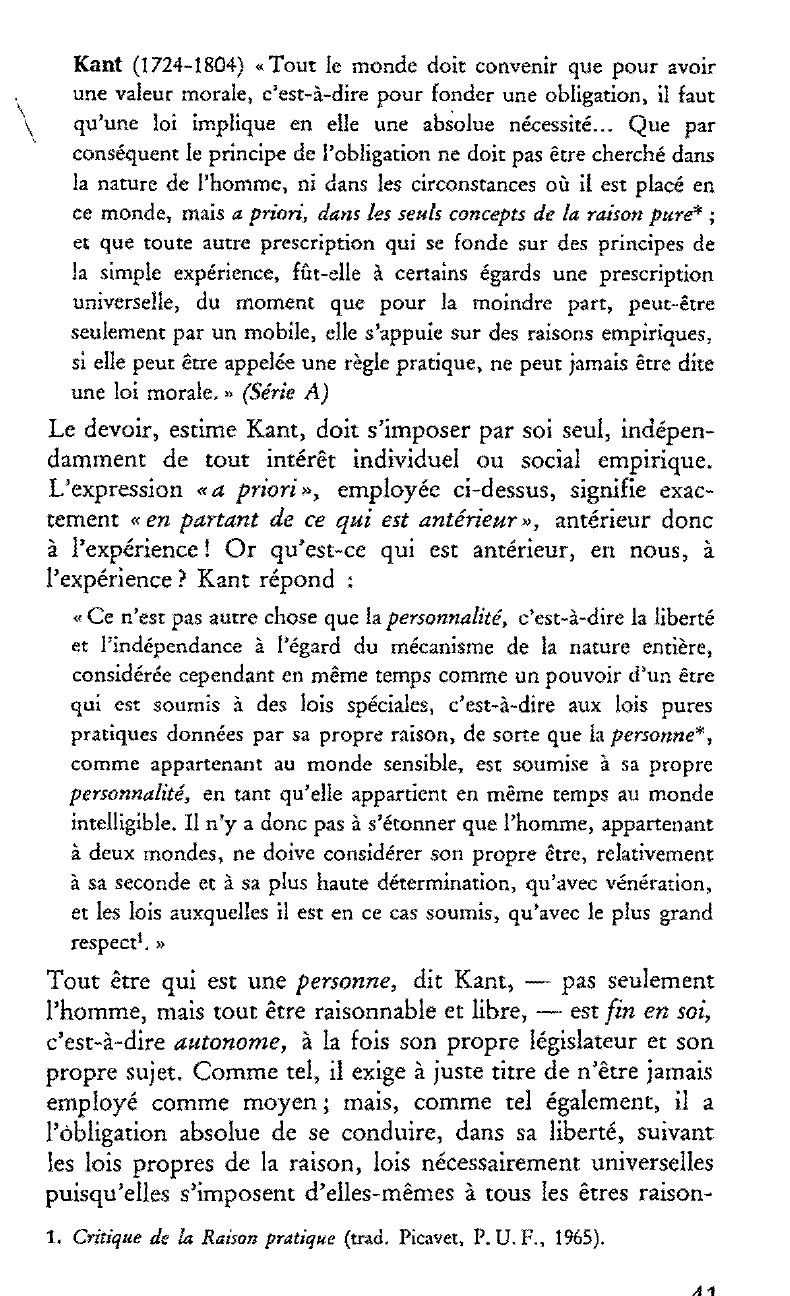Les valeurs terrestres
Publié le 25/01/2020

Extrait du document
Nietzsche (1844-1900) «Sans doute la plupart des hommes préfèrent-ils un commandement sans condition à une règle conditionnée : l’absolu les dispense de se servir de leur intelligence et flatte leur paresse ; souvent, il correspond aussi à une tendance à l’entêtement et plaît aux personnes qui ont coutume de se vanter de leur caractère. L’impératif catégorique rentre dans le domaine de l’obéissance militaire, aveugle, telle que les princes l’ont cultivée chez l’homme : ceux-ci croient que la sécurité et l’ordre sont plus grands lorsqu’on commande absolument. C’est pourquoi on désire que l’impératif moral soit également catégorique, car on croit que, de la sorte, il est le plus utile à la morale. On désire l’impératif catégorique : c’est-à-dire on désire qu’un maître absolu soit constitué par la volonté des individus nombreux qui ont peur de soi et peur de leur voisin : ce maître doit exercer une dictature morale. Si l’on n’avait pas cette crainte, on n’aurait pas besoin de ce maître. » (Série B)
Bergson (1859-1941) «La consigne militaire, qui est un ordre non motivé et sans réplique, dit bien qu’« il faut parce qu’il faut ». Mais on a beau ne pas donner au soldat de raison, il en imaginera une... N’est-il pas évident que, chez un être raisonnable, un impératif tendra d’autant plus à prendre la forme catégorique que l’activité déployée, encore qu’intelligente, tendra davantage à prendre la forme instinctive? Mais une activité qui, d’abord intelligente, s’achemine à une imitation de l’instinct est précisément ce qu’on appelle chez l’homme une habitude. Et l’habitude la plus puissante, celle dont la force est faite de toutes les forces accumulées de toutes les habitudes sociales élémentaires, est nécessairement celle qui imite le mieux l’instinct... Bref un impératif absolument catégorique est de nature instinctive ou somnambulique, puisque ma raison, prétendument à sa base, n’intervient en fait plus du tout1. »
L'IMPÉRATIF CATÉGORIQUE
D’où, pour ce qui est des hommes, les fameux préceptes de la Métaphysique des mœurs, énoncés de façon différente selon que Kant désire mettre l’accent sur la raison, la volonté, ou la dignité identique profonde de tous les humains :
«Agis toujours de telle sorte que ta maxime puisse être érigée en règle universelle. »
«Agis toujours comme si tu étais en même temps législateur et sujet de la république des volontés. »
« Agis toujours de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien en ta personne que dans celle d’autrui, comme fin et non pas seulement comme moyen. »
Cette fois, selon Kant, il s’agit bien d’un impératif catégorique, c’est-à-dire qui s’impose absolument, a priori, d’après les seuls concepts de «la loi pure pratique», La source du devoir, c’est la loi morale elle-même, et il ne peut pas y en avoir d’autre. Kant le répète constamment, même quand il s’exprime en termes de tous les jours.
«Ce n’est pas la, conduite des autres hommes, mais la loi*, qui doit nous servir de mobile. Le maître ne dira donc pas à un élève vicieux : prends exemple sur ce bon petit garçon si rangé! si studieux ! car cela ne servirait qu’à lui faire détester son camarade, relativement auquel il se trouverait ainsi placé dans un jour défavorable. Le bon exemple, la conduite exemplaire, ne doit pas servir de modèle, mais seulement de preuve pour montrer que ce qui est conforme au devoir est praticable. Ce n’est pas en comparant un homme avec un autre, considéré tel qu’il est, mais avec l’idée de ce qu’il doit être, du point de vue de l’humanité, c’est-à-dire avec la loi, que le maître trouvera une règle d’éducation qui ne trompe jamais. » (Séries C et D)
En fait, cette morale kantienne de la loi pure nous paraît se heurter à l’expérience psychologique courante. Quelles sont les circonstances où les hommes se sentent le plus fortement
«
Kant (1724-1804) «Tout le monde doit convenir que pour avoir
une valeur morale, c'est-à-dire pour fonder une obligation, il faut
qu'une loi implique en elle une absolue nécessité...
Que par
conséquent le principe de l'obligation ne doit pas être cherché dans
la nature de l'homme, ni dans les circonstances où il est placé en
ce monde, mais a priori, dans les seuls concepts de la raison pure* ;
et que toute autre prescription qui se fonde sur des principes de
la simple expérience, fût-elle à certains égards une prescription
universelle, du moment que pour la moindre part, peut-être
seulement par un mobile, elle s'appuie sur des raisons empiriques,
si elle peut être appelée une règle pratique, ne peut jamais être dite
une loi morale." (Série A)
Le devoir, estime Kant, doit s'imposer par soi seul, indépen
damment de tout intérêt individuel ou social empirique.
L'expression «a priori», employée ci-dessus, signifie exac
tement « en partant de ce qui est antérieur'" antérieur donc
à l'expérience! Or qu'est-ce qui est antérieur, en nous, à
l'expérience? Kant répond :
«Ce n'est pas autre chose que la personnalité, c'est-à-dire la liberté
et l'indépendance à l'égard du mécanisme de la nature entière,
considérée cependant en même temps comme un pouvoir d'un être
qui est soumis à des lois spéciales, c'est-à-dire aux lois pures
pratiques données par sa propre raison, de sorte que la personne*,
comme appartenant au monde sensible, est soumise à sa propre
personnalité, en tant qu'elle appartient en même temps au monde
intelligible.
li n'y a donc pas à s'étonner que l'homme, appartenant
à deux mondes, ne doive considérer son propre être, relativement
à sa seconde et à sa plus haute détermination, qu'avec vénération,
et les lois auxquelles il est en ce cas soumis, qu'avec le plus grand
respect 1• »
Tout être qui est une personne, dit Kant, pas seulement
l'homme, mais tout être raisonnable et libre, - est fin en soi,
c'est-à-dire autonome, à la fois son propre législateur et son
propre sujet.
Comme tel, il exige à juste titre de n'être jamais
employé comme moyen ; mais, comme tel également, il a
l'obligation absolue de se conduire, dans sa liberté, suivant
les lois propres de la raison, lois nécessairement universelles
puisqu'elles s'imposent d'elles-mêmes à tous les êtres raison-
1.
Critique de la Raison pratique (trad.
Pîcavet, P.
U.
F., 1965).
41.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- respects des valeurs coutumiéres dans sous l'orge
- exposé sur l'initiation aux valeurs traditionnels dans sous l'orage
- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dénonce l’accusation de Dreyfus : derrière cette accusation se cacherait de l’antisémitisme ce qui va à l’encontre des valeurs de la république.
- VOLONTÉ DE PUISSANCE (LA), Essai d’une transmutation de toutes les valeurs, Friedrich Wilhelm Nietzsche
- Nourritures terrestres (les) d'André Gide (analyse détaillée)