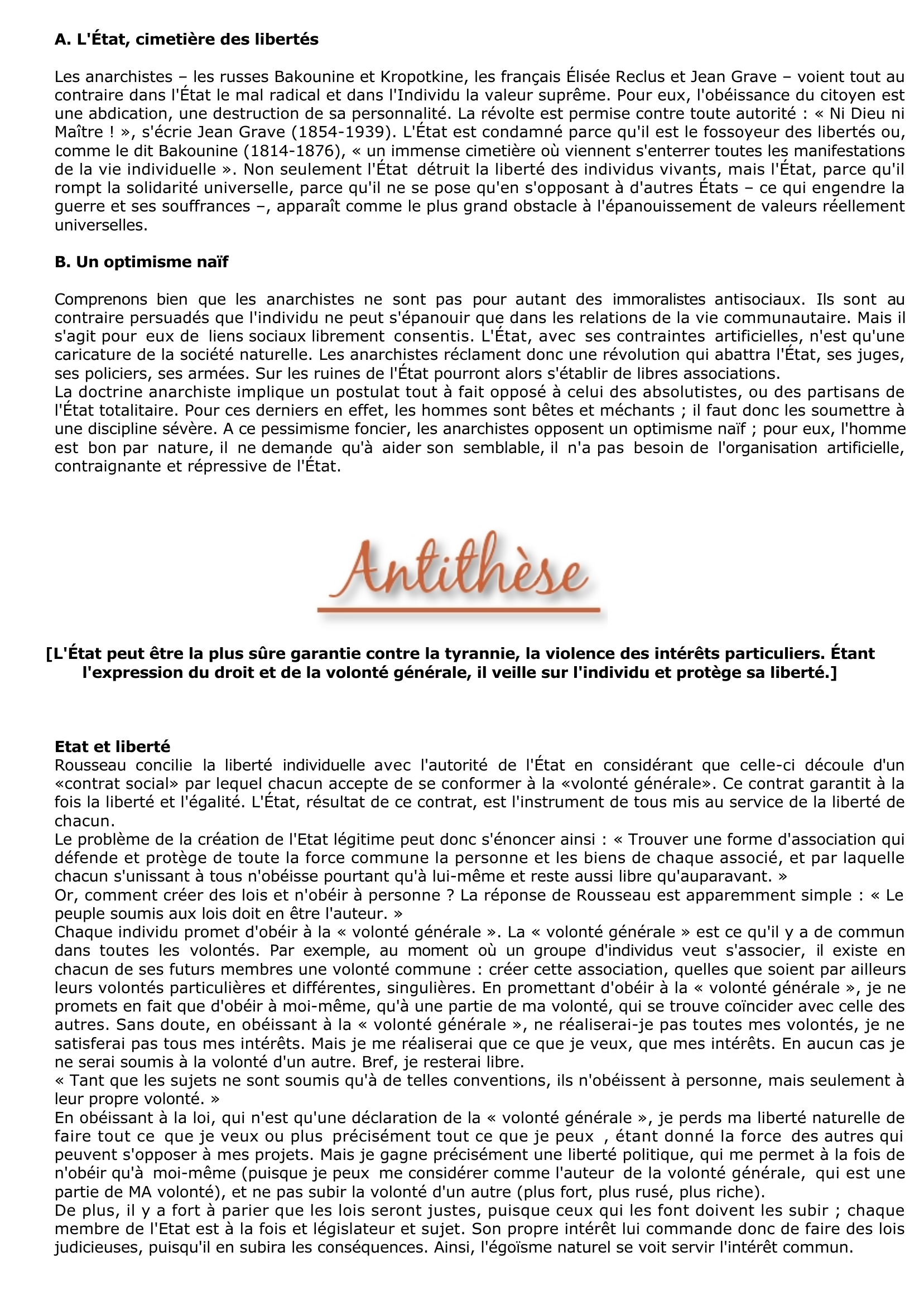L'état limite-il les libertés individuelles ou bien les rend-il possibles ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
«
A.
L'État, cimetière des libertés
Les anarchistes – les russes Bakounine et Kropotkine, les français Élisée Reclus et Jean Grave – voient tout aucontraire dans l'État le mal radical et dans l'Individu la valeur suprême.
Pour eux, l'obéissance du citoyen estune abdication, une destruction de sa personnalité.
La révolte est permise contre toute autorité : « Ni Dieu niMaître ! », s'écrie Jean Grave (1854-1939).
L'État est condamné parce qu'il est le fossoyeur des libertés ou,comme le dit Bakounine (1814-1876), « un immense cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestationsde la vie individuelle ».
Non seulement l'État détruit la liberté des individus vivants, mais l'État, parce qu'ilrompt la solidarité universelle, parce qu'il ne se pose qu'en s'opposant à d'autres États – ce qui engendre laguerre et ses souffrances –, apparaît comme le plus grand obstacle à l'épanouissement de valeurs réellementuniverselles.
B.
Un optimisme naïf
Comprenons bien que les anarchistes ne sont pas pour autant des immoralistes antisociaux.
Ils sont aucontraire persuadés que l'individu ne peut s'épanouir que dans les relations de la vie communautaire.
Mais ils'agit pour eux de liens sociaux librement consentis.
L'État, avec ses contraintes artificielles, n'est qu'unecaricature de la société naturelle.
Les anarchistes réclament donc une révolution qui abattra l'État, ses juges,ses policiers, ses armées.
Sur les ruines de l'État pourront alors s'établir de libres associations.La doctrine anarchiste implique un postulat tout à fait opposé à celui des absolutistes, ou des partisans del'État totalitaire.
Pour ces derniers en effet, les hommes sont bêtes et méchants ; il faut donc les soumettre àune discipline sévère.
A ce pessimisme foncier, les anarchistes opposent un optimisme naïf ; pour eux, l'hommeest bon par nature, il ne demande qu'à aider son semblable, il n'a pas besoin de l'organisation artificielle,contraignante et répressive de l'État.
[L'État peut être la plus sûre garantie contre la tyrannie, la violence des intérêts particuliers.
Étant l'expression du droit et de la volonté générale, il veille sur l'individu et protège sa liberté.]
Etat et libertéRousseau concilie la liberté individuelle avec l'autorité de l'État en considérant que celle-ci découle d'un«contrat social» par lequel chacun accepte de se conformer à la «volonté générale».
Ce contrat garantit à lafois la liberté et l'égalité.
L'État, résultat de ce contrat, est l'instrument de tous mis au service de la liberté dechacun.Le problème de la création de l'Etat légitime peut donc s'énoncer ainsi : « Trouver une forme d'association quidéfende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquellechacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant.
»Or, comment créer des lois et n'obéir à personne ? La réponse de Rousseau est apparemment simple : « Lepeuple soumis aux lois doit en être l'auteur.
»Chaque individu promet d'obéir à la « volonté générale ».
La « volonté générale » est ce qu'il y a de commundans toutes les volontés.
Par exemple, au moment où un groupe d'individus veut s'associer, il existe enchacun de ses futurs membres une volonté commune : créer cette association, quelles que soient par ailleursleurs volontés particulières et différentes, singulières.
En promettant d'obéir à la « volonté générale », je nepromets en fait que d'obéir à moi-même, qu'à une partie de ma volonté, qui se trouve coïncider avec celle desautres.
Sans doute, en obéissant à la « volonté générale », ne réaliserai-je pas toutes mes volontés, je nesatisferai pas tous mes intérêts.
Mais je me réaliserai que ce que je veux, que mes intérêts.
En aucun cas jene serai soumis à la volonté d'un autre.
Bref, je resterai libre.« Tant que les sujets ne sont soumis qu'à de telles conventions, ils n'obéissent à personne, mais seulement àleur propre volonté.
»En obéissant à la loi, qui n'est qu'une déclaration de la « volonté générale », je perds ma liberté naturelle defaire tout ce que je veux ou plus précisément tout ce que je peux , étant donné la force des autres quipeuvent s'opposer à mes projets.
Mais je gagne précisément une liberté politique, qui me permet à la fois den'obéir qu'à moi-même (puisque je peux me considérer comme l'auteur de la volonté générale, qui est unepartie de MA volonté), et ne pas subir la volonté d'un autre (plus fort, plus rusé, plus riche).De plus, il y a fort à parier que les lois seront justes, puisque ceux qui les font doivent les subir ; chaquemembre de l'Etat est à la fois et législateur et sujet.
Son propre intérêt lui commande donc de faire des loisjudicieuses, puisqu'il en subira les conséquences.
Ainsi, l'égoïsme naturel se voit servir l'intérêt commun..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les libertés individuelles de J. STUART MILL
- L'Etat est-il l'ennemi des libertés individuelles?
- Comment concilier la souveraineté politique et le respect des libertés individuelles ?
- L'Etat est-il le cimetière pour les libertés individuelles ?
- LEs libertés individuelles poesent-elles problème à la société ?