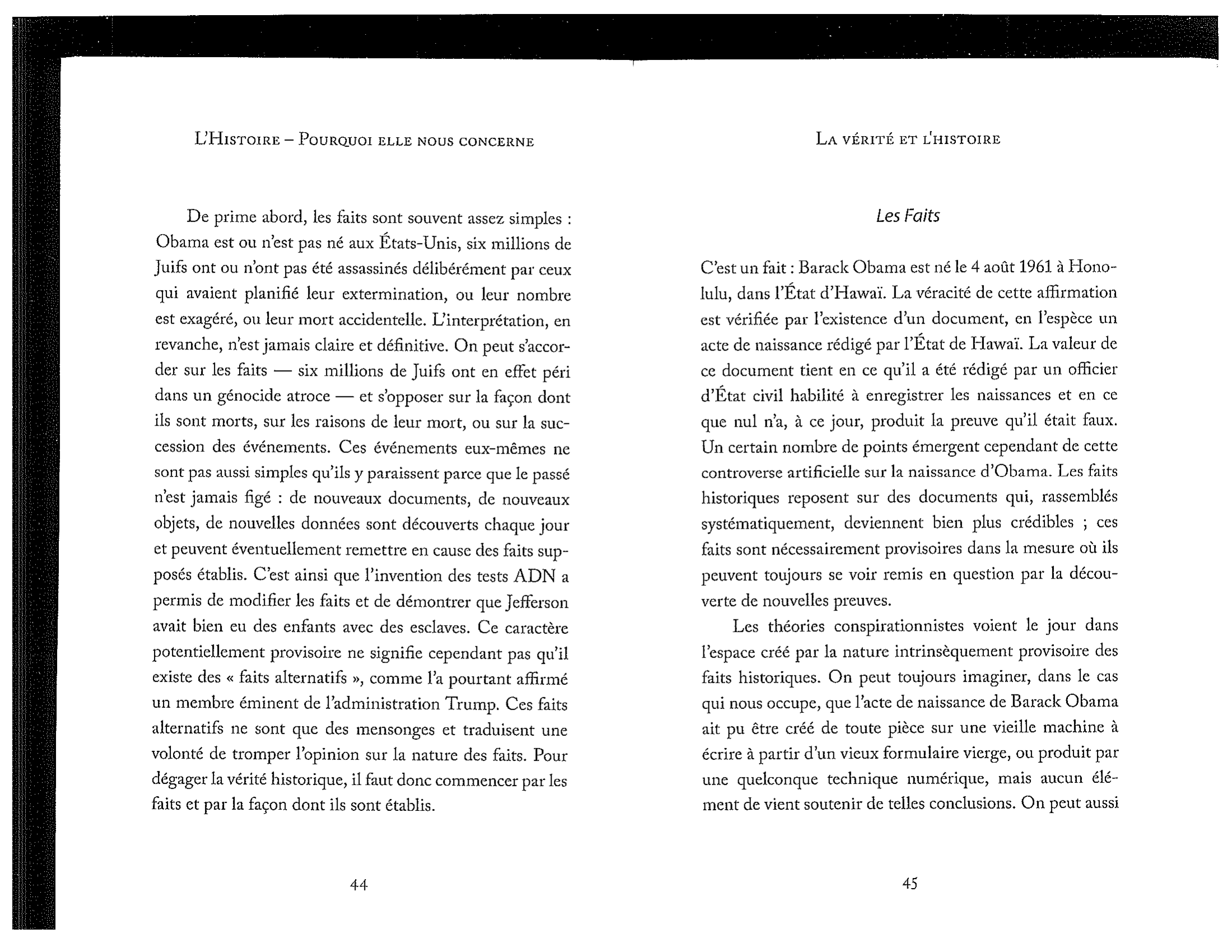L'HISTOIRE - POURQUOI ELLE NOUS CONCERNE ?
Publié le 16/10/2020

Extrait du document

Il est crucial de définir la vérité historique. Sans elle, il est impossible de contrer les mensonges des hommes politiques ou des négationnistes ; sans elle, il est impossible de résoudre les controverses que suscitent les monuments ou les manuels scolaires ; sans elle, les guerres mémorielles seraient sans fin et l’opinion publique n’accorderait plus aucun crédit à l’histoire telle qu’elle lui est présentée. La vérité historique est à double niveau : au premier niveau se trouvent les faits et au second, leur analyse. S’il est possible de séparer ces deux niveaux pour les besoins de la discussion, en pratique, ils sont indissociables. Un fait en lui-même ne signifie rien tant qu’il nest pas un élément d’une interprétation qui lui donne un sens, et la force de cette interprétation repose précisément sur sa capacité à donner un sens aux faits.
De prime abord, les faits sont souvent assez simples : Obama est ou n’est pas né aux Etats-Unis, six millions de Juifs ont ou n’ont pas été assassinés délibérément par ceux qui avaient planifié leur extermination, ou leur nombre est exagéré, ou leur mort accidentelle. L’interprétation, en revanche, n’est jamais claire et définitive. On peut s’accorder sur les faits — six millions de Juifs ont en effet péri dans un génocide atroce — et s’opposer sur la façon dont ils sont morts, sur les raisons de leur mort, ou sur la succession des événements. Ces événements eux-mêmes ne sont pas aussi simples qu’ils y paraissent parce que le passé n’est jamais figé : de nouveaux documents, de nouveaux objets, de nouvelles données sont découverts chaque jour et peuvent éventuellement remettre en cause des faits supposés établis. C’est ainsi que l’invention des tests ADN a permis de modifier les faits et de démontrer que Jefferson avait bien eu des enfants avec des esclaves. Ce caractère potentiellement provisoire ne signifie cependant pas qu’il existe des « faits alternatifs », comme l’a pourtant affirmé un membre éminent de l’administration Trump. Ces faits alternatifs ne sont que des mensonges et traduisent une volonté de tromper l’opinion sur la nature des faits. Pour dégager la vérité historique, il faut donc commencer par les faits et par la façon dont ils sont établis.
Les Faits
C’est un fait : Barack Obama est né le 4 août 1961 à Hono- lulu, dans l’Etat d’Hawaï. La véracité de cette affirmation est vérifiée par l’existence d’un document, en l’espèce un acte de naissance rédigé par l’Etat de Hawaï. La valeur de ce document tient en ce qu’il a été rédigé par un officier d’Etat civil habilité à enregistrer les naissances et en ce que nul n’a, à ce jour, produit la preuve qu’il était faux. Un certain nombre de points émergent cependant de cette controverse artificielle sur la naissance d’Obama. Les faits historiques reposent sur des documents qui, rassemblés systématiquement, deviennent bien plus crédibles ; ces faits sont nécessairement provisoires dans la mesure où ils peuvent toujours se voir remis en question par la découverte de nouvelles preuves.
Les théories conspirationnistes voient le jour dans l’espace créé par la nature intrinsèquement provisoire des faits historiques. On peut toujours imaginer, dans le cas qui nous occupe, que l’acte de naissance de Barack Obama ait pu être créé de toute pièce sur une vieille machine à écrire à partir d’un vieux formulaire vierge, ou produit par une quelconque technique numérique, mais aucun élément de vient soutenir de telles conclusions. On peut aussi
imaginer que l’acte de naissance de Donald Trump soit un faux, ou le vôtre, voire le mien. Obama a eu la chance de naître dans un Etat doté d’une autorité de la santé et d’un bureau d’Etat civil, mais les réfugiés venus de pays ravagés par la guerre ont fui sans emporter de vêtements et, le plus souvent, sans leur acte de naissance. Ils ont fui des pays dont l’administration a souvent été détruite dans les bombardements, si tant est quelle ait jamais été efficace. L’existence ou l’absence de document est elle aussi un produit de l’histoire.
Les faits historiques ne valent jamais que ce que valent les documents sur lesquels ils reposent, or certains documents importants se sont révélés faux. L’un des plus tristement célèbres est la « Donation de Constantin », censé être un décret de l’empereur romain mort en 337 de notre ère par lequel celui-ci accorde au pape l’autorité spirituelle et séculière de l’Eglise catholique sur la partie occidentale du monde chrétien. L’enjeu était de taille car les papes disputaient souvent le pouvoir politique aux rois et aux empereurs. La donation n’est toutefois citée pour la première fois qu’au tout début du IXe siècle, ce qui pose inévitablement la question de sa validité. C’est un érudit italien, Lorenzo Valla, qui a le premier présenté le document comme un faux, probablement fabriqué à la fin du vine siècle ou au
début du siècle suivant, même si les chercheurs débattent encore aujourd’hui des origines de ce faux.
Le fait que la manipulation ait été dévoilée montre le rôle important joué par la politique dans la quête de la vérité historique. S’étant vu refuser un poste dans l’entourage du pape, Valla accepta de travailler pour l’un de ses rivaux, le roi d’Aragon et de Sicile, qui cherchait à reprendre le contrôle de Naples à un soutien du Vatican. Les motivations politiques de Valla n’invalident nullement son entreprise ; il est même à l’origine d’une nouvelle discipline, la philologie, c’est-à-dire l’étude de l’histoire des langues, grâce à laquelle il a pu montrer que Constantin n’avait pas pu écrire ce document. Pour Valla, le latin dans lequel il était rédigé n’était pas le latin de Constantin, car les expressions utilisées n’étaient pas en usage à son époque et certaines références indiquaient une période de rédaction plus tardive. Il a fallu attendre près d’un siècle pour que la démonstration de Valla fasse son effet, une fois de plus grâce à la politique. Les partisans de la Réforme protestante ont traduit et imprimé son texte à destination d’un large lectorat désireux de lire un témoignage de la corruption papale (l’imprimerie venait juste d’être inventée au moment où Valla a rédigé son texte). Au début du xvnc siècle, certains tenaient encore
la donation pour incontestable alors même que le Vatican n’y croyait déjà plus. Les faits inventés de toutes pièces ont souvent la vie dure.
Les historiens de profession ne sont pas tous insensibles à l’attrait des faux les plus habiles. En 1983, plusieurs organes de presse ont annoncé la publication en plusieurs volumes des manuscrits du journal intime d’Hitler, conservés secrètement en Allemagne de l’est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux historiens, grands spécialistes de l’hitlérisme, ont alors été sollicités pour examiner les volumes qui leur ont tout d’abord semblé authentiques. Mais à mesure que la date de publication approchait, ils ont exprimés des doutes de plus en plus forts car ni l’écriture, ni le papier utilisé, ni l’encre n’avaient été expertisés. Quelques jours après la publication, les archives fédérales allemandes ont fait savoir qu’une analyse du papier et de la reliure datait les carnets de l’après-guerre. Le canular était l’œuvre d’un ancien ressortissant de l’ex-Allemagne de l’est établi en Allemagne de l’ouest et spécialisé dans la vente illégale de souvenirs nazis. Profitant de la naïveté d’un journaliste de la RFA, le faussaire avait empoché plusieurs millions de marks allemands et s’est d’ailleurs remis à peindre de faux tableaux ou à fabriquer de faux permis de conduire dès sa sortie de prison.
L’exemple des faux carnets d’Hitler nous montre que pour établir la véracité des faits, les historiens peuvent s’appuyer sur un ensemble de techniques scientifiques le plus souvent mises au point pour d’autres usages. Les récents perfectionnements de l’analyse d’ADN permettent ainsi aujourd’hui d’examiner des restes exhumés dans des cimetières antiques afin de déterminer les trajets migratoires entre l’Europe de l’est et l’Italie au vic siècle, et d’en savoir davantage sur les « barbares » qui ont envahi l’Empire romain. La photographie aérienne et la télédétection au laser, deux technologies dont les applications étaient à l’origine militaires et environnementales, ont été utilisées pour localiser les voies romaines sous le paysage de la Grande- Bretagne actuelle. La dendrochronologie (qui étudie les anneaux de croissance des arbres) permet de dater les vaisseaux vikings et d’étudier les changements climatiques du xvne siècle. La datation au carbone 14 a permis à une équipe d’historiens et de scientifiques de démontrer que la « carte du Vinland », sans doute la première carte du Nouveau Monde, était antérieure de presque soixante ans à l’arrivée de Christophe Colomb. Dans de nombreux cas, les historiens ont travaillé directement avec des scientifiques pour trouver les informations qu’ils cherchaient, mais les nouvelles avancées technologiques pourraient remettre en
question une partie de leurs conclusions, sinon toutes, car les faits historiques reposent toujours sur les meilleures preuves disponibles. Il en va de même pour les faits scientifiques : Isaac Newton a révolutionné notre connaissance de la mécanique terrestre et céleste, mais il était cependant convaincu, comme nombre de ses contemporains, que la Terre n’avait que 6000 ans. La datation radiométrique des météorites nous permet aujourd’hui de penser que la Terre est vieille de 4,5 milliards d’années.
Il est sans doute un peu audacieux de parler de « la meilleure preuve disponible », mais celle-ci dépend en réalité de ce que les historiens comme les scientifiques considèrent être une source d’information crédible. Jusqu’à une époque récente, la meilleure preuve disponible reposait suides rapports rédigés par les autorités politiques ou religieuses, comme la donation de Constantin et les manuscrits ou les livres écrits par ses détracteurs. En d’autres termes, les faits sont façonnés par ceux qui détiennent le pouvoir et qui décident de ce qui vaut la peine d’être consigné. Le peu de connaissances que nous avons des croyances religieuses des populations avant le développement de l’alphabétisation nous vient des prêtres eux-mêmes ou des forces de police, c’est-à-dire de ceux qui avaient la maîtrise de l’écrit et un intérêt politique ou religieux à produire une
trace écrite. Les documents qu’ils nous ont laissés reflètent leur point de vue et leurs préoccupations. Le problème se trouve aggravé en contexte colonial dans la mesure où les documents officiels représentent la vision des administrateurs coloniaux et des autorités militaires qui n’avaient bien souvent qu’une connaissance rudimentaire des langues et des coutumes locales. Les autorités catholiques envoyées au Mexique fraîchement conquis envisageaient les croyances des populations nahuas comme le signe de l’influence de Satan et se sont contentées de traiter les croyants comme des criminels. Pour comprendre le fonctionnement des croyances nahuas, les historiens ont dû apprendre à aller à l’encontre des sources espagnoles et à décoder la langue locale, le nahuatl, et ses pictogrammes. En d’autres termes, les chercheurs ont dû explorer des aires de recherches inédites pour exhumer des faits significatifs : les meilleures preuves historiques disponibles dépendent donc pour une large part de la manière dont les historiens explorent les sources et de ce qui les motive. Leur activité est rarement neutre.
Bien qu’elle s’appuie parfois sur des techniques scientifiques, l’histoire n’est pas une science. C’est un art littéraire qui recourt à des techniques scientifiques lorsque c’est nécessaire, mais dont l’objectif fondamental est de
dire une histoire vraie. La véracité de l’histoire repose sur la documentation disponible et, de ce point de vue, l’historien est à la recherche d’informations au même titre qu’un détective, un juriste ou un journaliste d’investigation : il analyse et compare les sources, écrites ou non, et utilise toutes les méthodes d’analyse possibles pour parvenir à la vérité, c’est-à-dire aux faits. L’histoire elle-même a besoin d’autre chose : d’une reconstitution littéraire qui s’appuie sur diverses interprétations des faits. Ce sont ces interprétations qui donnent aux faits leur pertinence. Le monde est rempli de montagnes de faits historiques, mais seuls une poignée d’entre eux nous intéressent à un moment précis ; ce sont les faits qui nous permettent de raconter l’histoire que nous voulons raconter. La façon dont nous la racontons met les faits en lumière et suscite souvent des discussions assez vives car les historiens peuvent avoir une vision très contrastée d’un même événement. Cette cacophonie nous pousse d’ailleurs à douter de la véracité des interprétations avancées : si celles-ci sont sujettes à des débats aussi intenses, comment l’histoire peut-elle prétendre connaître la vérité de notre passé ? S’agit-il de mon histoire contre la vôtre ?
Interprétations
Prenons l’exemple de Napoléon Bonaparte, l’un des plus célèbres généraux et souverains de l’histoire mondiale. Tous les chercheurs s’accordent à dire que ce général d’origine corse est arrivé au pouvoir en France en novembre 1799 et qu’il s’est rapidement proclamé premier Consul, puis Consul à vie et enfin Empereur. Ils sont cependant en désaccord quant à l’interprétation de ces faits : quelles caractéristiques du régime alors en vigueur a pu permettre à un général de se hisser au pouvoir ? Quelles étaient les intentions de Bonaparte lorsqu’il est arrivé au pouvoir ? A- t-il établi une dictature militaire ? Pourquoi a-t-il fini par être chassé du pouvoir ? Ou encore : était-il oui ou non un bon général ? Est-il arrivé au pouvoir parce que la toute jeune République française avait fait de mauvais choix en matière de politique étrangère et intérieure ou parce que des siècles de régime monarchique avaient habitué les Français à l’idée d’un chef puissant et autoritaire ? Napoléon a-t-il remporté des victoires militaires parce qu’il était fin stratège, parce qu’il incarnait la figure du leader charismatique pour ses soldats, ou parce qu’il a eu la chance de profiter des maladresses de ses adversaires sur le champ de bataille ? Les réponses à ces questions dépendent de la
façon dont on envisage les faits et des faits que l’on choisit de mettre en avant.
La grande variabilité des interprétations jette le doute sur la possibilité de parvenir à la vérité historique. Puisque les historiens expriment toujours le point de vue qui est le leur, point de vue conditionné par leur histoire personnelle et par le contexte social, ce qu’ils écrivent ne saurait être entièrement objectif. Lorsque j’écris sur Napoléon, par exemple, je le fais du point de vue d’une universitaire blanche, issue des classes moyennes et formée aux Etats- Unis dans les années 1960. Sans doute le sujet me touche- t-il moins directement qu’un collègue français, mais c’est cependant avec mes propres partis pris, conscients ou non, que j’accomplis cette tâche (et i.1 en va de même pour mes lecteurs). Si la question des qualités militaires de Napoléon sur le champ de bataille ne m’intéresse guère à titre personnel, je m’intéresse sans doute plus que d’autres à tout ce qu’il a fait pour contrer l’impulsion démocratique et renforcer la subordination des femmes et des enfants à leurs maris et leurs pères. Cet intérêt particulier ne signifie pas que mon approche est d’emblée fausse, sauf si elle me pousse à affirmer que ces questions sont les seules questions qui importent au regard du parcours de Napoléon. L’histoire la plus vraie est souvent écrite par des individus
particulièrement attachés à l’un ou l’autre aspect d’une question. La fadeur n’a rien à voir avec la vérité.
Les plus grands historiens ont toujours poursuivi leur quête avec passion. Alexis de Tocqueville a ainsi rédigé ce qui reste l’une des meilleures interprétations de la Révolution française, LRlncien Régime et la Révolution (1856), parce qu’il était horrifié par l’ascension au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu « lymphatique » de Napoléon Ier. Comment les Français avaient-ils pu, à plusieurs reprises, sacrifier leurs libertés fraîchement acquises à une nouvelle forme de despotisme démocratique ? Pour répondre à la question, Tocqueville s’est plongé dans les archives de sa région et étudié en détail le fonctionnement de la monarchie au xvmc siècle. Il en est ressorti avec la conviction que la monarchie elle-même avait permis l’arrivée au pouvoir du futur Napoléon Ier en détruisant le pouvoir politique de la noblesse et des autorités locales. C’est son intérêt passionné pour le sujet qui a conduit Tocqueville aux archives ; c’est son talent littéraire qui a fait de son interprétation un classique indémodable.
C’est en se fondant sur des normes essentielles largement reconnues par les historiens que Tocqueville a pu prétendre à la vérité historique : la véracité de toute interprétation dépend de sa cohérence et de sa capacité à
proposer une explication pour les faits les plus saillants. • Une présentation cohérente se doit d’être logique et de citer des preuves pertinentes sans en tirer des conclusions absurdes. Si je cherche à démontrer qu’un rapport paternaliste aux femmes et aux enfants était au cœur du régime autoritaire mis en place par Napoléon, je vais aller chercher des preuves dans les lois qu’il a promulguées, dans ses écrits ou encore dans sa vie, mais je ne peux pas utiliser le fait qu’il aimait sa femme pour montrer qu’il était paternaliste, car une telle conclusion est dénuée de logique. Il pourrait tout aussi bien avoir aimé sa femme et opté pour d’autres sortes de régime politique.
Il faut cependant aller au-delà de la simple cohérence. Pour que mon explication soit la plus complète possible, l’accent que je choisis de mettre sur le paternalisme de Napoléon Ier doit pouvoir éclairer le plus de faits possible. Il n’a pas besoin d’expliquer sa stratégie sur le champ de bataille, mais il doit permettre de comprendre les articles de son Code civil concernant les femmes et les enfants et peut-être même son comportement personnel, même si celui-ci ne s’accordait pas avec les principes qui étaient officiellement les siens. Le fait que, dans le Code Napoléon, une femme ne pouvait devenir propriétaire, contracter des dettes, travailler ou rédiger un testament sans le
consentement de son époux va largement dans le sens de ce que j’avance. On pourrait m’objecter que Napoléon n’a pas rédigé lui-même ces lois, mais s’il n’a pas agi seul, il a personnellement assisté aux séances au cours desquelles ont été rédigées les lois concernant la famille. Une interprétation ne saurait s’appuyer uniquement sur les faits qui la confortent, elle doit pouvoir résister aux éventuels arguments contraires.
Même si ce lien étroit entre faits et interprétations entraîne inévitablement une remise en question de la vérité historique, il suscite également de nouvelles recherches dont le but est d’atténuer le doute. Lorsqu’un critique hypothétique m’objecte que Napoléon n’a pas écrit lui-même les lois en question, il m’appartient de rechercher d’autres preuves de sa participation directe et de chercher à savoir comment ses collaborateurs comprenaient ses idées. Les interprétations contradictoires peuvent donc aboutir à la découverte de faits supplémentaires : les interprétations, les faits et les débats passés n’en disparaissent pas pour autant, mais servent de base aux travaux de recherche à venir.
Vérité historique et eurocentrisme
Les critères sur lesquels s’appuie la vérité (faits avérés, cohérence, exhaustivité) semblent solides, mais ils masquent un problème de taille : l’idée que l’écriture de l’histoire doit viser la découverte de la vérité et que, dans une certaine mesure, l’objectivité est le reflet d’une conception de l’historiographie propre à l’Occident, qui s’est notamment développée au cours des deux derniers siècles. Si l’histoire a toujours existé en tant que branche du savoir, la formation universitaire des historiens n’a pris forme qu’au xixc siècle en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. Bien avant le début du xixc siècle, on écrivait, lisait et étudiait déjà l’histoire en espérant y trouver des leçons utiles pour les problèmes du présent et l'on avait mis au point des techniques qui devaient permettre d’accéder à la vérité, mais les universités ne formaient pas des historiens de profession. Lorenzo Valla, par exemple, enseignait la rhétorique à l’université, discipline qui préparait les étudiants à devenir notaires ou fonctionnaires. Il a certes mis au point une méthode de recherche en histoire qui a fait date — la comparaison philologique des textes — mais ne l’a pas fait dans le but de former des historiographes.
La formation universitaire des historiens a été mise au point pour la transmission et l’amélioration des méthodes devant permettre de déterminer la vérité historique. L’un des fondateurs de l’histoire en tant que discipline universitaire, l’Allemand Léopold von Ranke, a écrit en 1824 qu’il ne cherchait pas à juger le passé pour instruire les générations futures, mais qu’il voulait simplement décrire le passé « tel qu’il était ». Certains historiens ont reproché à Ranke ce qu’ils considéraient comme une vision naïve des choses, puisqu’à leurs yeux, aucun historien de ne peut saisir le passé dans sa totalité, mais le connaître uniquement grâce à ses vestiges, aux fragments qui ont traversé le temps pour parvenir jusqu’à nous. On ne pourra donc jamais connaître le passé avec exactitude. Les détracteurs de Ranke faisaient cependant fausse route. Ce dernier a reconnu la partialité de son approche et admis que « l’intention d’un historien dépend de son point de vue », Il espérait toutefois convaincre les lecteurs d’ouvrages d’histoire d’élargir leur vision des choses.
À une époque où nombre d’historiens dans les pays protestants avaient du mal à ne pas vanter la supériorité protestante tandis que les historiens du reste de l’Europe cherchaient à souligner le caractère distinctif de leur propre récit national, Ranke cherchait à être plus objectif:
« la stricte représentation des faits, aussi incertaine et peu attrayante quelle puisse être » et, à partir de là, « le développement de l’unité et du déroulement des événements ». Ranke voulait pousser ses lecteurs à envisager le passé sous un jour nouveau et son souci d’objectivité s’appuyait sur une étude des sources originales et sur des notes de bas de page qui devaient permettre aux lecteurs, du moins en théorie, de vérifier ses dires1.
Le séminaire créé par Ranke afin de montrer à ses étudiants (masculins) comment comparer et critiquer les sources historiques a rapidement attiré un public international. L’historien américain Charles K. Adams a écrit en 1889:
Il n’existe aujourd’hui nulle part dans le monde un enseignement de l’histoire digne de ce nom qui ne soit pas fondé sur l’examen attentif, précis et minutieux des sources tel qu’il fut instauré [,..] par les séminaires allemands2.
La moitié des historiens titulaires de postes de professeurs d’histoire aux États-Unis dans les années 1880 et 1890 avaient fait leurs études en Allemagne et Ranke est le premier étranger fait membre honoraire de l’American Historical Association après sa fondation en 1884. À sa mort en 1886, l’Université Syracuse de New York a acheté ses archives personnelles en raison du rôle essentiel qu’il avait joué dans la naissance de l’histoire comme discipline moderne.
Malgré la volonté de Ranke d’aller au-delà de l’histoire allemande, l’histoire est devenue une discipline universitaire alors même que se développait le nationalisme et, avec lui, la conviction de plus en plus forte de la supériorité de l’Europe sur le reste du monde. Les historiens se sont empressé de raconter l’histoire de leur pays en s’intéressant plus particulièrement à la montée en puissance de l’Etat bureaucratique moderne comme signe de la supériorité manifeste de l’Europe. L’écriture de l’histoire européenne est devenue la norme, non seulement pour les historiens américains, mais pour ceux du monde entier. Des étudiants sud-américains, africains et asiatiques se sont ainsi rendus en Europe pour y recevoir une formation doctorale en histoire, l’Europe de l’ouest est devenue modèle en matière d’historiographie et les techniques d’investigation historique développées en Europe ont influencé les historiens de part le monde. Face aux défis de l’impérialisme européen, les historiens chinois et japonais, par exemple, se sont efforcés de rattraper leurs homologues occidentaux.
Le succès des mouvements de décolonisation qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale aurait dû aboutir à la remise en cause de ce modèle « eurocentré » bien avant les années 1990, mais depuis, les attaques se sont intensifiées. Dipesh Chakrabarty a ouvert la voie avec un texte publié pour la première fois en 1992 et dont l’influence ne s’est pas démentie par la suite :
Il est désormais manifeste que l’Europe fait office de référent silencieux en matière de savoir historique et il existe au moins deux symptômes ordinaires du caractère subalterne de l’histoire des pays non-occidentaux ou du Tiers-Monde. Les historiens de ces pays éprouvent le besoin de citer des ouvrages portant sur l’histoire européenne tandis que les historiens de l’Europe n’éprouvent aucun besoin de faire l’inverse [...] les « grands noms » et les modèles du travail de l’historien sont toujours, au moins culturellement, « européens ». « Ils » travaillent dans l’ignorance relative de l’histoire des pays non-occidentaux, sans que cela semble affecter la qualité de leurs travaux. C’est une attitude que « nous » ne pouvons nous permettre, de même que nous ne pouvons nous permettre une ignorance réciproque ou symétrique sans prendre le risque de paraître « vieux-jeu » ou « dépassés3 ».
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours d'histoire-géographie 2nd
- Histoire de l'esclavage
- Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer: Une histoire des mathématiques (résumé)
- Bill Bryson: Histoire de tout, ou presque ...
- Philippe Breton, Histoire de l'informatique (résumé et analyse)