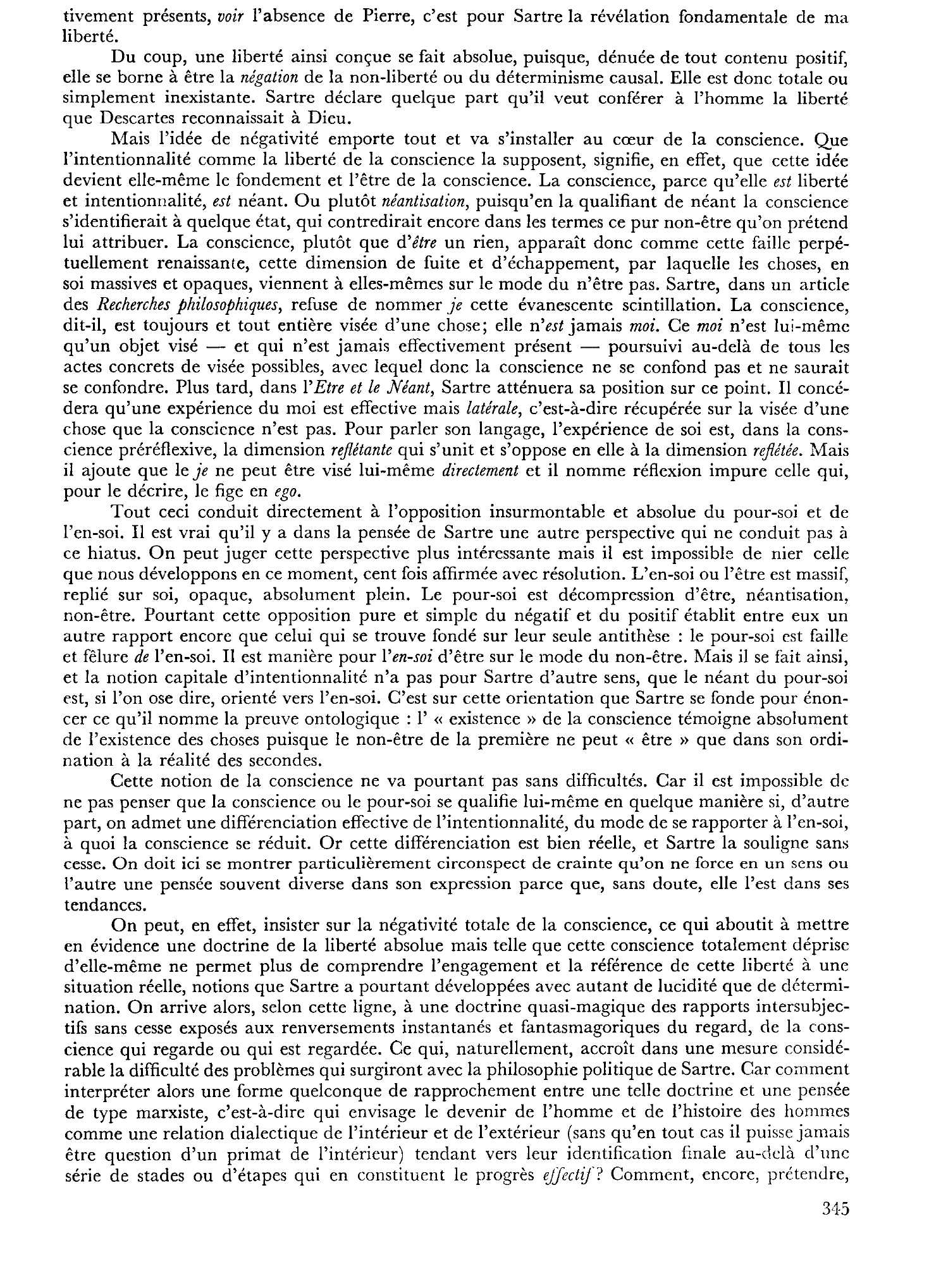L'oeuvre de Sartre
Publié le 16/04/2012
Extrait du document

ROMANS
LA NAUSÉE (1938)
LE MUR, suivi de :
LA CHAMBRE, EROSTRATE, INTIMITÉ, ENFANCE D'UN CHEF (1939)
LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ :
I. L'AGE DE RAISON (1945)
Il. LE SURSIS (1945)
III, LA MORT DANS L'AME (1949)
ESSAIS
L'IMAGINATION (1936)
ESQUISSE D'UNE THEORIE DES ÉMOTIONS (1939)
L'IMAGINAIRE (1940)
L'ÊTRE ET LE NÉANT (1943)
RÉFLEXIONS SUR LA QUESTION JUIVE (1946)
EXPLICATION DE “ L'ÉTRANGER ” (1946)
L'EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME (1946)
BAUDELAIRE (1947)
SITUATIONS I (1947)
SITUATIONS II (1948)
SITUATIONS III (1949)
SITUATIONS IV (1964)
SITUATIONS V (1964)
SITUATIONS VI (1964)
L'HOMME ET LES CHOSES (1947)
VISAGES, précédé de : PORTRAITS OFFICIELS (1948)
ENTRETIENS SUR LA POLITIQUE (avec David Rousset et Gérard Rosenthal) (1949)
SAINT GENET, COMÉDIEN ET MARTYR (1952)
D'UNE CHINE A L'AUTRE (1905)
UNE VICTOIRE (1958)
CRITIQUE DE LA RAISON DIALECTIQUE (1960)
LES MOTS (1964)
THÉATRE
LES MOUCHES (1943)
HUIS CLOS (1945)
MORTS SANS SÉPULTURE (1946)
LA PUTAIN RESPECTUEUSE (1946)
LES MAINS SALES (1948)
LE DIABLE ET LE BON DIEU (1951)
KEAN, adapté d'Alexandre Dumas Père (1953)
NEKRASSOV (1956)
LES SEQUES TRES D'ALTONA (1959)
LES JEUX SONT FAITS, scénario (1947)
L'ENGRENAGE, scénario (1948)

«
tivement présents, voir l'absence de Pierre, c'est pour Sartre la révélation fondamentale de ma
liberté.
Du coup, une liberté ainsi conçue se fait absolue, puisque, dénuée de tout contenu positif,
elle se
borne à être la négation de la non-liberté ou du déterminisme causal.
Elle est donc totale ou
simplement inexistante.
Sartre déclare quelque part qu'il veut conférer à l'homme la liberté
que Descartes reconnaissait à Dieu.
Mais l'idée
de négativité emporte tout et va s'installer au cœur de la conscience.
Que
l'intentionnalité comme la liberté de la conscience la supposent, signifie, en effet, que cette idée
devient elle-même le fondement
et l'être de la conscience.
La conscience, parce qu'elle est liberté
et intentionnalité, est néant.
Ou plutôt néantisation, puisqu'en la qualifiant de néant la conscience
s'identifierait à
quelque état, qui contredirait encore dans les termes ce pur non-être qu'on prétend
lui attribuer.
La conscience, plutôt que d'être un rien, apparaît donc comme cette faille perpé
tuellement renaissante, cette dimension
de fuite et d'échappement, par laquelle les choses, en
soi massives
et opaques, viennent à elles-mêmes sur le mode du n'être pas.
Sartre, dans un article
des
Recherches philosophiques, refuse de nommer je cette évanescente scintillation.
La conscience,
dit-il, est toujours
et tout entière visée d'une chose; elle n'est jamais moi.
Ce moi n'est lui-même
qu'un objet visé - et qui n'est jamais effectivement présent -poursuivi au-delà de tous les
actes concrets
de visée possibles, avec lequel donc la conscience ne se confond pas et ne saurait
se confondre.
Plus tard, dans l' Etre et le Néant, Sartre atténuera sa position sur ce point.
Il concé
dera qu'une expérience du moi est effective mais latérale, c'est-à-dire récupérée sur la visée d'une
chose que la conscience n'est pas.
Pour parler son langage, l'expérience de soi est, dans la cons
cience préréflexive,
la dimension rejlétante qui s'unit et s'oppose en elle à la dimension reflétée.
Mais
il ajoute
que le je ne peut être visé lui-même directement et il nomme réflexion impure celle qui,
pour le décrire, le fige en ego.
Tout ceci conduit directement à l'opposition insurmontable et absolue du pour-soi et de
l'en-soi.
Il est vrai qu'il y a dans la pensée de Sartre une autre perspective qui ne conduit pas à
ce hiatus.
On peut juger cette perspective plus intéressante mais il est impossible de nier celle
que nous développons en ce moment, cent fois affirmée avec résolution.
L'en-soi ou l'être est massif,
replié
sur soi, opaque, absolument plein.
Le pour-soi est décompression d'être, néantisation,
non-être.
Pourtant cette opposition pure et simple du négatif et du positif établit entre eux un
autre rapport encore que celui qui se trouve fondé sur leur seule antithèse : le pour-soi est faille
et fêlure de l'en-soi.
Il est manière pour l'en-soi d'être sur le mode du non-être.
Mais il se fait ainsi,
et la notion capitale d'intentionnalité n'a pas pour Sartre d'autre sens, que le néant du pour-soi
est, si l'on ose dire, orienté vers l'en-soi.
C'est sur cette orientation que Sartre se fonde pour énon
cer ce
qu'il nomme la preuve ontologique : l' « existence » de la conscience témoigne absolument
de l'existence des choses puisque le non-être
de la première ne peut « être » que dans son ordi
nation à la réalité des secondes.
Cette notion de la conscience ne va pourtant pas sans difficultés.
Car il est impossible de
ne pas penser que la conscience ou le pour-soi se qualifie lui-même en quelque manière si, d'autre
part, on admet une différenciation effective de l'intentionnalité, du mode de se rapporter à l'en-soi,
à quoi la conscience
se réduit.
Or cette différenciation est bien réelle, et Sartre la souligne sans
cesse.
On doit ici se montrer particulièrement circonspect de crainte qu'on ne force en un sens ou
l'autre une pensée souvent diverse dans son expression parce que, sans doute, elle l'est dans ses
tendances.
On peut, en effet, insister sur la négativité totale de la conscience, ce qui aboutit à mettre
en évidence une doctrine de la liberté absolue mais telle que cette conscience totalement déprise
d'elle-même ne
permet plus de comprendre l'engagement et la référence de cette liberté à une
situation réelle, notions que Sartre a pourtant développées avec autant de lucidité que de détermi
nation.
On arrive alors, selon cette ligne, à une doctrine quasi-magique des rapports intersubjec
tifs sans cesse exposés
aux renversements instantanés et fantasmagoriques du regard, de la cons
cience
qui regarde ou qui est regardée.
Ce qui, naturellement, accroît dans une mesure considé
rable la difficulté des problèmes qui surgiront avec la philosophie politique de Sartre.
Car comment
interpréter alors une forme quelconque de rapprochement entre une telle doctrine et une pensée
de type marxiste, c'est-à-dire qui envisage le devenir de l'homme et de l'histoire des hommes
comme une relation dialectique de l'intérieur et de l'extérieur (sans qu'en tout cas il puisse jamais
être question d'un primat de l'intérieur) tendant vers leur identification finale au-delà d'une
série de stades ou d'étapes qui en constituent le progrès ejfectif? Comment, encore, prétendre,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- NAUSÉE (la). Roman de Jean-Paul Sartre (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Analyse de l'oeuvre complete de Sartre Huis-clos
- CRITIQUE DE LA RAISON DIALECTIQUE, 1960. Jean-Paul Sartre (exposé de l’oeuvre)
- Mur (le) de Jean-Paul Sartre (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Jean-Paul Sartre : sa vie et son oeuvre