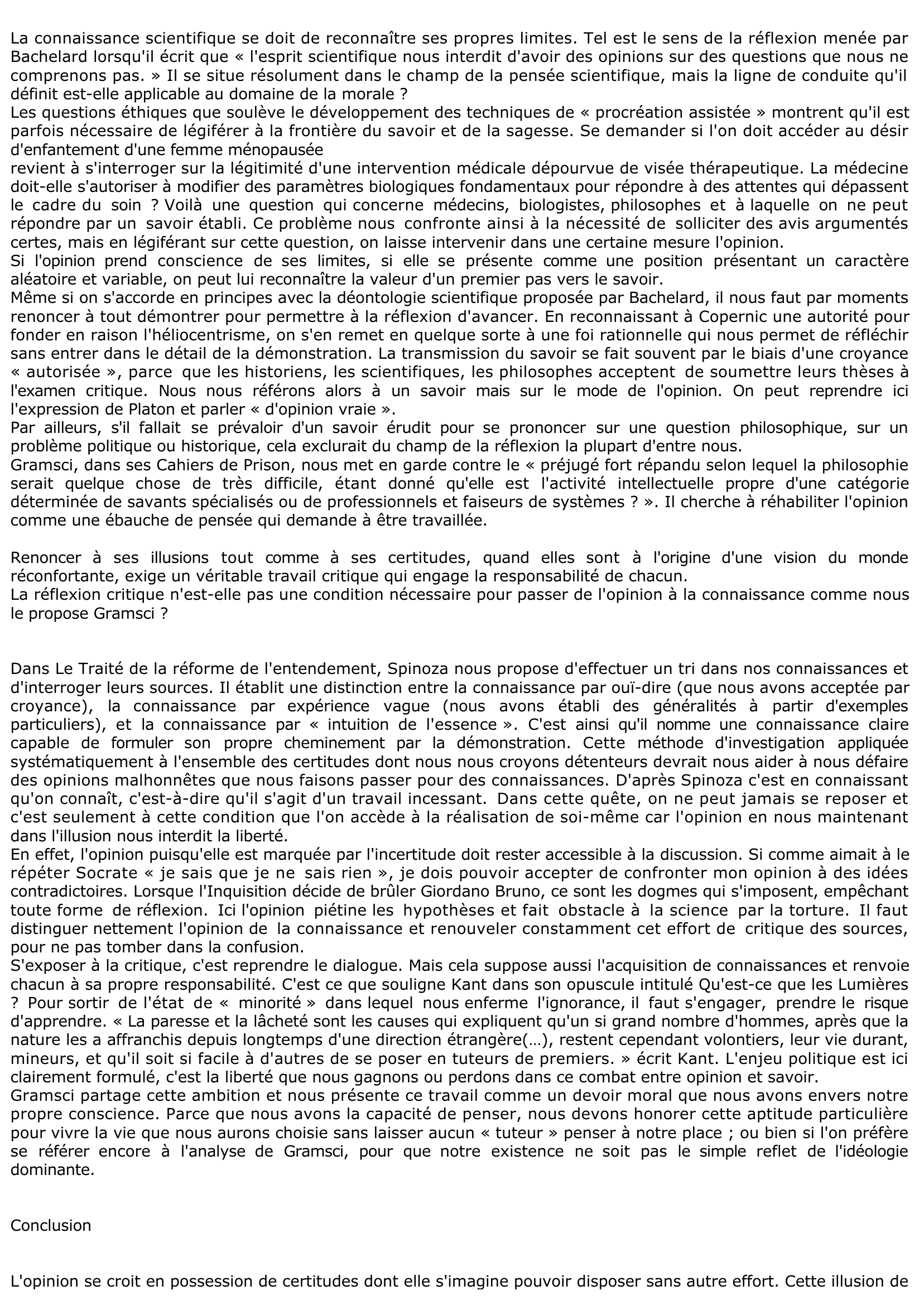L'opinion peut-elle être considérée comme un degré du savoir ?
Publié le 07/04/2009

Extrait du document
Bon nombre de personnes semblent se faire une idée globalement cohérente de l’univers sans pour autant être en mesure d’en formuler les principes organisateurs. On pourrait ainsi être tenté d’accorder à cette représentation approximative de la réalité la valeur d’une ébauche, comme s’il s’agissait d’une première étape, encore un peu brumeuse, précédant un savoir clair qu’il nous appartiendrait d’acquérir. Nous pourrions ainsi passer de Une antinomie radicale oppose pourtant l’opinion, ancrée dans la croyance et la sensation au savoir fondé sur une démonstration. C’est précisément l’idée que développe Bachelard dans La Formation de l’esprit scientifique où il écrit : « on ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire. « Toute forme d’opinion doit-elle ainsi être proscrite au nom de la rationalité ou bien pouvons-nous reconnaître une légitimité à l’opinion ? Si tel est le cas, à quelles conditions pouvons-nous prétendre passer de l’opinion à la connaissance ?
«
La connaissance scientifique se doit de reconnaître ses propres limites.
Tel est le sens de la réflexion menée parBachelard lorsqu'il écrit que « l'esprit scientifique nous interdit d'avoir des opinions sur des questions que nous necomprenons pas.
» Il se situe résolument dans le champ de la pensée scientifique, mais la ligne de conduite qu'ildéfinit est-elle applicable au domaine de la morale ?Les questions éthiques que soulève le développement des techniques de « procréation assistée » montrent qu'il estparfois nécessaire de légiférer à la frontière du savoir et de la sagesse.
Se demander si l'on doit accéder au désird'enfantement d'une femme ménopauséerevient à s'interroger sur la légitimité d'une intervention médicale dépourvue de visée thérapeutique.
La médecinedoit-elle s'autoriser à modifier des paramètres biologiques fondamentaux pour répondre à des attentes qui dépassentle cadre du soin ? Voilà une question qui concerne médecins, biologistes, philosophes et à laquelle on ne peutrépondre par un savoir établi.
Ce problème nous confronte ainsi à la nécessité de solliciter des avis argumentéscertes, mais en légiférant sur cette question, on laisse intervenir dans une certaine mesure l'opinion.Si l'opinion prend conscience de ses limites, si elle se présente comme une position présentant un caractèrealéatoire et variable, on peut lui reconnaître la valeur d'un premier pas vers le savoir.Même si on s'accorde en principes avec la déontologie scientifique proposée par Bachelard, il nous faut par momentsrenoncer à tout démontrer pour permettre à la réflexion d'avancer.
En reconnaissant à Copernic une autorité pourfonder en raison l'héliocentrisme, on s'en remet en quelque sorte à une foi rationnelle qui nous permet de réfléchirsans entrer dans le détail de la démonstration.
La transmission du savoir se fait souvent par le biais d'une croyance« autorisée », parce que les historiens, les scientifiques, les philosophes acceptent de soumettre leurs thèses àl'examen critique.
Nous nous référons alors à un savoir mais sur le mode de l'opinion.
On peut reprendre icil'expression de Platon et parler « d'opinion vraie ».Par ailleurs, s'il fallait se prévaloir d'un savoir érudit pour se prononcer sur une question philosophique, sur unproblème politique ou historique, cela exclurait du champ de la réflexion la plupart d'entre nous.Gramsci, dans ses Cahiers de Prison, nous met en garde contre le « préjugé fort répandu selon lequel la philosophieserait quelque chose de très difficile, étant donné qu'elle est l'activité intellectuelle propre d'une catégoriedéterminée de savants spécialisés ou de professionnels et faiseurs de systèmes ? ».
Il cherche à réhabiliter l'opinioncomme une ébauche de pensée qui demande à être travaillée.
Renoncer à ses illusions tout comme à ses certitudes, quand elles sont à l'origine d'une vision du monderéconfortante, exige un véritable travail critique qui engage la responsabilité de chacun.La réflexion critique n'est-elle pas une condition nécessaire pour passer de l'opinion à la connaissance comme nousle propose Gramsci ?
Dans Le Traité de la réforme de l'entendement, Spinoza nous propose d'effectuer un tri dans nos connaissances etd'interroger leurs sources.
Il établit une distinction entre la connaissance par ouï-dire (que nous avons acceptée parcroyance), la connaissance par expérience vague (nous avons établi des généralités à partir d'exemplesparticuliers), et la connaissance par « intuition de l'essence ».
C'est ainsi qu'il nomme une connaissance clairecapable de formuler son propre cheminement par la démonstration.
Cette méthode d'investigation appliquéesystématiquement à l'ensemble des certitudes dont nous nous croyons détenteurs devrait nous aider à nous défairedes opinions malhonnêtes que nous faisons passer pour des connaissances.
D'après Spinoza c'est en connaissantqu'on connaît, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un travail incessant.
Dans cette quête, on ne peut jamais se reposer etc'est seulement à cette condition que l'on accède à la réalisation de soi-même car l'opinion en nous maintenantdans l'illusion nous interdit la liberté.En effet, l'opinion puisqu'elle est marquée par l'incertitude doit rester accessible à la discussion.
Si comme aimait à lerépéter Socrate « je sais que je ne sais rien », je dois pouvoir accepter de confronter mon opinion à des idéescontradictoires.
Lorsque l'Inquisition décide de brûler Giordano Bruno, ce sont les dogmes qui s'imposent, empêchanttoute forme de réflexion.
Ici l'opinion piétine les hypothèses et fait obstacle à la science par la torture.
Il fautdistinguer nettement l'opinion de la connaissance et renouveler constamment cet effort de critique des sources,pour ne pas tomber dans la confusion.S'exposer à la critique, c'est reprendre le dialogue.
Mais cela suppose aussi l'acquisition de connaissances et renvoiechacun à sa propre responsabilité.
C'est ce que souligne Kant dans son opuscule intitulé Qu'est-ce que les Lumières? Pour sortir de l'état de « minorité » dans lequel nous enferme l'ignorance, il faut s'engager, prendre le risqued'apprendre.
« La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, après que lanature les a affranchis depuis longtemps d'une direction étrangère(…), restent cependant volontiers, leur vie durant,mineurs, et qu'il soit si facile à d'autres de se poser en tuteurs de premiers.
» écrit Kant.
L'enjeu politique est iciclairement formulé, c'est la liberté que nous gagnons ou perdons dans ce combat entre opinion et savoir.Gramsci partage cette ambition et nous présente ce travail comme un devoir moral que nous avons envers notrepropre conscience.
Parce que nous avons la capacité de penser, nous devons honorer cette aptitude particulièrepour vivre la vie que nous aurons choisie sans laisser aucun « tuteur » penser à notre place ; ou bien si l'on préfèrese référer encore à l'analyse de Gramsci, pour que notre existence ne soit pas le simple reflet de l'idéologiedominante.
Conclusion
L'opinion se croit en possession de certitudes dont elle s'imagine pouvoir disposer sans autre effort.
Cette illusion de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commenter cette opinion d’un penseur contemporain : « Croire n’est pas quelque chose de moins, mais quelque chose de plus que savoir. Celui qui croit ajoute le poids de tout son être à ce qu'il pense. »
- Le savoir est-il une forme d'opinion ?
- Le savoir s'oppose-t-il à l'opinion ?
- Commenter cette opinion d'un penseur contemporain : « Croire n'est pas quelque chose de moins, mais quelque chose de plus que savoir. Celui qui croit ajoute le poids de tout son être à ce qu'il pense. » ?
- Platon: De l'opinion vraie et du savoir