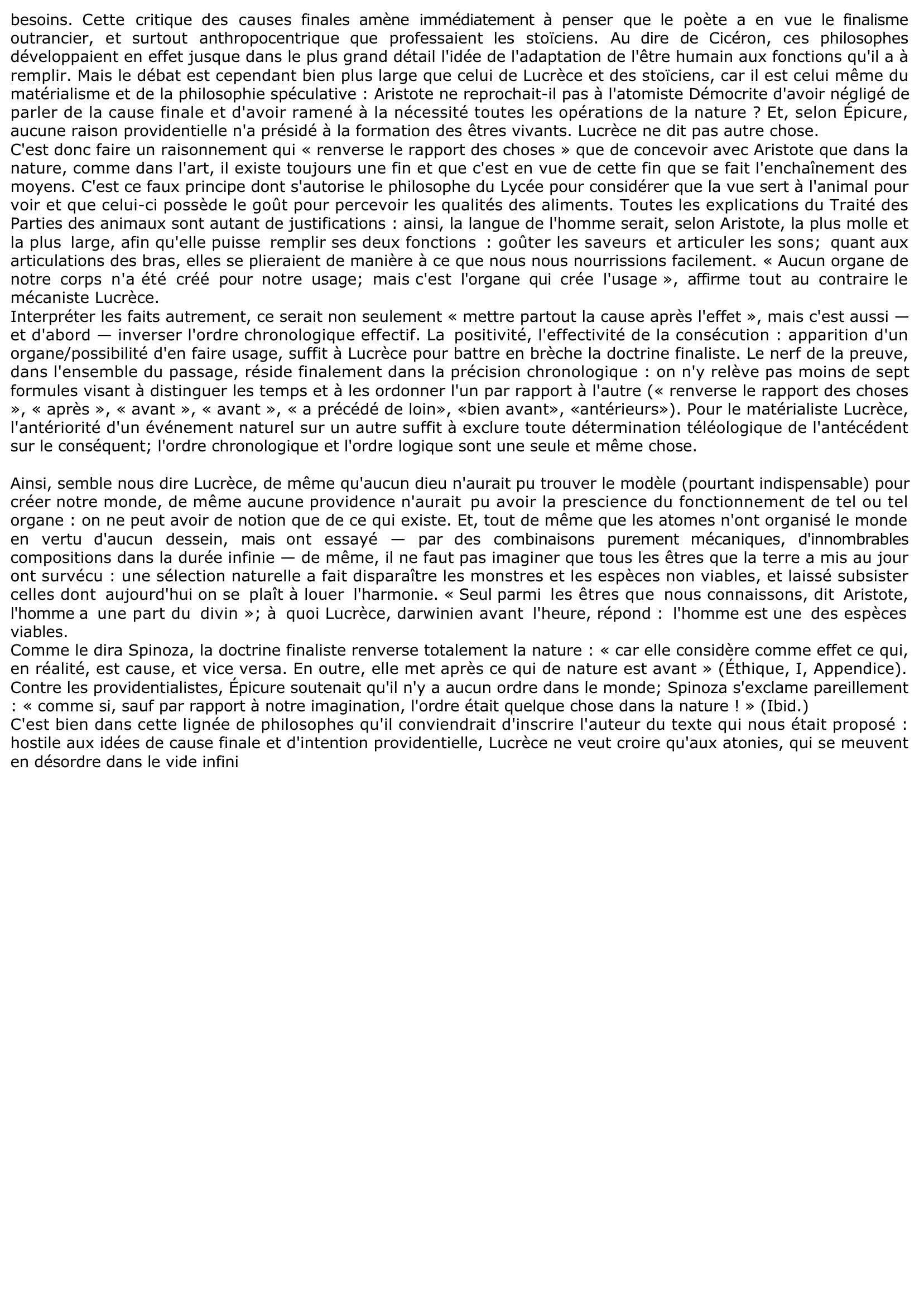Lucrèce: hasard et finalité
Publié le 23/03/2005

Extrait du document
ordre des idées
1) Une thèse centrale : les organes n'ont pas été créés en vue d'une utilité, d'un usage, d'une fin. Des exemples : les yeux, les jambes, les bras.
2) Justification de cette thèse : - Le finalisme inverse le « rapport des choses « en faisant de l'effet la cause. -Reprise des exemples : la vue est l'effet des yeux, non leur cause ; même chose pour les autres organes, qui sont tous antérieurs à leur usage.
«
besoins.
Cette critique des causes finales amène immédiatement à penser que le poète a en vue le finalismeoutrancier, et surtout anthropocentrique que professaient les stoïciens.
Au dire de Cicéron, ces philosophesdéveloppaient en effet jusque dans le plus grand détail l'idée de l'adaptation de l'être humain aux fonctions qu'il a àremplir.
Mais le débat est cependant bien plus large que celui de Lucrèce et des stoïciens, car il est celui même dumatérialisme et de la philosophie spéculative : Aristote ne reprochait-il pas à l'atomiste Démocrite d'avoir négligé deparler de la cause finale et d'avoir ramené à la nécessité toutes les opérations de la nature ? Et, selon Épicure,aucune raison providentielle n'a présidé à la formation des êtres vivants.
Lucrèce ne dit pas autre chose.C'est donc faire un raisonnement qui « renverse le rapport des choses » que de concevoir avec Aristote que dans lanature, comme dans l'art, il existe toujours une fin et que c'est en vue de cette fin que se fait l'enchaînement desmoyens.
C'est ce faux principe dont s'autorise le philosophe du Lycée pour considérer que la vue sert à l'animal pourvoir et que celui-ci possède le goût pour percevoir les qualités des aliments.
Toutes les explications du Traité desParties des animaux sont autant de justifications : ainsi, la langue de l'homme serait, selon Aristote, la plus molle etla plus large, afin qu'elle puisse remplir ses deux fonctions : goûter les saveurs et articuler les sons; quant auxarticulations des bras, elles se plieraient de manière à ce que nous nous nourrissions facilement.
« Aucun organe denotre corps n'a été créé pour notre usage; mais c'est l'organe qui crée l'usage », affirme tout au contraire lemécaniste Lucrèce.Interpréter les faits autrement, ce serait non seulement « mettre partout la cause après l'effet », mais c'est aussi —et d'abord — inverser l'ordre chronologique effectif.
La positivité, l'effectivité de la consécution : apparition d'unorgane/possibilité d'en faire usage, suffit à Lucrèce pour battre en brèche la doctrine finaliste.
Le nerf de la preuve,dans l'ensemble du passage, réside finalement dans la précision chronologique : on n'y relève pas moins de septformules visant à distinguer les temps et à les ordonner l'un par rapport à l'autre (« renverse le rapport des choses», « après », « avant », « avant », « a précédé de loin», «bien avant», «antérieurs»).
Pour le matérialiste Lucrèce,l'antériorité d'un événement naturel sur un autre suffit à exclure toute détermination téléologique de l'antécédentsur le conséquent; l'ordre chronologique et l'ordre logique sont une seule et même chose.
Ainsi, semble nous dire Lucrèce, de même qu'aucun dieu n'aurait pu trouver le modèle (pourtant indispensable) pourcréer notre monde, de même aucune providence n'aurait pu avoir la prescience du fonctionnement de tel ou telorgane : on ne peut avoir de notion que de ce qui existe.
Et, tout de même que les atomes n'ont organisé le mondeen vertu d'aucun dessein, mais ont essayé — par des combinaisons purement mécaniques, d'innombrablescompositions dans la durée infinie — de même, il ne faut pas imaginer que tous les êtres que la terre a mis au jouront survécu : une sélection naturelle a fait disparaître les monstres et les espèces non viables, et laissé subsistercelles dont aujourd'hui on se plaît à louer l'harmonie.
« Seul parmi les êtres que nous connaissons, dit Aristote,l'homme a une part du divin »; à quoi Lucrèce, darwinien avant l'heure, répond : l'homme est une des espècesviables.Comme le dira Spinoza, la doctrine finaliste renverse totalement la nature : « car elle considère comme effet ce qui,en réalité, est cause, et vice versa.
En outre, elle met après ce qui de nature est avant » (Éthique, I, Appendice).Contre les providentialistes, Épicure soutenait qu'il n'y a aucun ordre dans le monde; Spinoza s'exclame pareillement: « comme si, sauf par rapport à notre imagination, l'ordre était quelque chose dans la nature ! » (Ibid.)C'est bien dans cette lignée de philosophes qu'il conviendrait d'inscrire l'auteur du texte qui nous était proposé :hostile aux idées de cause finale et d'intention providentielle, Lucrèce ne veut croire qu'aux atonies, qui se meuventen désordre dans le vide infini.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Déterminisme, finalité et hasard
- « La plus grande douceur est d'occuper les hauts lieux fortifiés par la pensée des sages, ces régions sereines d'où s'aperçoit au loin le reste des hommes, qui errent çà et là en cher-chant au hasard le chemin de la vie. » Lucrèce, De la Nature, ier s. av. J.-C. Commentez cette citation.
- « Tout ce qui existe dans l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité » ATTRIBUÉ À DÉMOCRITE
- comment les mathématiques permettent ils de modéliser un jeu de hasard
- LECTURE ANALYTIQUE LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD, MARIVAUX ACTE I, SCENE 7