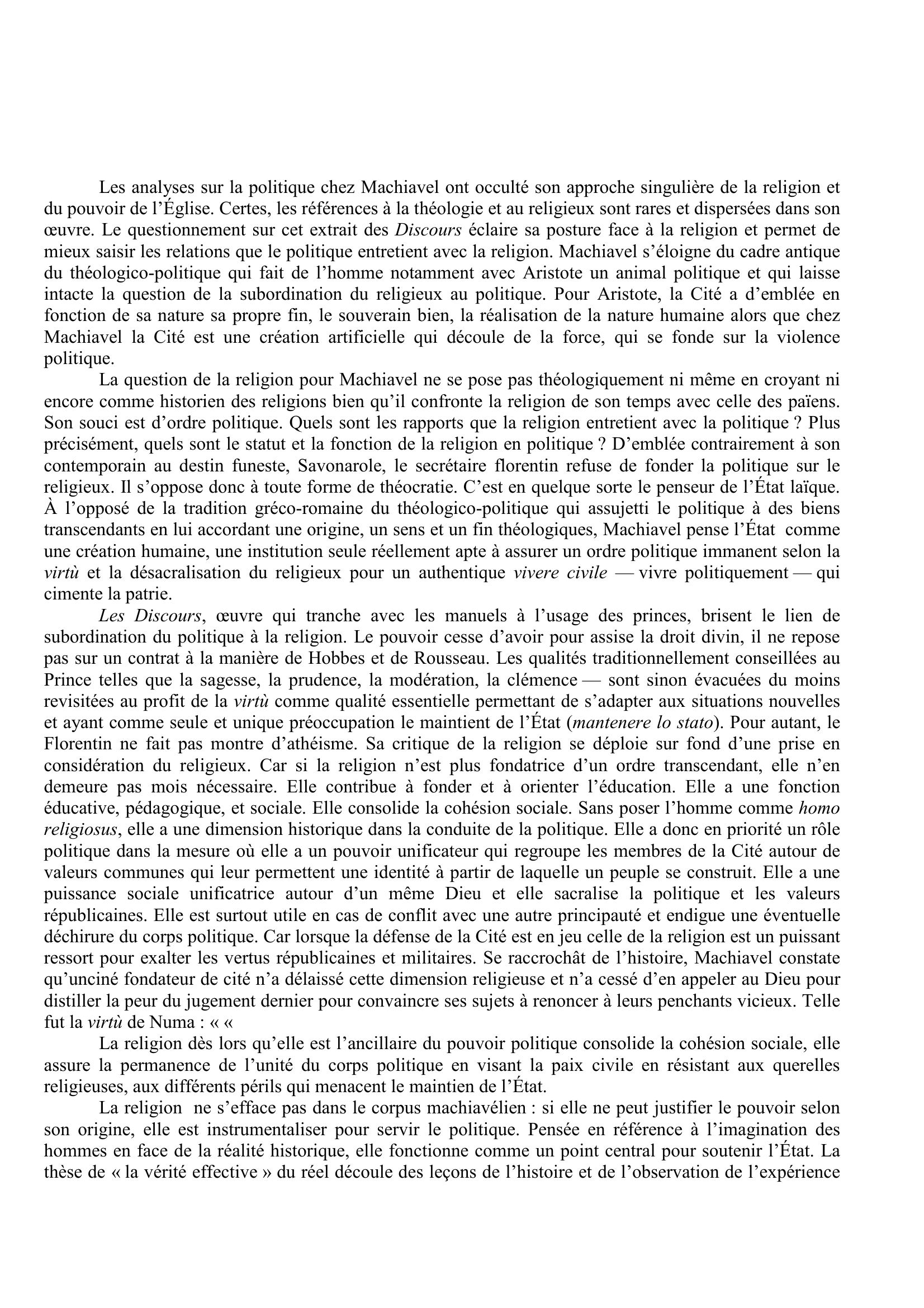Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, II, Ch. II
Publié le 19/03/2014

Extrait du document
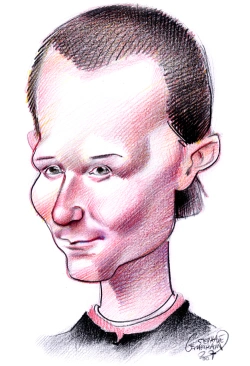
MACHIAVEL: « Pour quelle raison les hommes d'à présent sont-ils moins attachés à la liberté que ceux d'autrefois : pour la même raison, je pense, qui fait que ceux d'aujourd'hui sont moins forts ; et c'est, si je ne me trompe, la différence d'éducation fondée sur la différence de religion. Notre religion en effet, nous ayant montré la vérité et le droit chemin, fait que nous estimons moins la gloire de ce monde. Les païens, au contraire, qui l'estimaient beaucoup, qui plaçaient en elle le souverain bien, mettaient dans leurs actions infiniment plus de férocité : c'est ce qu'on peut inférer de la plupart de leurs institutions, à commencer par la magnificence de leurs sacrifices, comparée à l'humilité de nos cérémonies religieuses, dont la pompe, plus flatteuse que grandiose, n'a rien de féroce ni de gaillard. Leurs cérémonies étaient non seulement pompeuses, mais on y joignait des sacrifices ensanglantés par le massacre d'une infinité d'animaux ; ce qui rendait les hommes aussi féroces aussi terribles que le spectacle qu'on leur présentait. En outre, la religion païenne ne déifiait que des hommes d'une gloire terrestre, des capitaines d'armées, des chefs de républiques. Notre religion glorifie plutôt les humbles voués à la vie contemplative que les hommes d'action. Notre religion place le bonheur suprême dans l'humilité, l'abjection, le mépris des choses humaines ; et l'autre, au contraire, le faisait consister dans la grandeur d'âme, la force du corps et dans toutes les qualités qui rendent les hommes redoutables. Si la nôtre exige quelque force d'âme, c'est plutôt celle qui fait supporter les maux que celle qui porte aux fortes actions.
Il me paraît donc que ces principes, en rendant les peuples plus débiles, les ont disposés à être plus facilement la proie des méchants. Ceux-ci ont vu qu'ils pouvaient tyranniser sans crainte des hommes qui, pour aller en paradis, sont plus disposés à recevoir leurs coups qu'à les rendre. Mais si ce monde est efféminé, si le ciel parait désarmé, n'en accusons que la lâcheté de ceux qui ont interprété notre religion selon la paresse et non selon la virtù. S'ils avaient considéré que cette religion nous permet d'exalter et de défendre la patrie, ils auraient vu qu'elle nous ordonne d'aimer cette patrie, de l'honorer, et de nous rendre capables de la défendre. «
Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, II, Ch. II, La Pléiade p. 519 - 520.
Les analyses sur la politique chez Machiavel ont occulté son approche singulière de la religion et du pouvoir de l’Église. Certes, les références à la théologie et au religieux sont rares et dispersées dans son œuvre. Le questionnement sur cet extrait des Discours éclaire sa posture face à la religion et permet de mieux saisir les relations que le politique entretient avec la religion. Machiavel s’éloigne du cadre antique du théologico-politique qui fait de l’homme notamment avec Aristote un animal politique et qui laisse intacte la question de la subordination du religieux au politique. Pour Aristote, la Cité a d’emblée en fonction de sa nature sa propre fin, le souverain bien, la réalisation de la nature humaine alors que chez Machiavel la Cité est une création artificielle qui découle de la force, qui se fonde sur la violence politique.
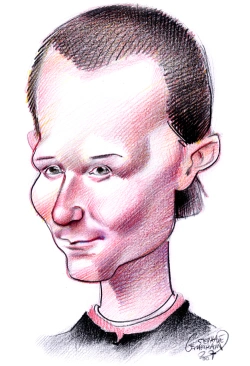
«
Les analyses sur la politique chez M achiavel ont occulté son approche singul ière de la religion et
du pouvoi r de l’Église.
Certes, les références à la théologie et au religieux sont rares et disper sées dans son
œuvre .
Le questionnement sur cet extrait des Discours éclaire sa posture face à la relig ion et permet de
mieux saisir les relations que le politique entretient avec la religion.
Machiavel s’éloigne du cadre antique
du théologico- politique qui fait de l’homme notamment avec Aristote un animal politique et qui laisse
intacte la question de la subordination du religieux au politique.
Pour Aristote, la Cité a d’emblée en
fonction de sa nature sa propre fin, le souverain bien, la réalisation de la nature humaine alor s que chez
Machiavel la Cité est une création artificielle qui découle de la force, qui se fonde sur la violence
politique.
La question de la religion pour Machiavel ne se pose pas théologiquement ni même en croyant ni
encore comme historien des religions bien qu’il confronte la religion de son temps avec celle des païens.
Son souci est d’ordre politique.
Quels sont les rapports que la religion en tretient avec la politique ? Plus
précisément, quels s ont le statut et la fonction de la religion en p olitique ? D’emblée contrairement à son
contemporain au destin funeste, Savonarole, le secrétaire florentin refuse de fonder la politique sur le
religieux.
Il s’oppose donc à toute forme de théocratie.
C’est en quelque sorte le penseur de l’État laïque.
À l’opposé de la tradition gréco- romaine du théologico-politique qui assujetti le politique à des biens
transcendants en lui accordant une origine, un sens et un fin théologiques, Machiavel pense l’État comme
une création humaine , une institution seule réel lement apte à assurer un ordre politique immanent selon la
virtù et la désacralisation du religieux pour un authentique vivere civile — vivre politiquement — qui
cimente la patrie.
Les Discours, œuvre qui tranche avec les manuels à l’usage des princes, b risent le lien de
subordination du politique à la religion.
Le pouvoir cesse d’avoir pour assise la droit divin, il ne repose
pas sur un contrat à la manière de Hobbes et de Rousseau.
Les qualités traditionnellement conseillées au
Prince telles que la sage sse, la prudence, la modération, la clémence — sont sinon évacuées du moins
revisitées au profit de la virtù comme qualité essentielle permettant de s’adapter aux situations nouvelles
et ayant comme seule et unique préoccupation le maintient de l’État ( mantenere lo stato ).
Pour autant, le
Florentin ne fait pas montre d’athéisme.
Sa critique de la religion se déploie sur fond d’une prise en
considération du religieux.
Car si la religion n’est plus fondatrice d’un ordre transcendant, elle n’en
demeure pas moi s nécessaire.
Elle contribue à fonder et à orienter l’éducation.
Elle a une fonction
éducative, pédagogique, et sociale.
Elle consolide la cohésion sociale.
Sans poser l’homme comme homo
religiosus , elle a une dimension historique dans la conduite de la politique.
Elle a donc en priorité un rôle
politique dans la mesure où elle a un pouvoir unificateur qui regroupe les membres de la C ité autour de
valeurs communes qui leur permettent une identité à partir de laquelle un peuple se construit.
Elle a une
pui ssance sociale unificatrice autour d’un même Dieu et elle sacralise la politique et les valeurs
républicaines.
Elle est surtout utile en cas de conflit avec une autre principauté et endigue une éventuelle
déchirure du corps politique.
Car lorsque la défens e de la Cité est en jeu celle de la religion est un puissant
ressort pour exalter les vertus républicaines et militaires.
Se raccrochât de l’histoire, Machiavel constate
qu’ unciné fondateur de cité n’a délaissé cette dimension religieuse et n’a cessé d’en appeler au Dieu pour
distiller la peur du jugement dernier pour convaincre ses sujets à renoncer à leurs penchants vicieux.
Telle
fut la virtù de Numa : « «
La religion dès lors qu’elle est l’ ancillaire du pouvoir politique consolide la cohésion sociale, elle
assure la permanence de l’unité du corps politique en visant la paix civile en résistant aux querelles
religieuses, aux différents périls qui menacent le maintien de l’État.
La religion ne s’efface pas dans le corpus machiavélien : si elle ne peut justifier le pouvoir selon
son origine, elle est instrumentaliser pour servir le politique.
Pensée en référence à l’imagination des
hommes en face de la réalité historique, elle fonctionne comme un point central pour soutenir l’État.
La
thèse de « la vérité effective » du réel découle des leçons de l’histoire et de l’observation de l’expérience.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DISCOURS SUR LA PREMIÈRE DÉCADE DE TITE-LIVE, Nicolas Machiavel - résumé de l'œuvre
- DISCOURS SUR LA PREMIÈRE DÉCADE DE TITE-LIVE de Machiavel (résumé et analyse)
- Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, II, Avant propos
- Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, L. I, Chap. III.
- Machiavel et l'Etat: Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, 1531, I, 9.