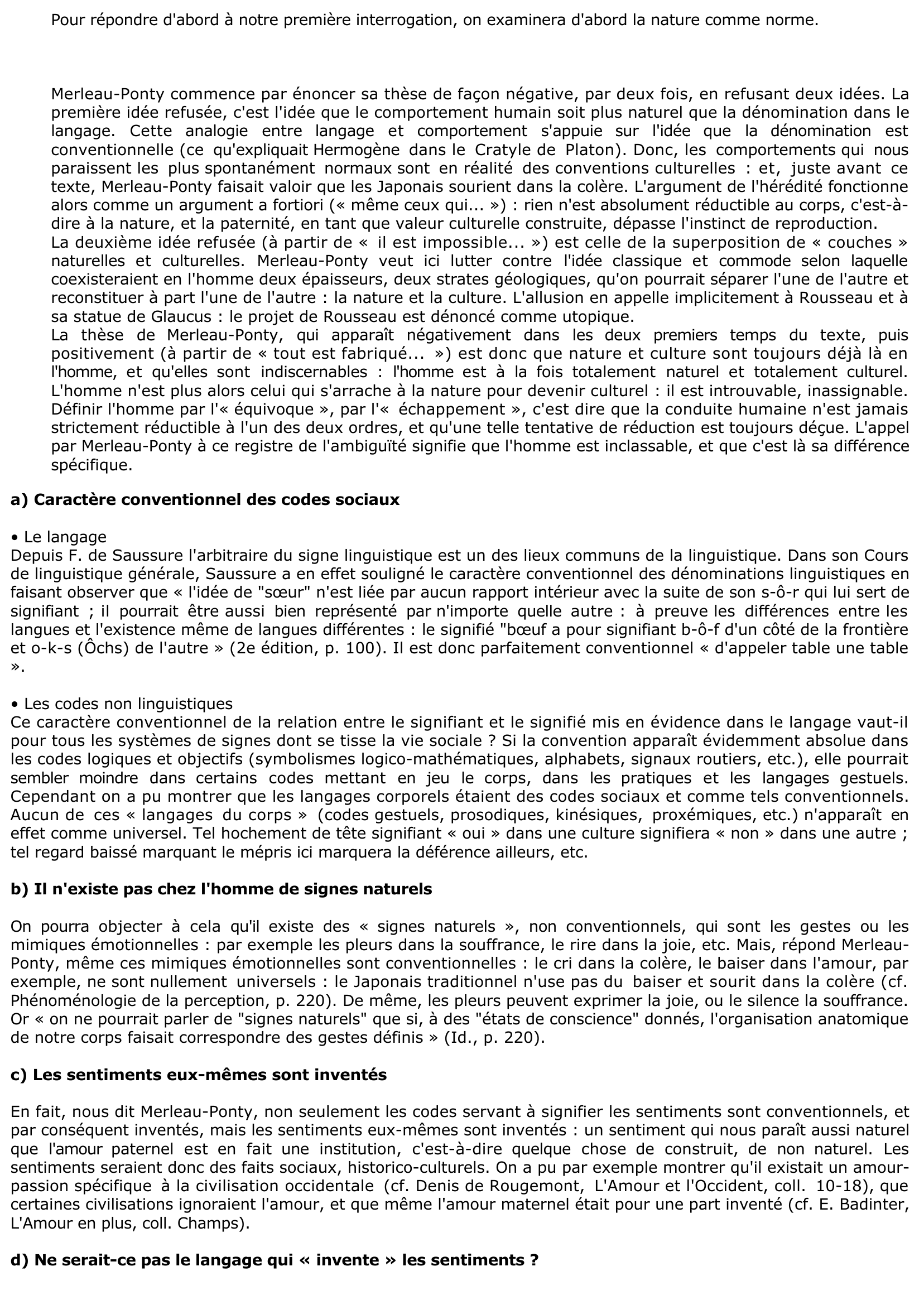Merleau-Ponty: Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme.
Publié le 28/03/2005

Extrait du document
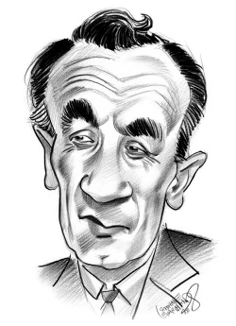
QUESTIONNEMENT • En quoi peut-on dire que tout est « naturel « chez l'homme ? • En quoi peut-on dire que tout est « fabriqué « chez l'homme ? • Pourquoi Merleau-Ponty écrit-il : « pas un mot, pas une conduite « ? Différence entre « mot « et « conduite « ? En quoi un « mot « peut-il être dit « naturel « ? • Rapport entretenu dans le texte entre « naturel « et « biologique « ? • Qu'est-ce qui « pourrait servir à définir l'homme « ? « L'équivoque «, « L'échappement «, les deux ? • Quelles réflexions pouvez-vous faire dans le rapproche¬ ment « simplicité de la vie animale « ... « génie de l'équivoque « (de l'homme) et « sorte d'échappement « ? • L' « enjeu « du texte est-ce — qu'est-ce que le « naturel « ? — qu'est-ce que le « culturel « ? ou qu'est-ce que l'homme ? • Qu'est-ce qui fait l'originalité (et la valeur ?) de la problématique et de la position établies par Merleau-Ponty ?
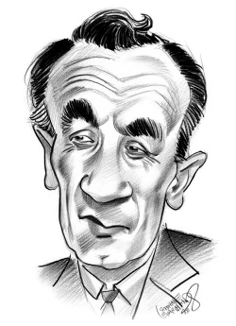
«
Pour répondre d'abord à notre première interrogation, on examinera d'abord la nature comme norme.
Merleau-Ponty commence par énoncer sa thèse de façon négative, par deux fois, en refusant deux idées.
Lapremière idée refusée, c'est l'idée que le comportement humain soit plus naturel que la dénomination dans lelangage.
Cette analogie entre langage et comportement s'appuie sur l'idée que la dénomination estconventionnelle (ce qu'expliquait Hermogène dans le Cratyle de Platon).
Donc, les comportements qui nousparaissent les plus spontanément normaux sont en réalité des conventions culturelles : et, juste avant cetexte, Merleau-Ponty faisait valoir que les Japonais sourient dans la colère.
L'argument de l'hérédité fonctionnealors comme un argument a fortiori (« même ceux qui...
») : rien n'est absolument réductible au corps, c'est-à-dire à la nature, et la paternité, en tant que valeur culturelle construite, dépasse l'instinct de reproduction.La deuxième idée refusée (à partir de « il est impossible...
») est celle de la superposition de « couches »naturelles et culturelles.
Merleau-Ponty veut ici lutter contre l'idée classique et commode selon laquellecoexisteraient en l'homme deux épaisseurs, deux strates géologiques, qu'on pourrait séparer l'une de l'autre etreconstituer à part l'une de l'autre : la nature et la culture.
L'allusion en appelle implicitement à Rousseau et àsa statue de Glaucus : le projet de Rousseau est dénoncé comme utopique.La thèse de Merleau-Ponty, qui apparaît négativement dans les deux premiers temps du texte, puispositivement (à partir de « tout est fabriqué...
») est donc que nature et culture sont toujours déjà là enl'homme, et qu'elles sont indiscernables : l'homme est à la fois totalement naturel et totalement culturel.L'homme n'est plus alors celui qui s'arrache à la nature pour devenir culturel : il est introuvable, inassignable.Définir l'homme par l'« équivoque », par l'« échappement », c'est dire que la conduite humaine n'est jamaisstrictement réductible à l'un des deux ordres, et qu'une telle tentative de réduction est toujours déçue.
L'appelpar Merleau-Ponty à ce registre de l'ambiguïté signifie que l'homme est inclassable, et que c'est là sa différencespécifique.
a) Caractère conventionnel des codes sociaux
• Le langageDepuis F.
de Saussure l'arbitraire du signe linguistique est un des lieux communs de la linguistique.
Dans son Coursde linguistique générale, Saussure a en effet souligné le caractère conventionnel des dénominations linguistiques enfaisant observer que « l'idée de "sœur" n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de son s-ô-r qui lui sert designifiant ; il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quelle autre : à preuve les différences entre leslangues et l'existence même de langues différentes : le signifié "bœuf a pour signifiant b-ô-f d'un côté de la frontièreet o-k-s (Ôchs) de l'autre » (2e édition, p.
100).
Il est donc parfaitement conventionnel « d'appeler table une table».
• Les codes non linguistiquesCe caractère conventionnel de la relation entre le signifiant et le signifié mis en évidence dans le langage vaut-ilpour tous les systèmes de signes dont se tisse la vie sociale ? Si la convention apparaît évidemment absolue dansles codes logiques et objectifs (symbolismes logico-mathématiques, alphabets, signaux routiers, etc.), elle pourraitsembler moindre dans certains codes mettant en jeu le corps, dans les pratiques et les langages gestuels.Cependant on a pu montrer que les langages corporels étaient des codes sociaux et comme tels conventionnels.Aucun de ces « langages du corps » (codes gestuels, prosodiques, kinésiques, proxémiques, etc.) n'apparaît eneffet comme universel.
Tel hochement de tête signifiant « oui » dans une culture signifiera « non » dans une autre ;tel regard baissé marquant le mépris ici marquera la déférence ailleurs, etc.
b) Il n'existe pas chez l'homme de signes naturels
On pourra objecter à cela qu'il existe des « signes naturels », non conventionnels, qui sont les gestes ou lesmimiques émotionnelles : par exemple les pleurs dans la souffrance, le rire dans la joie, etc.
Mais, répond Merleau-Ponty, même ces mimiques émotionnelles sont conventionnelles : le cri dans la colère, le baiser dans l'amour, parexemple, ne sont nullement universels : le Japonais traditionnel n'use pas du baiser et sourit dans la colère (cf.Phénoménologie de la perception, p.
220).
De même, les pleurs peuvent exprimer la joie, ou le silence la souffrance.Or « on ne pourrait parler de "signes naturels" que si, à des "états de conscience" donnés, l'organisation anatomiquede notre corps faisait correspondre des gestes définis » (Id., p.
220).
c) Les sentiments eux-mêmes sont inventés
En fait, nous dit Merleau-Ponty, non seulement les codes servant à signifier les sentiments sont conventionnels, etpar conséquent inventés, mais les sentiments eux-mêmes sont inventés : un sentiment qui nous paraît aussi naturelque l'amour paternel est en fait une institution, c'est-à-dire quelque chose de construit, de non naturel.
Lessentiments seraient donc des faits sociaux, historico-culturels.
On a pu par exemple montrer qu'il existait un amour-passion spécifique à la civilisation occidentale (cf.
Denis de Rougemont, L'Amour et l'Occident, coll.
10-18), quecertaines civilisations ignoraient l'amour, et que même l'amour maternel était pour une part inventé (cf.
E.
Badinter,L'Amour en plus, coll.
Champs).
d) Ne serait-ce pas le langage qui « invente » les sentiments ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Tout est fabriqué et naturel chez l’homme » - Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty
- MERLEAU-PONTY: «Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire...»
- PODCAST: "Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire, en ce sens qu'il n'est pas un mot, pas une conduite, qui ne doive quelque chose à l'être simplement biologique." Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945).
- Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire, en ce sens qu'il n'est pas un mot pas une conduite qui ne doive quelque chose à l'être simplement biologique - et qui en même temps ne se dérobe à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales, par une sorte d'échappement et par un génie de l'équivoque qui pourrait servir à définir l'homme. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception. Commentez cette citation.
- MERLEAU-PONTY: «Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire...». Commentez cette citation.