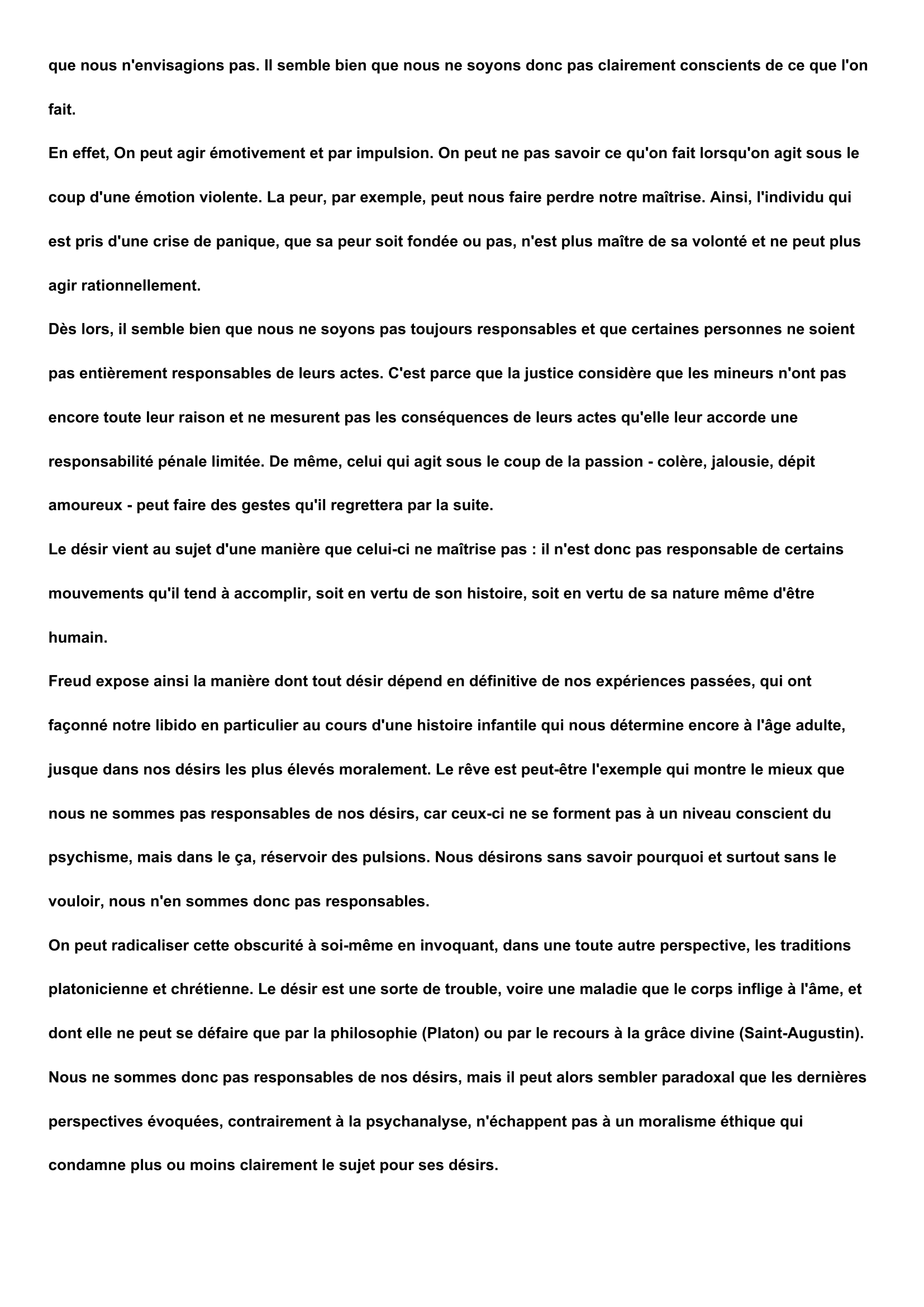monde
Publié le 30/11/2014

Extrait du document
«
que nous n'envisagions pas.
Il semble bien que nous ne soyons donc pas clairement conscients de ce que l'on
fait.
En effet, On peut agir émotivement et par impulsion.
On peut ne pas savoir ce qu'on fait lorsqu'on agit sous le
coup d'une émotion violente.
La peur, par exemple, peut nous faire perdre notre maîtrise.
Ainsi, l'individu qui
est pris d'une crise de panique, que sa peur soit fondée ou pas, n'est plus maître de sa volonté et ne peut plus
agir rationnellement.
Dès lors, il semble bien que nous ne soyons pas toujours responsables et que certaines personnes ne soient
pas entièrement responsables de leurs actes.
C'est parce que la justice considère que les mineurs n'ont pas
encore toute leur raison et ne mesurent pas les conséquences de leurs actes qu'elle leur accorde une
responsabilité pénale limitée.
De même, celui qui agit sous le coup de la passion - colère, jalousie, dépit
amoureux - peut faire des gestes qu'il regrettera par la suite.
Le désir vient au sujet d'une manière que celui-ci ne maîtrise pas : il n'est donc pas responsable de certains
mouvements qu'il tend à accomplir, soit en vertu de son histoire, soit en vertu de sa nature même d'être
humain.
Freud expose ainsi la manière dont tout désir dépend en définitive de nos expériences passées, qui ont
façonné notre libido en particulier au cours d'une histoire infantile qui nous détermine encore à l'âge adulte,
jusque dans nos désirs les plus élevés moralement.
Le rêve est peut-être l'exemple qui montre le mieux que
nous ne sommes pas responsables de nos désirs, car ceux-ci ne se forment pas à un niveau conscient du
psychisme, mais dans le ça, réservoir des pulsions.
Nous désirons sans savoir pourquoi et surtout sans le
vouloir, nous n'en sommes donc pas responsables.
On peut radicaliser cette obscurité à soi-même en invoquant, dans une toute autre perspective, les traditions
platonicienne et chrétienne.
Le désir est une sorte de trouble, voire une maladie que le corps inflige à l'âme, et
dont elle ne peut se défaire que par la philosophie (Platon) ou par le recours à la grâce divine (Saint-Augustin).
Nous ne sommes donc pas responsables de nos désirs, mais il peut alors sembler paradoxal que les dernières
perspectives évoquées, contrairement à la psychanalyse, n'échappent pas à un moralisme éthique qui
condamne plus ou moins clairement le sujet pour ses désirs..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FICHE DE LECTURE : LE MONDE OUVRIER DE 1870-1914
- Le théâtre a-t-il pour fonction de tout dire, de tout expliquer au spectateur de la crise que vivent les personnages? - Par quels moyens et quelles fonctions Juste la Fin du monde est une pièce qui nous retrace la crise de cette famille?
- Galilée: Dialogue sur les deux grands systèmes du monde
- LE TIERS-MONDE : INDÉPENDANCES, CONTESTATION DE L'ORDRE MONDIAL, DIVERSIFICATION
- LE MONDE EN 1945 (cours)