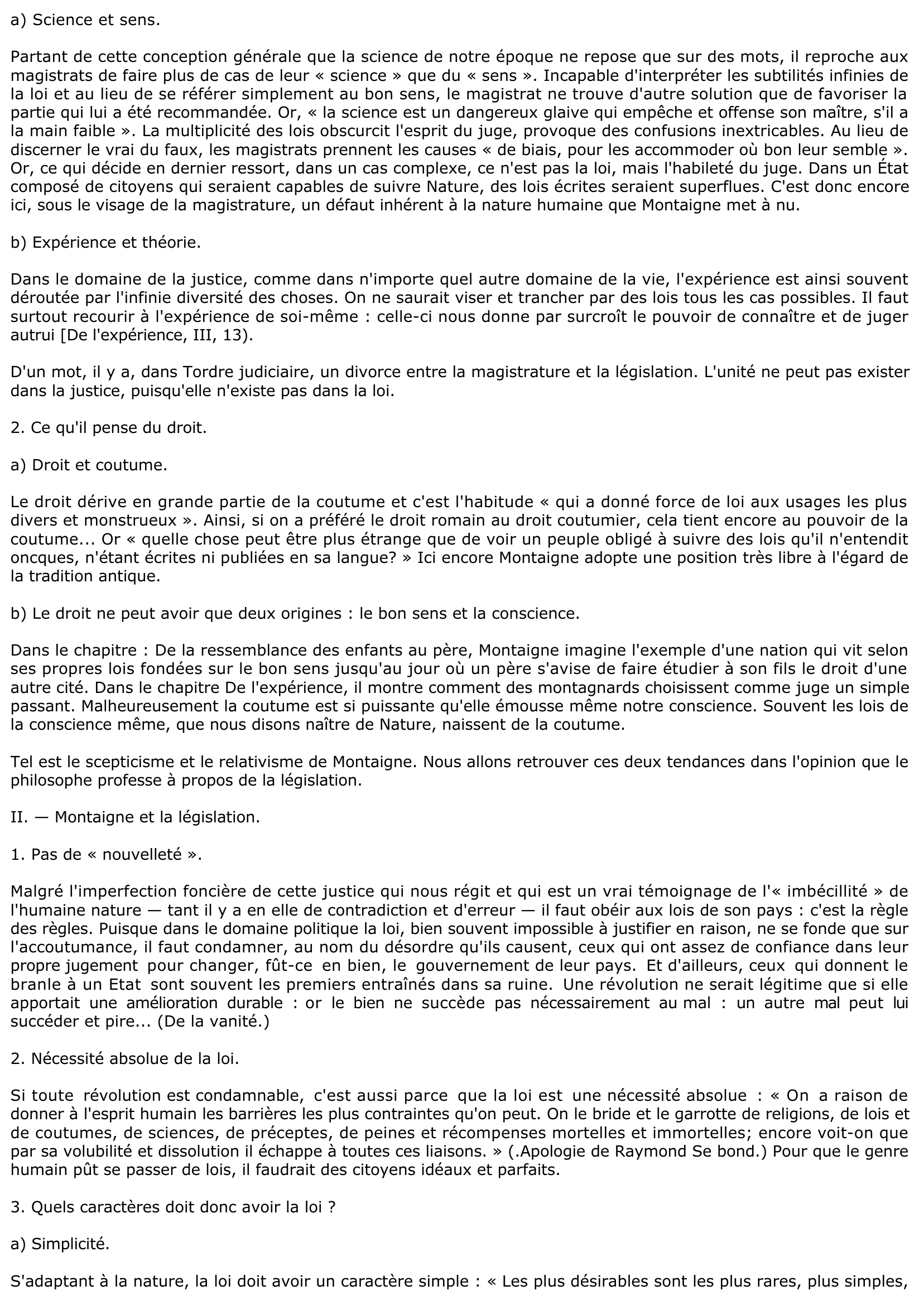Montaigne et la Cité ou Montaigne et la politique
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
a) Science et sens.
Partant de cette conception générale que la science de notre époque ne repose que sur des mots, il reproche auxmagistrats de faire plus de cas de leur « science » que du « sens ».
Incapable d'interpréter les subtilités infinies dela loi et au lieu de se référer simplement au bon sens, le magistrat ne trouve d'autre solution que de favoriser lapartie qui lui a été recommandée.
Or, « la science est un dangereux glaive qui empêche et offense son maître, s'il ala main faible ».
La multiplicité des lois obscurcit l'esprit du juge, provoque des confusions inextricables.
Au lieu dediscerner le vrai du faux, les magistrats prennent les causes « de biais, pour les accommoder où bon leur semble ».Or, ce qui décide en dernier ressort, dans un cas complexe, ce n'est pas la loi, mais l'habileté du juge.
Dans un Étatcomposé de citoyens qui seraient capables de suivre Nature, des lois écrites seraient superflues.
C'est donc encoreici, sous le visage de la magistrature, un défaut inhérent à la nature humaine que Montaigne met à nu.
b) Expérience et théorie.
Dans le domaine de la justice, comme dans n'importe quel autre domaine de la vie, l'expérience est ainsi souventdéroutée par l'infinie diversité des choses.
On ne saurait viser et trancher par des lois tous les cas possibles.
Il fautsurtout recourir à l'expérience de soi-même : celle-ci nous donne par surcroît le pouvoir de connaître et de jugerautrui [De l'expérience, III, 13).
D'un mot, il y a, dans Tordre judiciaire, un divorce entre la magistrature et la législation.
L'unité ne peut pas existerdans la justice, puisqu'elle n'existe pas dans la loi.
2.
Ce qu'il pense du droit.
a) Droit et coutume.
Le droit dérive en grande partie de la coutume et c'est l'habitude « qui a donné force de loi aux usages les plusdivers et monstrueux ».
Ainsi, si on a préféré le droit romain au droit coutumier, cela tient encore au pouvoir de lacoutume...
Or « quelle chose peut être plus étrange que de voir un peuple obligé à suivre des lois qu'il n'entenditoncques, n'étant écrites ni publiées en sa langue? » Ici encore Montaigne adopte une position très libre à l'égard dela tradition antique.
b) Le droit ne peut avoir que deux origines : le bon sens et la conscience.
Dans le chapitre : De la ressemblance des enfants au père, Montaigne imagine l'exemple d'une nation qui vit selonses propres lois fondées sur le bon sens jusqu'au jour où un père s'avise de faire étudier à son fils le droit d'uneautre cité.
Dans le chapitre De l'expérience, il montre comment des montagnards choisissent comme juge un simplepassant.
Malheureusement la coutume est si puissante qu'elle émousse même notre conscience.
Souvent les lois dela conscience même, que nous disons naître de Nature, naissent de la coutume.
Tel est le scepticisme et le relativisme de Montaigne.
Nous allons retrouver ces deux tendances dans l'opinion que lephilosophe professe à propos de la législation.
II.
— Montaigne et la législation.
1.
Pas de « nouvelleté ».
Malgré l'imperfection foncière de cette justice qui nous régit et qui est un vrai témoignage de l'« imbécillité » del'humaine nature — tant il y a en elle de contradiction et d'erreur — il faut obéir aux lois de son pays : c'est la règledes règles.
Puisque dans le domaine politique la loi, bien souvent impossible à justifier en raison, ne se fonde que surl'accoutumance, il faut condamner, au nom du désordre qu'ils causent, ceux qui ont assez de confiance dans leurpropre jugement pour changer, fût-ce en bien, le gouvernement de leur pays.
Et d'ailleurs, ceux qui donnent lebranle à un Etat sont souvent les premiers entraînés dans sa ruine.
Une révolution ne serait légitime que si elleapportait une amélioration durable : or le bien ne succède pas nécessairement au mal : un autre mal peut luisuccéder et pire...
(De la vanité.)
2.
Nécessité absolue de la loi.
Si toute révolution est condamnable, c'est aussi parce que la loi est une nécessité absolue : « On a raison dedonner à l'esprit humain les barrières les plus contraintes qu'on peut.
On le bride et le garrotte de religions, de lois etde coutumes, de sciences, de préceptes, de peines et récompenses mortelles et immortelles; encore voit-on quepar sa volubilité et dissolution il échappe à toutes ces liaisons.
» (.Apologie de Raymond Se bond.) Pour que le genrehumain pût se passer de lois, il faudrait des citoyens idéaux et parfaits.
3.
Quels caractères doit donc avoir la loi ?
a) Simplicité.
S'adaptant à la nature, la loi doit avoir un caractère simple : « Les plus désirables sont les plus rares, plus simples,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Aristote: la cité fait partie des choses naturelles - l'homme est par nature un animal politique
- Aristote: «Il est manifeste [ ... ] que la cité fait partie des choses naturelles, et que l'homme est par nature un animal politique.»
- Aristote, La Politique: L'association composée de plusieurs bourgades forme dès lors une cité parfaite, possédant tous les moyens de se suffire à elle-même et ayant atteint, pour ainsi dire, le but ; née en quelque sorte du besoin de vivre, elle existe pour vivre heureuse...
- MONTAIGNE POLITIQUE
- Les lois de la cité politique ont-elles pur but la paix ou la vertu ?