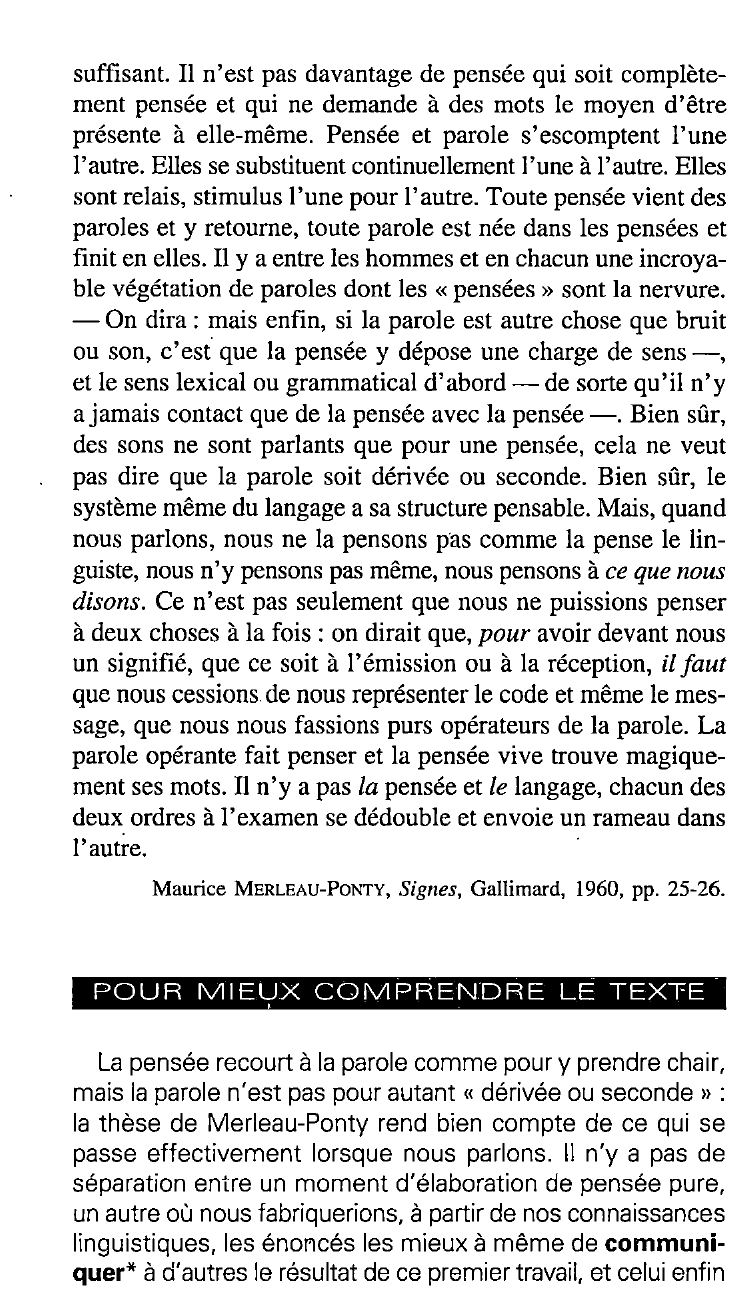Parler ses pensées de M. MERLEAU-PONTY
Publié le 09/01/2020

Extrait du document
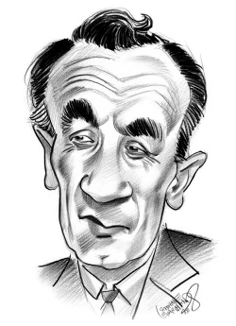
Renforcées par le rêve d'une pensée idéale qui se suffirait à elle-même, et le regret que le langage ne puisse jamais tout dire, les apparences plaident en faveur d’une subordination du langage à la pensée. Mais le rêve comme le regret sont peut-être sans objets.
Le langage ne serait pas, selon le mot de Freud, un « réinvestissement » total de notre vie, notre élément, comme l’eau est l’élément des poissons, s’il doublait du dehors une pensée qui légifère dans sa solitude pour toute autre pensée possible. Une pensée et une expression parallèles devraient être chacune dans son ordre complètes, on ne pourrait concevoir d’irruption de l’une dans l’autre, d’interception de l’une par l’autre. Or l’idée même d’un énoncé complet est inconsistante : ce n’est pas parce qu’il est en soi complet que nous le comprenons, c’est parce que nous avons compris que nous le disons complet ou suffisant. Il n’est pas davantage de pensée qui soit complètement pensée et qui ne demande à des mots le moyen d’être présente à elle-même. Pensée et parole s’escomptent l’une l’autre. Elles se substituent continuellement l’une à l’autre. Elles sont relais, stimulus l’une pour l’autre. Toute pensée vient des paroles et y retourne, toute parole est née dans les pensées et finit en elles. Il y a entre les hommes et en chacun une incroyable végétation de paroles dont les « pensées » sont la nervure. — On dira : mais enfin, si la parole est autre chose que bruit ou son, c’est que la pensée y dépose une charge de sens —, et le sens lexical ou grammatical d’abord — de sorte qu’il n’y a jamais contact que de la pensée avec la pensée —. Bien sûr, des sons ne sont parlants que pour une pensée, cela ne veut pas dire que la parole soit dérivée ou seconde. Bien sûr, le système même du langage a sa structure pensable. Mais, quand nous parlons, nous ne la pensons pas comme la pense le linguiste, nous n’y pensons pas même, nous pensons à ce que nous disons. Ce n’est pas seulement que nous ne puissions penser à deux choses à la fois : on dirait que, pour avoir devant nous un signifié, que ce soit à l’émission ou à la réception, il faut que nous cessions de nous représenter le code et même le message, que nous nous fassions purs opérateurs de la parole. La parole opérante fait penser et la pensée vive trouve magiquement ses mots. Il n’y a pas la pensée et le langage, chacun des deux ordres à l’examen se dédouble et envoie un rameau dans l’autre.
Maurice Merleau-Ponty, Signes, Gallimard, 1960, pp. 25-26.
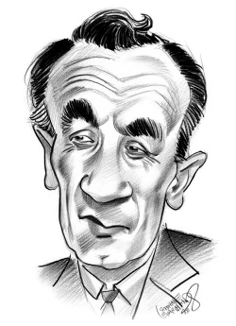
«
suffisant.
Il n'est pas davantage de pensée qui soit complète
ment pensée et qui ne demande à des mots le moyen d'être
présente à elle-même.
Pensée et parole s'escomptent l'une
l'autre.
Elles se substituent continuellement l'une à l'autre.
Elles
sont relais, stimulus l'une pour l'autre.
Toute pensée vient des
paroles et y retourne, toute parole est née dans les pensées et
finit en elles.
Il y a entre les hommes et en chacun une incroya
ble végétation de paroles dont les « pensées » sont la nervure.
- On dira : mais enfin, si la parole est autre chose que bruit
ou son, c'est.
que la pensée y dépose une charge de sens-,
et le sens lexical ou grammatical d'abord-de sorte qu'il n'y
a jamais contact que de la pensée avec la pensée-.
Bien sûr,
des sons ne sont parlants que pour une pensée, cela ne veut
pas dire que la parole soit dérivée ou seconde.
Bien sûr, le
système même du langage a sa structure pensable.
Mais, quand
nous parlons, nous ne la pensons pas comme la pense le lin
guiste, nous n'y pensons pas même, nous pensons à ce que nous
disons.
Ce n'est pas seulement que nous ne puissions penser
à deux choses à la fois : on dirait que, pour avoir devant nous
un signifié, que ce soit à l'émission ou à la réception, il faut
que nous cessions.
de nous représenter le code et même le mes
sage, que nous nous fassions purs opérateurs de la parole.
La
parole opérante fait penser et la pensée vive trouve magique
ment ses mots.
Il n'y a pas la pensée et le langage, chacun des
deux ordres à l'examen se dédouble et envoie un rameau dans
l'autre.
Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Gallimard, 1960, pp.
25-26.
POUR MIEUX COMPRENDRE LE TEXTE
La pensée recourt à la parole comme pour y prendre chair,
mais la parole n'est pas pour autant« dérivée ou seconde» :
la thèse de Merleau-Ponty rend bien compte de ce qui se
passe effectivement lorsque nous parlons.
Il n'y a pas de
séparation entre un moment d'élaboration de pensée pure,
un autre où nous fabriquerions, à partir de nos connaissances
linguistiques, les éno!'lcés les mieux à même de communi
quer* à d'autres le résultat de ce premier travail, et celui enfin.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'existence et la dialectique par Maurice Merleau-Ponty Professeur au Collège de France On connaît le malaise de l'écrivain quand il lui est demandé de faire l'histoire de ses pensées.
- Si la parole présupposait la pensée, si parler c'était d'abord se joindre à l'objet par une intention de connaissance ou par une représentation, on ne comprendrait pas pourquoi la pensée tend vers l'expression comme vers son achèvement … Pourquoi le sujet pensant lui même est dans une sorte d'ignorance de ses pensées tant qu'il ne les a pas formulées… comme le montre l'exemple de tant d'écrivains qui commencent un livre sans savoir au juste ce qu'ils y mettront. Merleau Ponty, La phéno
- [II n'y a pas d'art d'agrément] - Merleau-Ponty
- PROSE DU MONDE (LA), 1969. Maurice Merleau-Ponty
- OEIL ET L’ESPRIT (L’), 1964. Maurice Merleau-Ponty - résumé de l'oeuvre