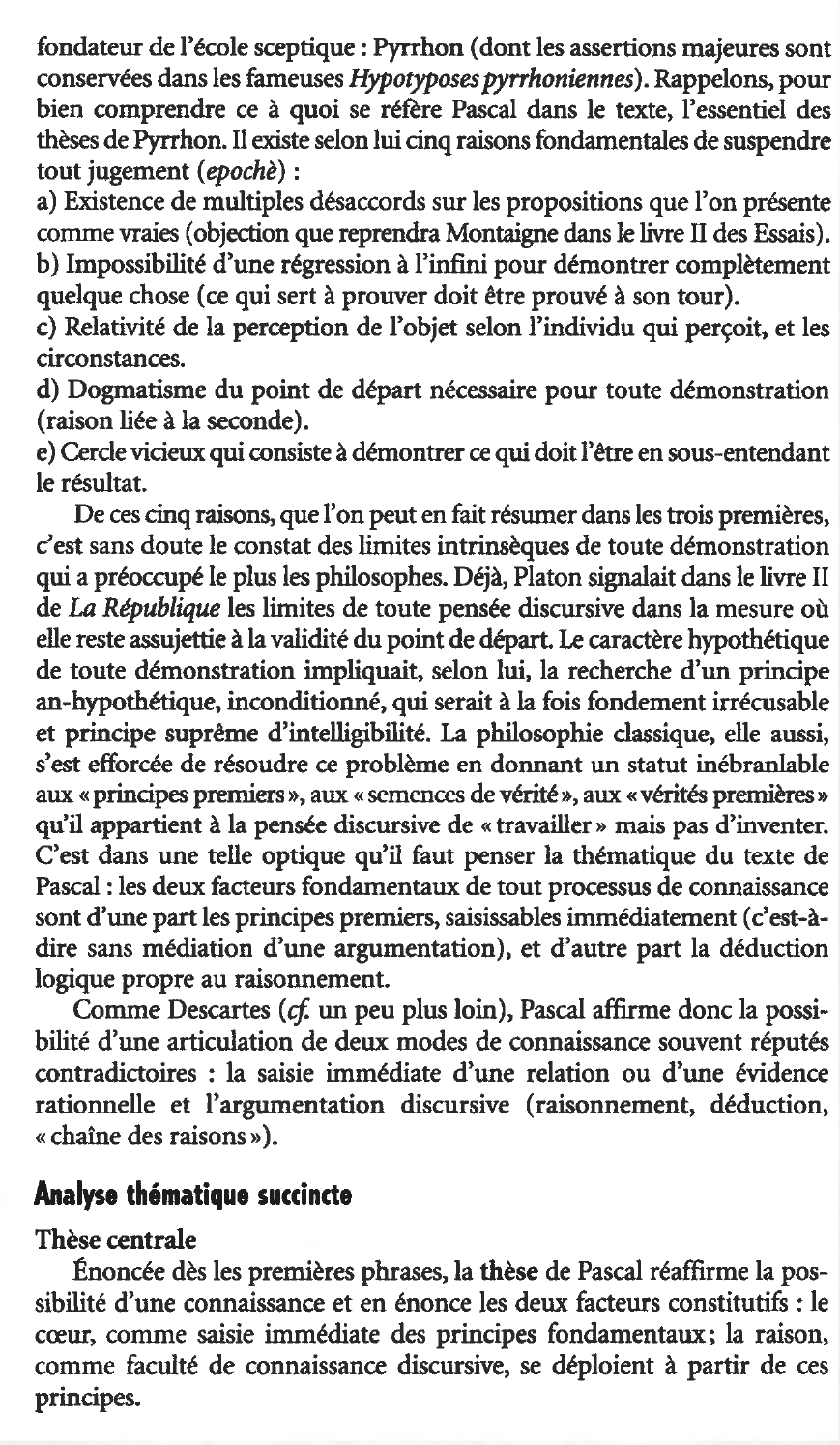Pascal, Pensées, n°282 (Éd. Brunschvicg)
Publié le 12/04/2012

Extrait du document

Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le coeur 1 ; c'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaye de les combattre. Les pyrrhoniens 2 qui n'ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne rêvons point; quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison, cette impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos connaissances, comme ils le prétendent. Car la connaissance des premiers principes, comme qu'il y a espace, temps, mouvement, nombres, est aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent. Et c'est sur ces connaissances du coeur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie, et qu'elle y fonde tout son discours. Le coeur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace, et que les nombres sont infinis; et la raison démontre ensuite qu'il y a point deux nombres carrés dont l'un soit double de l'autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent; et le tout avec certitude, quoique par différentes voies. Et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au coeur des preuves de ses premiers principes, pour vouloir y consentir, qu'il serait ridicule que le coeur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre, pour vouloir les recevoir.

«
fondateur de l'école sceptique: Pyrrhon (dont les assertions majeures sont
conservées dans
les fameuses Hypotyposes pyrrhoniennes).
Rappelons, pour
bien comprendre ce à quoi se réfère Pascal dans le texte, l'essentiel des
thèses de Pyrrhon.
n existe selon lui cinq raisons fondamentales de suspendre
tout jugement
(epochè) :
a) Existence de multiples désaccords sur les propositions que l'on présente
comme vraies (objection que reprendra Montaigne dans le livre
ll des Essais).
b) Impossibilité d'une régression à l'infini
pour démontrer complètement
quelque chose (ce qui sert à prouver doit être prouvé à son tour).
c) Relativité de la perception de l'objet selon l'individu qui perçoit, et les
circonstances.
d) Dogmatisme
du point de départ nécessaire pour toute démonstration
(raison liée à la seconde ).
e) Cercle vicieux qui consiste à démontrer ce qui doit l'être en sous-entendant
le résultat.
De
ces cinq raisons, que l'on peut en fait résumer dans les trois premières,
c 'est sans doute le constat des limites intrinsèques de toute démonstration
qui a préoccupé le plus
les philosophes.
Déjà, Platon signalait dans le livre II
de
La République les limites de toute pensée discursive dans la mesure où
elle reste assujettie à la validité du point de départ.
Le caractère hypothétique
de toute démonstration impliquait, selon lui, la recherche
d'un principe
an-hypothétique, inconditionné, qui serait à la fois fondement irrécusable
et principe suprême d'intelligibilité.
La philosophie classique, elle aussi,
s'est efforcée de résoudre
ce problème en donnant un statut inébranlable
aux« principes premiers », aux « semences de vérité », aux « vérités premières»
qu 'il appartient à la pensée discursive de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte : Pascal, Pensées, 143 édition Brunschvicg (207) - Philosophie
- PASCAL, Pensées, Brunschvicg, fragment 139 / Laf., 269, 1670
- Blaise Pascal, Pensées, (éd. Brunschvicg n° 139)
- Expliquez le texte suivant de Pascal, en essayant de montrer comment, chez l'auteur des Pensées, l'imagination s'allie à la logique (Section II, 72, éd. Brunschvicg).
- Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais encore par le coeur, c'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaie de les combattre. Pascal, Pensées et opuscules, 282. Commentez cette citation.