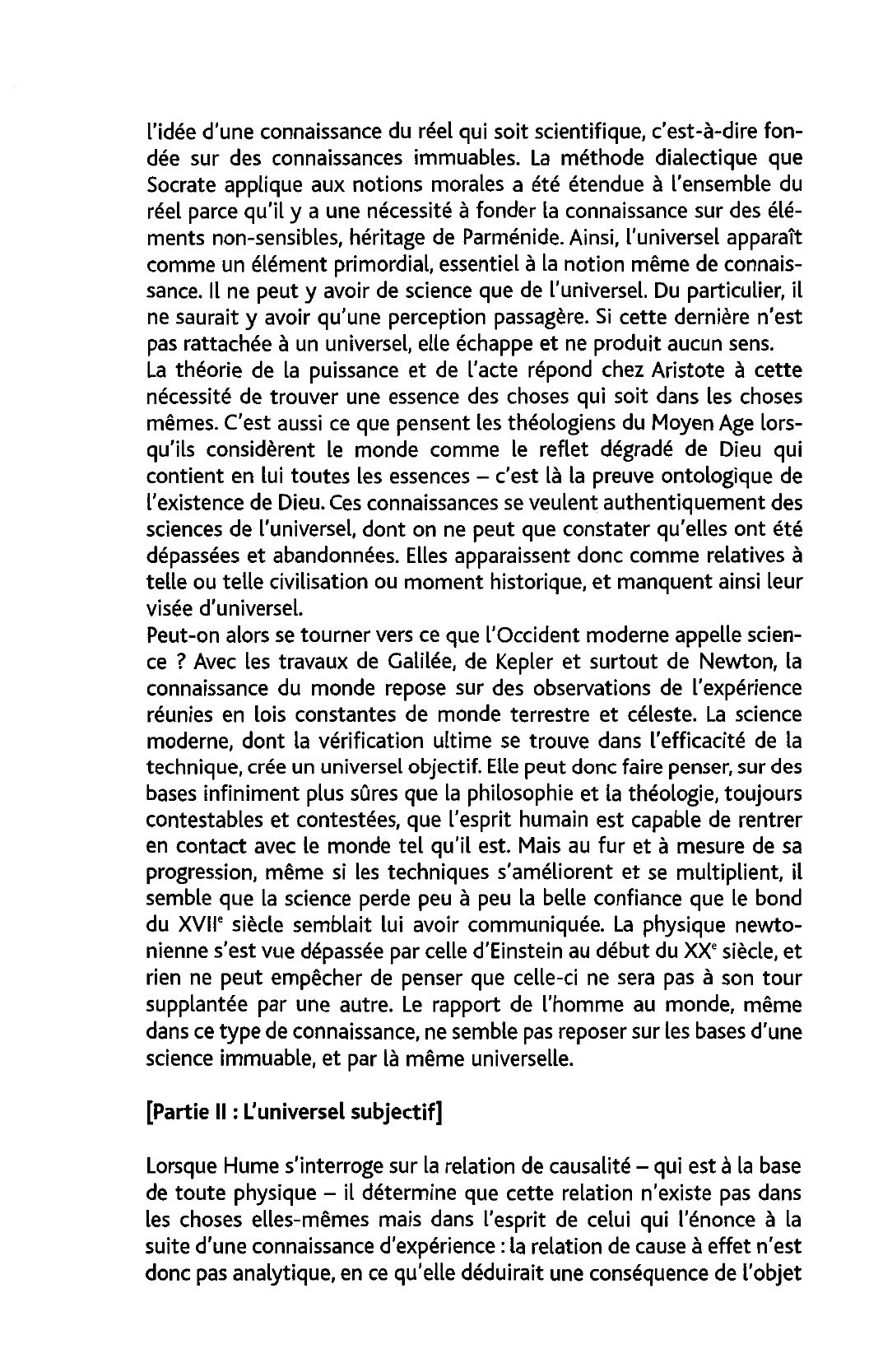Peut-il exister un universel ?
Publié le 22/03/2015

Extrait du document
La méthode dialectique que Socrate applique aux notions morales a été étendue à l'ensemble du réel parce qu'il y a une nécessité à fonder ta connaissance sur des éléments non-sensibles, héritage de Parménide.
Peut-on alors se tourner vers ce que l'Occident moderne appelle science?
La science moderne, dont la vérification ultime se trouve dans l'efficacité de la technique, crée un universel objectif.
Elle peut donc faire penser, sur des bases infiniment plus sûres que la philosophie et ta théologie, toujours contestables et contestées, que l'esprit humain est capable de rentrer en contact avec le monde tel qu'il est.
Ce phénomène est à la fois lié et distinct de la chose en soi, le noumène : il est ce que l'on perçoit du noumène, sans qu'il soit possible de connaître ce dernier pour ce qu'il est véritablement.
Or les catégories de la sensibilité et de l'entendement sont, pour Kant, communes à tous les hommes : l'idéalisme kantien permet ainsi la construction d'une universalité subjective de l'espèce qui peut à tout le moins assurer une connaissance humaine commune --- ce qui revient à un réalisme de fait.
Dans la morale, la raison commande par ce qui, en elle, est raison pure : or ce qui est raison pure est ta faculté de l'universel.
Elle n'est pas connaissance, elle est pratique, c'est-à-dire simplement orientée vers l'action.
Or c'est précisément dans la morale que les idées synthétiques a priori de la métaphysique --- Dieu, l'immortalité de l'âme --- trouvent leur véritable fonction comme postulats de la raison pratique.
«
l'idée d'une connaissance du réel qui soit scientifique, c'est-à-dire fon
dée sur des connaissances immuables.
La méthode dialectique que
Socrate applique aux notions morales a
été étendue à l'ensemble du
réel parce qu'il y a une nécessité à fonder
la connaissance sur des élé
ments non-sensibles, héritage de Parménide.
Ainsi, l'universel apparaît
comme un élément primordial, essentiel à la notion même de connais
sance.
Il ne peut y avoir de science que de l'universel.
Du particulier, il
ne saurait y avoir qu'une perception passagère.
Si cette dernière n'est
pas rattachée à un universel, elle échappe et ne produit aucun sens.
La théorie de la puissance et de l'acte répond chez Aristote à cette
nécessité de trouver une essence des choses qui soit dans les choses
mêmes.
C'est aussi ce que pensent les théologiens du Moyen Age lors
qu'ils considèrent
le monde comme le reflet dégradé de Dieu qui
contient en lui toutes les essences - c'est là la preuve ontologique de
l'existence de Dieu.
Ces connaissances se veulent authentiquement des
sciences de l'universel, dont on ne peut que constater qu'elles ont été
dépassées et abandonnées.
Elles apparaissent donc comme relatives à
telle ou telle civilisation ou
moment historique, et manquent ainsi leur
visée d'universel.
Peut-on alors
se tourner vers ce que l'Occident moderne appelle scien
ce ?
Avec les travaux de Galilée, de Kepler et surtout de Newton, la
connaissance du monde repose sur des observations de l'expérience
réunies en lois
constantes de monde terrestre et céleste.
La science
moderne,
dont la vérification ultime se trouve dans l'efficacité de la
technique, crée un universel objectif.
Elle peut donc faire penser, sur des
bases infiniment plus sûres que
la philosophie et la théologie, toujours
contestables et contestées, que l'esprit humain est capable de rentrer
en
contact avec le monde tel qu'il est.
Mais au fur et à mesure de sa
progression, même si les techniques s'améliorent et se multiplient, il
semble que la science perde peu à peu la belle confiance que le bond
du
XVII' siècle semblait lui avoir communiquée.
La physique newto
nienne s'est vue dépassée par celle d'Einstein au début du XX' siècle, et
rien ne peut empêcher de penser que celle-ci ne sera pas à son tour
supplantée par une autre.
Le rapport de l'homme au monde, même
dans ce type de connaissance, ne semble pas reposer sur les bases d'une
science immuable, et par là même universelle.
[Partie Il : L'universel subjectif]
Lorsque Hume s'interroge sur la relation de causalité -qui est à la base
de toute physique - il détermine que cette relation n'existe pas dans
les choses elles-mêmes mais dans l'esprit
de celui qui l'énonce à la
suite d'une connaissance d'expérience: la relation de cause à effet n'est
donc pas analytique, en ce qu'elle déduirait une conséquence de l'objet
-220-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-il exister un universel ?
- Peut-il exister un universel ?
- Faut-il se résigner à exister dans le temps ? (philosophie)
- Légataire universel (le) de Jean-François Regnard (analyse détaillée)
- EXISTER Jean Follain (résumé)