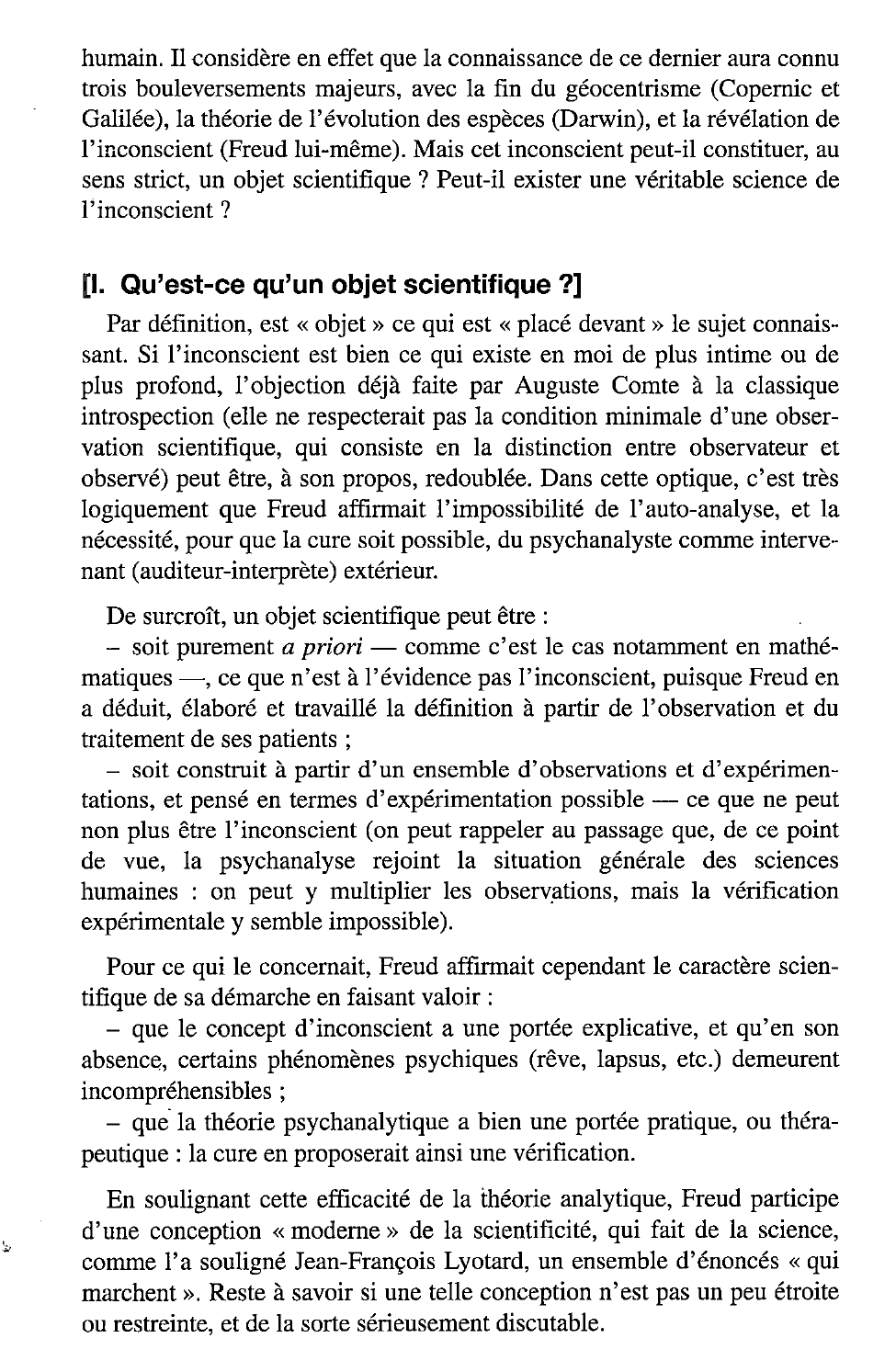Peut-il y avoir une connaissance de l’inconscient ?
Publié le 22/01/2020

Extrait du document
Toute science particulière suppose l’existence d’une méthode : la psychanalyse en propose bien une.
Mais la science suppose aussi l’existence d’un débat ouvert et permanent entre chercheurs travaillant dans le même champ scientifique. De ce point de vue, la théorie analytique paraît avoir un statut très particulier : les « infidèles » à Freud (Adler, Jung) sont condamnés comme dissidents ou hétérodoxes, et marginalisés.
Toute science présente de surcroît une histoire véritable, constituée complémentairement par ses avancées théoriques et par l’élimination de ses erreurs. L’histoire de la psychanalyse n’est que celle de sa diffusion, de ses hérésies, des résistances qu’elle a rencontrées ; mais Freud aurait énoncé une fois pour toutes son contenu théorique, et il s’agirait au mieux de « faire retour »
«
CORRIGÉ2
humain.
Il considère en effet que la connaissance de ce dernier aura connu
trois bouleversements majeurs, avec la fin du géocentrisme (Copernic et
Galilée), la théorie de l'évolution des espèces (Darwin), et la révélation de
l'inconscient (Freud lui-même).
Mais cet inconscient peut-il constituer, au
sens strict, un objet scientifique ? Peut-il exister une véritable science de
l'inconscient?
[I.
Qu'est-ce qu'un objet scientifique ?]
Par définition, est « objet » ce qui est « placé devant » le sujet connais
sant.
Si l'inconscient est bien ce qui existe en moi de plus intime ou de
plus profond, l'objection déjà faite par Auguste Comte à la classique
introspection (elle ne respecterait pas la condition minimale d'une obser
vation scientifique, qui consiste en la distinction entre observateur et
observé) peut être, à son propos, redoublée.
Dans cette optique, c'est très
logiquement que Freud affirmait l'impossibilité de l'auto-analyse, et la
nécessité, pour que la cure soit possible, du psychanalyste comme interve
nant (auditeur-interprète) extérieur.
De surcroît, un objet scientifique peut être :
- soit purement a priori - comme c'est le cas notamment en mathé
matiques-, ce que n'est à l'évidence pas l'inconscient, puisque Freud en
' a déduit, élaboré et travaillé la définition à partir de lobservation et du
traitement de ses patients ;
·.;,.,
)
- soit construit à partir d'un ensemble d'observations et d'expérimen
tations, et pensé en termes d'expérimentation possible - ce que ne peut
non plus être l'inconscient (on peut rappeler au passage que, de ce point
de vue, la psychanalyse rejoint la situation générale des sciences
humaines : on peut y multiplier les observ.ations, mais la vérification
expérimentale y semble impossible).
Pour ce qui le concernait, Freud affirmait cependant le caractère scien
tifique de sa démarche en faisant valoir :
- que le concept d'inconscient a une portée explicative, et qu'en son
absence, certains phénomènes psychiques (rêve, lapsus, etc.) demeurent
incompréhensibles ;
- que la théorie psychanalytique a bien une portée pratique, ou théra
peutique : la cure en proposerait ainsi une vérification.
En soulignant cette efficacité de la théorie analytique, Freud participe
d'une conception «moderne» de la scientificité, qui fait de la science,
comme l'a souligné Jean-François Lyotard, un ensemble d'énoncés «qui
marchent».
Reste à savoir si une telle conception n'est pas un peu étroite
ou restreinte, et de la sorte sérieusement discutable.
27.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La connaissance de l’inconscient est-elle nécessaire à la connaissance de l’homme
- La connaissance de l'inconscient apporte-elle quelque chose d'essentiel à la connaissance de l'Homme ?
- L'inconscient contrarie-t-il la connaissance de soi ?
- La connaissance de l'inconscient apporte-t-elle quelque chose d'essentiel à la connaissance de l'homme ?
- L'inconscient contrarie-t-il la connaissance de soi ?