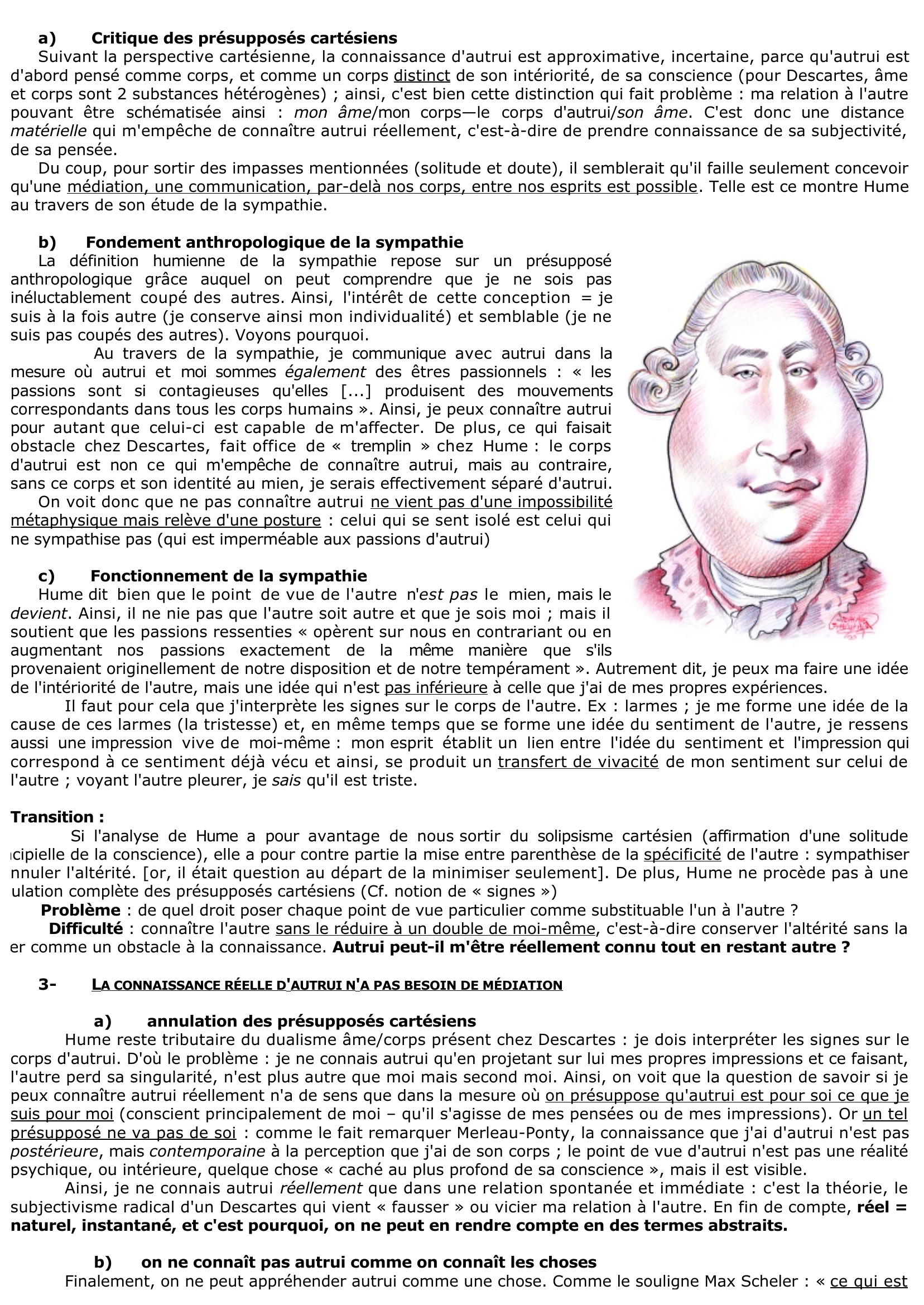peut-on connaître autrui?
Publié le 26/03/2005

Extrait du document
Remarques d’introduction :
- « Puis-je « renvoie à la question du possible ; or est possible 1) ce qui est réalisable c’est-à-dire ce que j’ai les moyens ou la capacité de faire 2) ce qui est permis, c’est-à-dire ce que j’ai le droit de faire.
- Ici la question du droit ne semble d’abord pas problématique : moralement, connaître autrui semble un devoir et non un interdit ; en effet, je ne saurais raisonnablement vivre entouré de personne que j’ignore, soit parce qu’elles me sont inconnues ou étrangères, soit parce que je fais comme si elles n’existait pas (ignorer quelqu’un ici = le « snober «,) ; autrement dit l’ignorance = état cognitif (le non-savoir) et une posture « éthique « (indifférence affichée) ; dans les deux cas, ne semble pas tenable ; il n’y a pas de sens à vouloir s’interdire de connaître autrui, de chercher à l’ignorer.
- La question du fait sera donc première : s’il est louable de vouloir connaître autrui, encore faut-il que cela soit possible. En effet, la difficulté vient de la définition même d’autrui : il n’est pas moi et réciproquement je ne suis pas l’autre.
- Ainsi, il semble qu’on ne dispose pas, a première vue, des moyens de connaître autrui « réellement « c’est-à-dire de savoir qui il est aussi bien que lui le sait.
- Cependant, on ne saurait pour autant éluder la question du droit car, en admettant même que je puisse réellement connaître autrui, cela ne revient-il pas à minimiser son altérité, et dans ce cas, manquer ce qui définit précisément autrui ?
Problématique : Alors que l’ignorance de l’autre paraît favoriser l’égoïsme (« le fait de ne penser qu’à soi et de ne considérer que soi «, Pascal), et du même coup, m’isoler irrémédiablement, il semble que vouloir connaître autrui soit recommandé. Pourtant, est-ce là une chose facile ? Connaître autrui ne va pas de soi, car en effet, comment puis-je connaître réellement quelqu’un qui, par définition, est autre que moi ? Puis-je réellement connaître autrui, ou bien est-ce là un idéal irréalisable?
«
a) Critique des présupposés cartésiens Suivant la perspective cartésienne, la connaissance d'autrui est approximative, incertaine, parce qu'autrui est d'abord pensé comme corps, et comme un corps distinct de son intériorité, de sa conscience (pour Descartes, âme et corps sont 2 substances hétérogènes) ; ainsi, c'est bien cette distinction qui fait problème : ma relation à l'autrepouvant être schématisée ainsi : mon âme /mon corps—le corps d'autrui/ son âme .
C'est donc une distance matérielle qui m'empêche de connaître autrui réellement, c'est-à-dire de prendre connaissance de sa subjectivité, de sa pensée. Du coup, pour sortir des impasses mentionnées (solitude et doute), il semblerait qu'il faille seulement concevoir qu'une médiation, une communication, par-delà nos corps, entre nos esprits est possible .
Telle est ce montre Hume au travers de son étude de la sympathie. b) Fondement anthropologique de la sympathie La définition humienne de la sympathie repose sur un présupposé anthropologique grâce auquel on peut comprendre que je ne sois pasinéluctablement coupé des autres.
Ainsi, l'intérêt de cette conception = jesuis à la fois autre (je conserve ainsi mon individualité) et semblable (je nesuis pas coupés des autres).
Voyons pourquoi. Au travers de la sympathie, je communique avec autrui dans la mesure où autrui et moi sommes également des êtres passionnels : « les passions sont si contagieuses qu'elles [...] produisent des mouvementscorrespondants dans tous les corps humains ».
Ainsi, je peux connaître autruipour autant que celui-ci est capable de m'affecter.
De plus, ce qui faisaitobstacle chez Descartes, fait office de « tremplin » chez Hume : le corpsd'autrui est non ce qui m'empêche de connaître autrui, mais au contraire,sans ce corps et son identité au mien, je serais effectivement séparé d'autrui. On voit donc que ne pas connaître autrui ne vient pas d'une impossibilité métaphysique mais relève d'une posture : celui qui se sent isolé est celui qui ne sympathise pas (qui est imperméable aux passions d'autrui) c) Fonctionnement de la sympathie Hume dit bien que le point de vue de l'autre n' est pas le mien, mais le devient .
Ainsi, il ne nie pas que l'autre soit autre et que je sois moi ; mais il soutient que les passions ressenties « opèrent sur nous en contrariant ou enaugmentant nos passions exactement de la même manière que s'ilsprovenaient originellement de notre disposition et de notre tempérament ».
Autrement dit, je peux ma faire une idéede l'intériorité de l'autre, mais une idée qui n'est pas inférieure à celle que j'ai de mes propres expériences. Il faut pour cela que j'interprète les signes sur le corps de l'autre.
Ex : larmes ; je me forme une idée de la cause de ces larmes (la tristesse) et, en même temps que se forme une idée du sentiment de l'autre, je ressensaussi une impression vive de moi-même : mon esprit établit un lien entre l'idée du sentiment et l'impression quicorrespond à ce sentiment déjà vécu et ainsi, se produit un transfert de vivacité de mon sentiment sur celui de l'autre ; voyant l'autre pleurer, je sais qu'il est triste. Transition : · Si l'analyse de Hume a pour avantage de nous sortir du solipsisme cartésien (affirmation d'une solitude principielle de la conscience), elle a pour contre partie la mise entre parenthèse de la spécificité de l'autre : sympathiser = annuler l'altérité.
[or, il était question au départ de la minimiser seulement].
De plus, Hume ne procède pas à uneannulation complète des présupposés cartésiens (Cf.
notion de « signes »)· Problème : de quel droit poser chaque point de vue particulier comme substituable l'un à l'autre ? · Difficulté : connaître l'autre sans le réduire à un double de moi-même , c'est-à-dire conserver l'altérité sans la poser comme un obstacle à la connaissance.
Autrui peut-il m'être réellement connu tout en restant autre ? 3- LA CONNAISSANCE RÉELLE D 'AUTRUI N 'A PAS BESOIN DE MÉDIATION a) annulation des présupposés cartésiens Hume reste tributaire du dualisme âme/corps présent chez Descartes : je dois interpréter les signes sur le corps d'autrui.
D'où le problème : je ne connais autrui qu'en projetant sur lui mes propres impressions et ce faisant,l'autre perd sa singularité, n'est plus autre que moi mais second moi.
Ainsi, on voit que la question de savoir si jepeux connaître autrui réellement n'a de sens que dans la mesure où on présuppose qu'autrui est pour soi ce que je suis pour moi (conscient principalement de moi – qu'il s'agisse de mes pensées ou de mes impressions).
Or un tel présupposé ne va pas de soi : comme le fait remarquer Merleau-Ponty, la connaissance que j'ai d'autrui n'est pas postérieure , mais contemporaine à la perception que j'ai de son corps ; le point de vue d'autrui n'est pas une réalité psychique, ou intérieure, quelque chose « caché au plus profond de sa conscience », mais il est visible. Ainsi, je ne connais autrui réellement que dans une relation spontanée et immédiate : c'est la théorie, le subjectivisme radical d'un Descartes qui vient « fausser » ou vicier ma relation à l'autre.
En fin de compte, réel = naturel, instantané, et c'est pourquoi, on ne peut en rendre compte en des termes abstraits.
b) on ne connaît pas autrui comme on connaît les choses Finalement, on ne peut appréhender autrui comme une chose.
Comme le souligne Max Scheler : « ce qui est.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La conscience me fait-elle connaître que je suis libre ?
- Dissertation de philosophie : "Suis-je le mieux placé pour me connaître?"
- Prénom : Date : Cycle 3 Connaître son corps Ça circule... S'entraîner a.
- Connaître sa propre histoire Découvrir Ma carte d'identité Conseil : faire compléter, si possible, la carte d'identité par les parents.
- Connaître les compléments à la dizaine Découvrir La table du 10 Matériel : le répertoire du 10 constitué pendant les activités préparatoires.