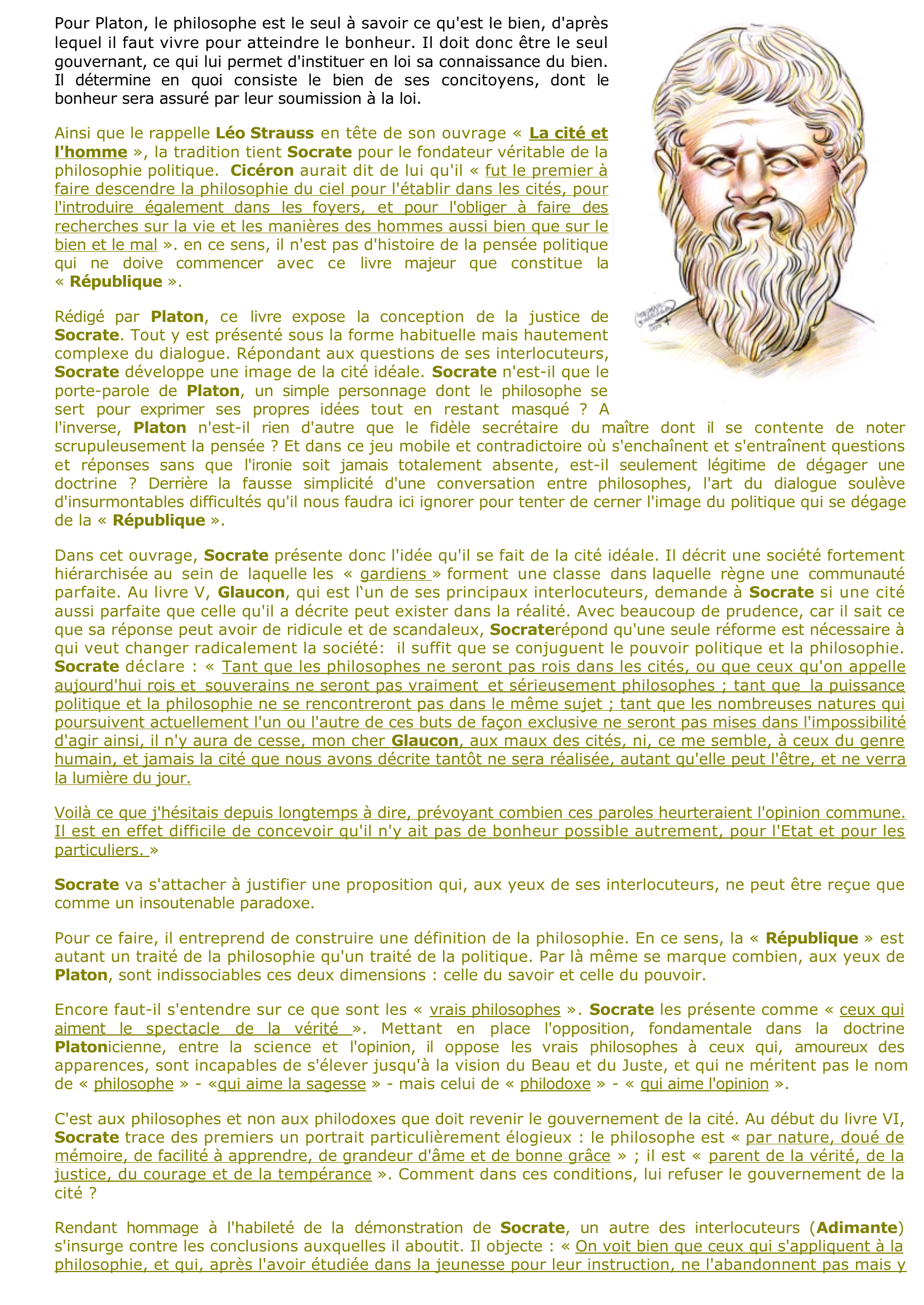Peut-on faire le bonheur des autres?
Publié le 08/01/2005

Extrait du document
L'homme ne peut s'épanouir qu'au sein d'une société, son boheur dépend autant de lui que des autres. Chacun peut et doit contribuer au bonheur de ses semblables. Mais, la conscience du bonheur est individuelle et subjective. De plus, le bonheur des uns et souvent incompatible avec celui des autres. Faire le bonheur des autres serait, en définitive, se rendre malheureux. La vie en société nous impose des règles qui nous empêchent d'être heureux.
«
Pour Platon, le philosophe est le seul à savoir ce qu'est le bien, d'aprèslequel il faut vivre pour atteindre le bonheur.
Il doit donc être le seulgouvernant, ce qui lui permet d'instituer en loi sa connaissance du bien.Il détermine en quoi consiste le bien de ses concitoyens, dont lebonheur sera assuré par leur soumission à la loi.
Ainsi que le rappelle Léo Strauss en tête de son ouvrage « La cité et l'homme », la tradition tient Socrate pour le fondateur véritable de la philosophie politique.
Cicéron aurait dit de lui qu'il « fut le premier à faire descendre la philosophie du ciel pour l'établir dans les cités, pourl'introduire également dans les foyers, et pour l'obliger à faire desrecherches sur la vie et les manières des hommes aussi bien que sur lebien et le mal ».
en ce sens, il n'est pas d'histoire de la pensée politique qui ne doive commencer avec ce livre majeur que constitue la« République ».
Rédigé par Platon , ce livre expose la conception de la justice de Socrate .
Tout y est présenté sous la forme habituelle mais hautement complexe du dialogue.
Répondant aux questions de ses interlocuteurs,Socrate développe une image de la cité idéale.
Socrate n'est-il que le porte-parole de Platon , un simple personnage dont le philosophe se sert pour exprimer ses propres idées tout en restant masqué ? Al'inverse, Platon n'est-il rien d'autre que le fidèle secrétaire du maître dont il se contente de noter scrupuleusement la pensée ? Et dans ce jeu mobile et contradictoire où s'enchaînent et s'entraînent questionset réponses sans que l'ironie soit jamais totalement absente, est-il seulement légitime de dégager unedoctrine ? Derrière la fausse simplicité d'une conversation entre philosophes, l'art du dialogue soulèved'insurmontables difficultés qu'il nous faudra ici ignorer pour tenter de cerner l'image du politique qui se dégagede la « République ».
Dans cet ouvrage, Socrate présente donc l'idée qu'il se fait de la cité idéale.
Il décrit une société fortement hiérarchisée au sein de laquelle les « gardiens » forment une classe dans laquelle règne une communauté parfaite.
Au livre V, Glaucon , qui est l‘un de ses principaux interlocuteurs, demande à Socrate si une cité aussi parfaite que celle qu'il a décrite peut exister dans la réalité.
Avec beaucoup de prudence, car il sait ceque sa réponse peut avoir de ridicule et de scandaleux, Socrate répond qu'une seule réforme est nécessaire à qui veut changer radicalement la société: il suffit que se conjuguent le pouvoir politique et la philosophie.Socrate déclare : « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu'on appelle aujourd'hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la puissancepolitique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet ; tant que les nombreuses natures quipoursuivent actuellement l'un ou l'autre de ces buts de façon exclusive ne seront pas mises dans l'impossibilitéd'agir ainsi, il n'y aura de cesse, mon cher Glaucon , aux maux des cités, ni, ce me semble, à ceux du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite tantôt ne sera réalisée, autant qu'elle peut l'être, et ne verrala lumière du jour.
Voilà ce que j'hésitais depuis longtemps à dire, prévoyant combien ces paroles heurteraient l'opinion commune.Il est en effet difficile de concevoir qu'il n'y ait pas de bonheur possible autrement, pour l'Etat et pour lesparticuliers.
»
Socrate va s'attacher à justifier une proposition qui, aux yeux de ses interlocuteurs, ne peut être reçue que comme un insoutenable paradoxe.
Pour ce faire, il entreprend de construire une définition de la philosophie.
En ce sens, la « République » est autant un traité de la philosophie qu'un traité de la politique.
Par là même se marque combien, aux yeux dePlaton , sont indissociables ces deux dimensions : celle du savoir et celle du pouvoir.
Encore faut-il s'entendre sur ce que sont les « vrais philosophes ».
Socrate les présente comme « ceux qui aiment le spectacle de la vérité ».
Mettant en place l'opposition, fondamentale dans la doctrine Platon icienne, entre la science et l'opinion, il oppose les vrais philosophes à ceux qui, amoureux des apparences, sont incapables de s'élever jusqu'à la vision du Beau et du Juste, et qui ne méritent pas le nomde « philosophe » - « qui aime la sagesse » - mais celui de « philodoxe » - « qui aime l'opinion ».
C'est aux philosophes et non aux philodoxes que doit revenir le gouvernement de la cité.
Au début du livre VI,Socrate trace des premiers un portrait particulièrement élogieux : le philosophe est « par nature, doué de mémoire, de facilité à apprendre, de grandeur d'âme et de bonne grâce » ; il est « parent de la vérité, de la justice, du courage et de la tempérance ».
Comment dans ces conditions, lui refuser le gouvernement de la cité ?
Rendant hommage à l'habileté de la démonstration de Socrate , un autre des interlocuteurs ( Adimante ) s'insurge contre les conclusions auxquelles il aboutit.
Il objecte : « On voit bien que ceux qui s'appliquent à la philosophie, et qui, après l'avoir étudiée dans la jeunesse pour leur instruction, ne l'abandonnent pas mais y.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on faire le bonheur d'autrui ?
- Que signifie « faire le bonheur des autres » ?
- Ai-je le devoir de faire le bonheur des autres?
- L’industrie peut-elle faire le bonheur de l’homme?
- Faire le bonheur des autres ?