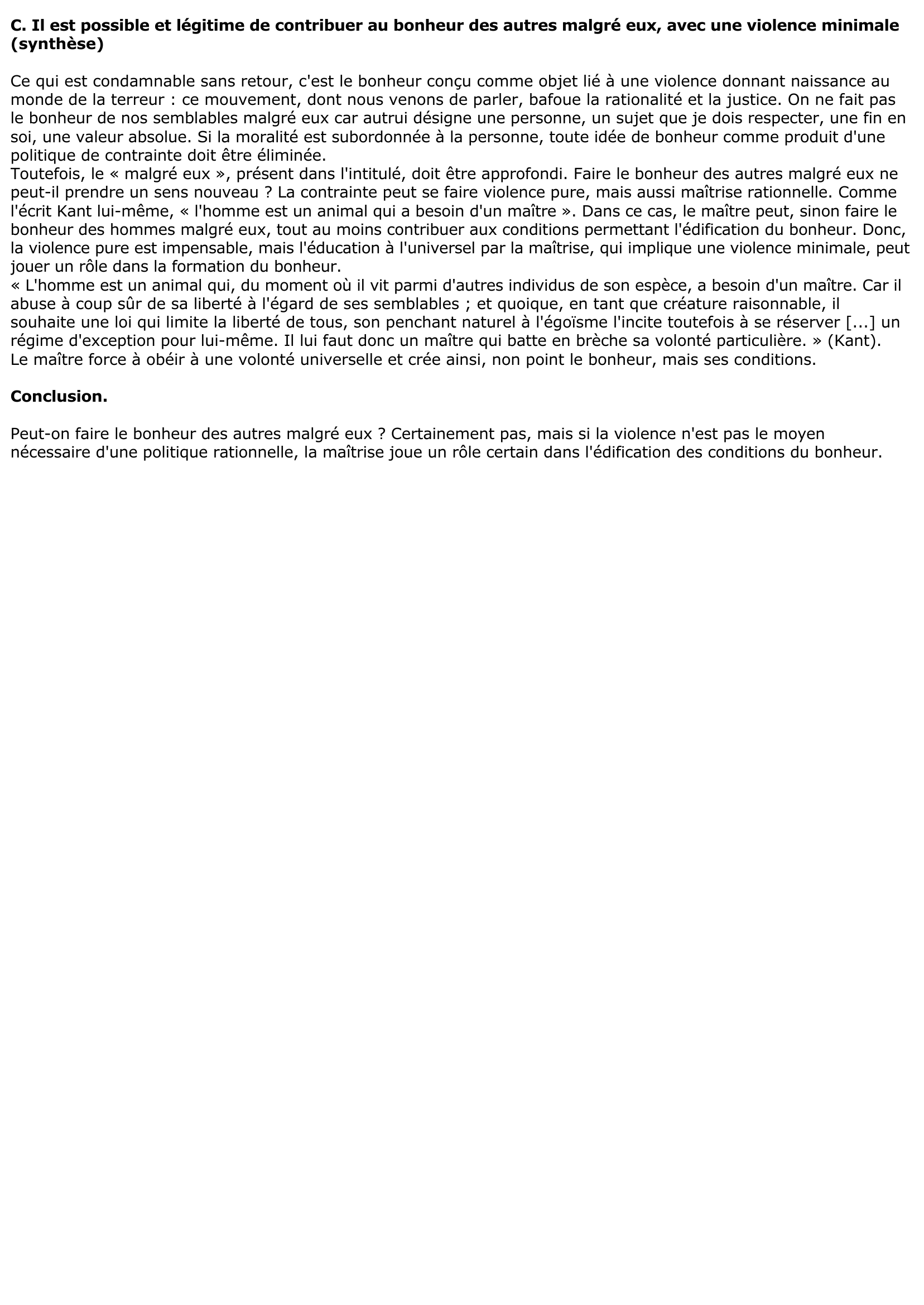Peut-on faire le bonheur des autres malgré eux ?
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Est-ce bien possible, tout d'abord ?Sur le plan de la possibilité, qu'en est-il exactement ? Est dit physiquement possible ce qui satisfait aux conditions générales de l'expérience, mais aussi ce qui n'est en contradiction avec aucun fait empiriquement établi, et, enfin, ce qui est plus ou moins possible.Or, faire le bonheur de mes semblables malgré eux semble plutôt en contradiction avec ce qui est empiriquement établi et ne paraît pas davantage de l'ordre du possible. Les conditions générales de l'expérience nous signalent l'échec de ce type de tentatives. Est possible ce qui n'est pas condamné d'avance. Or, les essais multiples de rendre nos semblables heureux malgré eux ont tous abouti, dans le champ politique, à des échecs. Dans le champ éducatif, il semble aussi que l'expérience conduise au rejet de l'idée. De plus en plus, la spontanéité de l'enfant est prise en compte, sinon totalement privilégiée.Qu'en est-il, maintenant, de la légitimité?
· Angles d’analyse
® Il semble que le bonheur, bien qu’on ne puisse le définir claire de manière immédiate (chacun paraissant avoir une conception individuelle du bonheur), on s’accorde néanmoins sur une définition du bonheur comme aspiration fondamentale de l’homme.
® Pourtant, cet accord résiste mal à la tentative d’en déterminer le contenu que chacun imagine au gré de ses désirs et de ses espoirs : c’est en ce sens qu’il s’agit de se demander si un sujet (possédant une vision singulière du bonheur) peut, c’est-à-dire encore à la fois à la possibilité technique et la possibilité de droit, faire le bonheur d’un autre sujet (possédant lui aussi une autre vision singulière du bonheur).
® La difficulté réside d’autant plus dans le « malgré eux « : il semble en effet que déjà la question du « faire le bonheur de l’autre «, de droit comme de fait, n’est pas chose facile, mais si cet autre ne le désire pas (puisque le « malgré eux « détermine un non-désir, voire un refus, de la volonté des autres en question), alors cela est-il encore possible ?
® Il s’agit en creux de s’interroger sur la notion de bonheur, pour essayer d’en déterminer la nature : c’est cette nature et cette essence qui vont nous permettre de répondre à la question, à la fois du point de vue du fait mais aussi du point de vue du droit.
Problématique
Est-il possible de fait de faire en sorte que les autres soient heureux quand ils ne le désirent pas eux-mêmes, et surtout lorsqu’on ne sait pas nous-mêmes définir clairement et universellement ce que c’est que le bonheur ? Cette difficulté inscrite de fait, interroger a fortiori le droit : peut-on légitiment imposer à l’autre sa conception du bonheur, quand celui-ci s’y refuse, sous le prétexte d’un « c’est pour ton bien « ? C’est ici à la fois la question de la nature du bonheur, mais aussi celle de la relation à autrui qui sont ici en jeu.
«
C.
Il est possible et légitime de contribuer au bonheur des autres malgré eux, avec une violence minimale(synthèse)
Ce qui est condamnable sans retour, c'est le bonheur conçu comme objet lié à une violence donnant naissance aumonde de la terreur : ce mouvement, dont nous venons de parler, bafoue la rationalité et la justice.
On ne fait pasle bonheur de nos semblables malgré eux car autrui désigne une personne, un sujet que je dois respecter, une fin ensoi, une valeur absolue.
Si la moralité est subordonnée à la personne, toute idée de bonheur comme produit d'unepolitique de contrainte doit être éliminée.Toutefois, le « malgré eux », présent dans l'intitulé, doit être approfondi.
Faire le bonheur des autres malgré eux nepeut-il prendre un sens nouveau ? La contrainte peut se faire violence pure, mais aussi maîtrise rationnelle.
Commel'écrit Kant lui-même, « l'homme est un animal qui a besoin d'un maître ».
Dans ce cas, le maître peut, sinon faire lebonheur des hommes malgré eux, tout au moins contribuer aux conditions permettant l'édification du bonheur.
Donc,la violence pure est impensable, mais l'éducation à l'universel par la maîtrise, qui implique une violence minimale, peutjouer un rôle dans la formation du bonheur.« L'homme est un animal qui, du moment où il vit parmi d'autres individus de son espèce, a besoin d'un maître.
Car ilabuse à coup sûr de sa liberté à l'égard de ses semblables ; et quoique, en tant que créature raisonnable, ilsouhaite une loi qui limite la liberté de tous, son penchant naturel à l'égoïsme l'incite toutefois à se réserver [...] unrégime d'exception pour lui-même.
Il lui faut donc un maître qui batte en brèche sa volonté particulière.
» (Kant).Le maître force à obéir à une volonté universelle et crée ainsi, non point le bonheur, mais ses conditions.
Conclusion.
Peut-on faire le bonheur des autres malgré eux ? Certainement pas, mais si la violence n'est pas le moyennécessaire d'une politique rationnelle, la maîtrise joue un rôle certain dans l'édification des conditions du bonheur..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on faire le bonheur d'autrui ?
- Que signifie « faire le bonheur des autres » ?
- Ai-je le devoir de faire le bonheur des autres?
- L’industrie peut-elle faire le bonheur de l’homme?
- Faire le bonheur des autres ?