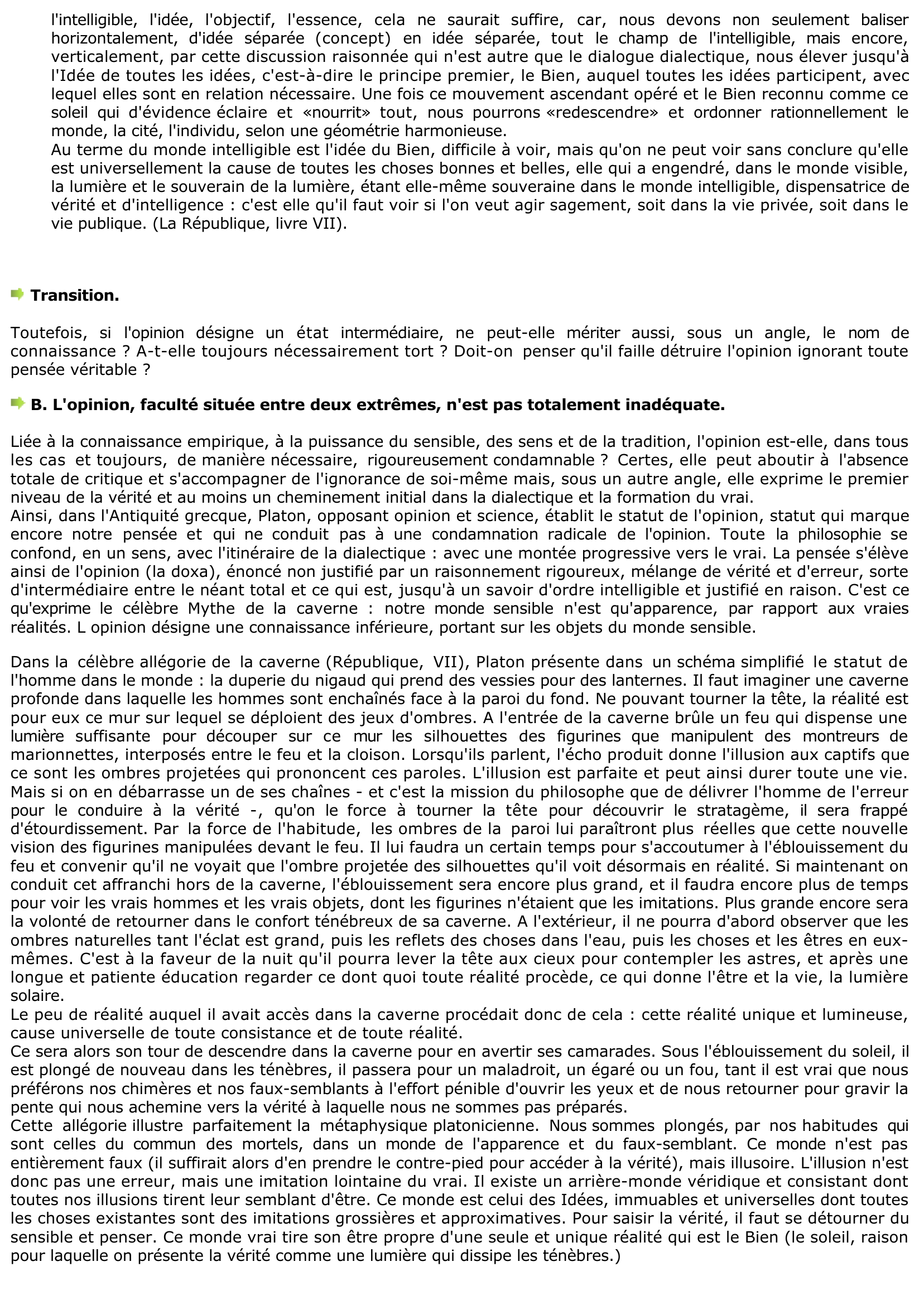Peut-on justifier une opinion ?
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
Justifier une opinion, c'est tenter de montrer qu'elle est vraie, ou que, faute de preuve, elle est légitime. Mais, il y a un risque d'illusion dans la mesure où l'on peut adhérer à une opinion pour des motifs inconscients ou idéologiques. Une opinion vraiment justifiée deviendrait une connaissance.
«
l'intelligible, l'idée, l'objectif, l'essence, cela ne saurait suffire, car, nous devons non seulement baliserhorizontalement, d'idée séparée (concept) en idée séparée, tout le champ de l'intelligible, mais encore,verticalement, par cette discussion raisonnée qui n'est autre que le dialogue dialectique, nous élever jusqu'àl'Idée de toutes les idées, c'est-à-dire le principe premier, le Bien, auquel toutes les idées participent, aveclequel elles sont en relation nécessaire.
Une fois ce mouvement ascendant opéré et le Bien reconnu comme cesoleil qui d'évidence éclaire et «nourrit» tout, nous pourrons «redescendre» et ordonner rationnellement lemonde, la cité, l'individu, selon une géométrie harmonieuse.Au terme du monde intelligible est l'idée du Bien, difficile à voir, mais qu'on ne peut voir sans conclure qu'elleest universellement la cause de toutes les choses bonnes et belles, elle qui a engendré, dans le monde visible,la lumière et le souverain de la lumière, étant elle-même souveraine dans le monde intelligible, dispensatrice devérité et d'intelligence : c'est elle qu'il faut voir si l'on veut agir sagement, soit dans la vie privée, soit dans levie publique.
(La République, livre VII).
Transition.
Toutefois, si l'opinion désigne un état intermédiaire, ne peut-elle mériter aussi, sous un angle, le nom deconnaissance ? A-t-elle toujours nécessairement tort ? Doit-on penser qu'il faille détruire l'opinion ignorant toutepensée véritable ?
B.
L'opinion, faculté située entre deux extrêmes, n'est pas totalement inadéquate.
Liée à la connaissance empirique, à la puissance du sensible, des sens et de la tradition, l'opinion est-elle, dans tousles cas et toujours, de manière nécessaire, rigoureusement condamnable ? Certes, elle peut aboutir à l'absencetotale de critique et s'accompagner de l'ignorance de soi-même mais, sous un autre angle, elle exprime le premierniveau de la vérité et au moins un cheminement initial dans la dialectique et la formation du vrai.Ainsi, dans l'Antiquité grecque, Platon, opposant opinion et science, établit le statut de l'opinion, statut qui marqueencore notre pensée et qui ne conduit pas à une condamnation radicale de l'opinion.
Toute la philosophie seconfond, en un sens, avec l'itinéraire de la dialectique : avec une montée progressive vers le vrai.
La pensée s'élèveainsi de l'opinion (la doxa), énoncé non justifié par un raisonnement rigoureux, mélange de vérité et d'erreur, sorted'intermédiaire entre le néant total et ce qui est, jusqu'à un savoir d'ordre intelligible et justifié en raison.
C'est cequ'exprime le célèbre Mythe de la caverne : notre monde sensible n'est qu'apparence, par rapport aux vraiesréalités.
L opinion désigne une connaissance inférieure, portant sur les objets du monde sensible.
Dans la célèbre allégorie de la caverne (République, VII), Platon présente dans un schéma simplifié le statut del'homme dans le monde : la duperie du nigaud qui prend des vessies pour des lanternes.
Il faut imaginer une caverneprofonde dans laquelle les hommes sont enchaînés face à la paroi du fond.
Ne pouvant tourner la tête, la réalité estpour eux ce mur sur lequel se déploient des jeux d'ombres.
A l'entrée de la caverne brûle un feu qui dispense unelumière suffisante pour découper sur ce mur les silhouettes des figurines que manipulent des montreurs demarionnettes, interposés entre le feu et la cloison.
Lorsqu'ils parlent, l'écho produit donne l'illusion aux captifs quece sont les ombres projetées qui prononcent ces paroles.
L'illusion est parfaite et peut ainsi durer toute une vie.Mais si on en débarrasse un de ses chaînes - et c'est la mission du philosophe que de délivrer l'homme de l'erreurpour le conduire à la vérité -, qu'on le force à tourner la tête pour découvrir le stratagème, il sera frappéd'étourdissement.
Par la force de l'habitude, les ombres de la paroi lui paraîtront plus réelles que cette nouvellevision des figurines manipulées devant le feu.
Il lui faudra un certain temps pour s'accoutumer à l'éblouissement dufeu et convenir qu'il ne voyait que l'ombre projetée des silhouettes qu'il voit désormais en réalité.
Si maintenant onconduit cet affranchi hors de la caverne, l'éblouissement sera encore plus grand, et il faudra encore plus de tempspour voir les vrais hommes et les vrais objets, dont les figurines n'étaient que les imitations.
Plus grande encore serala volonté de retourner dans le confort ténébreux de sa caverne.
A l'extérieur, il ne pourra d'abord observer que lesombres naturelles tant l'éclat est grand, puis les reflets des choses dans l'eau, puis les choses et les êtres en eux-mêmes.
C'est à la faveur de la nuit qu'il pourra lever la tête aux cieux pour contempler les astres, et après unelongue et patiente éducation regarder ce dont quoi toute réalité procède, ce qui donne l'être et la vie, la lumièresolaire.Le peu de réalité auquel il avait accès dans la caverne procédait donc de cela : cette réalité unique et lumineuse,cause universelle de toute consistance et de toute réalité.Ce sera alors son tour de descendre dans la caverne pour en avertir ses camarades.
Sous l'éblouissement du soleil, ilest plongé de nouveau dans les ténèbres, il passera pour un maladroit, un égaré ou un fou, tant il est vrai que nouspréférons nos chimères et nos faux-semblants à l'effort pénible d'ouvrir les yeux et de nous retourner pour gravir lapente qui nous achemine vers la vérité à laquelle nous ne sommes pas préparés.Cette allégorie illustre parfaitement la métaphysique platonicienne.
Nous sommes plongés, par nos habitudes quisont celles du commun des mortels, dans un monde de l'apparence et du faux-semblant.
Ce monde n'est pasentièrement faux (il suffirait alors d'en prendre le contre-pied pour accéder à la vérité), mais illusoire.
L'illusion n'estdonc pas une erreur, mais une imitation lointaine du vrai.
Il existe un arrière-monde véridique et consistant donttoutes nos illusions tirent leur semblant d'être.
Ce monde est celui des Idées, immuables et universelles dont toutesles choses existantes sont des imitations grossières et approximatives.
Pour saisir la vérité, il faut se détourner dusensible et penser.
Ce monde vrai tire son être propre d'une seule et unique réalité qui est le Bien (le soleil, raisonpour laquelle on présente la vérité comme une lumière qui dissipe les ténèbres.).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- «Avec Jean Giraudoux, Électre devient une sorte de tragi-comédie merveilleusement subtile [...] alliant la verve ironique à la pathétique éloquence et évoluant même, au deuxième acte, vers le drame policier », écrivait, en 1937, Edmond Sée dans l'oeuvre. Trouvez-vous dans Électre de quoi justifier cette opinion ?
- PEUT-ON JUSTIFIER UNE OPINION ?
- Dissertation gratuite: Peut-on justifier une opinion ?
- Anne Ubersfeld définit la problématique du drame romantique comme celle d'un personnage en quête de soi et qui parviendra « à une révélation généralement mortelle de son identité propre». Pouvez-vous justifier cette opinion en l'appliquant au drame romantique que vous avez étudié ?
- On ne peut se défaire de la métaphysique comme on se défait d'une opinion. Heidegger