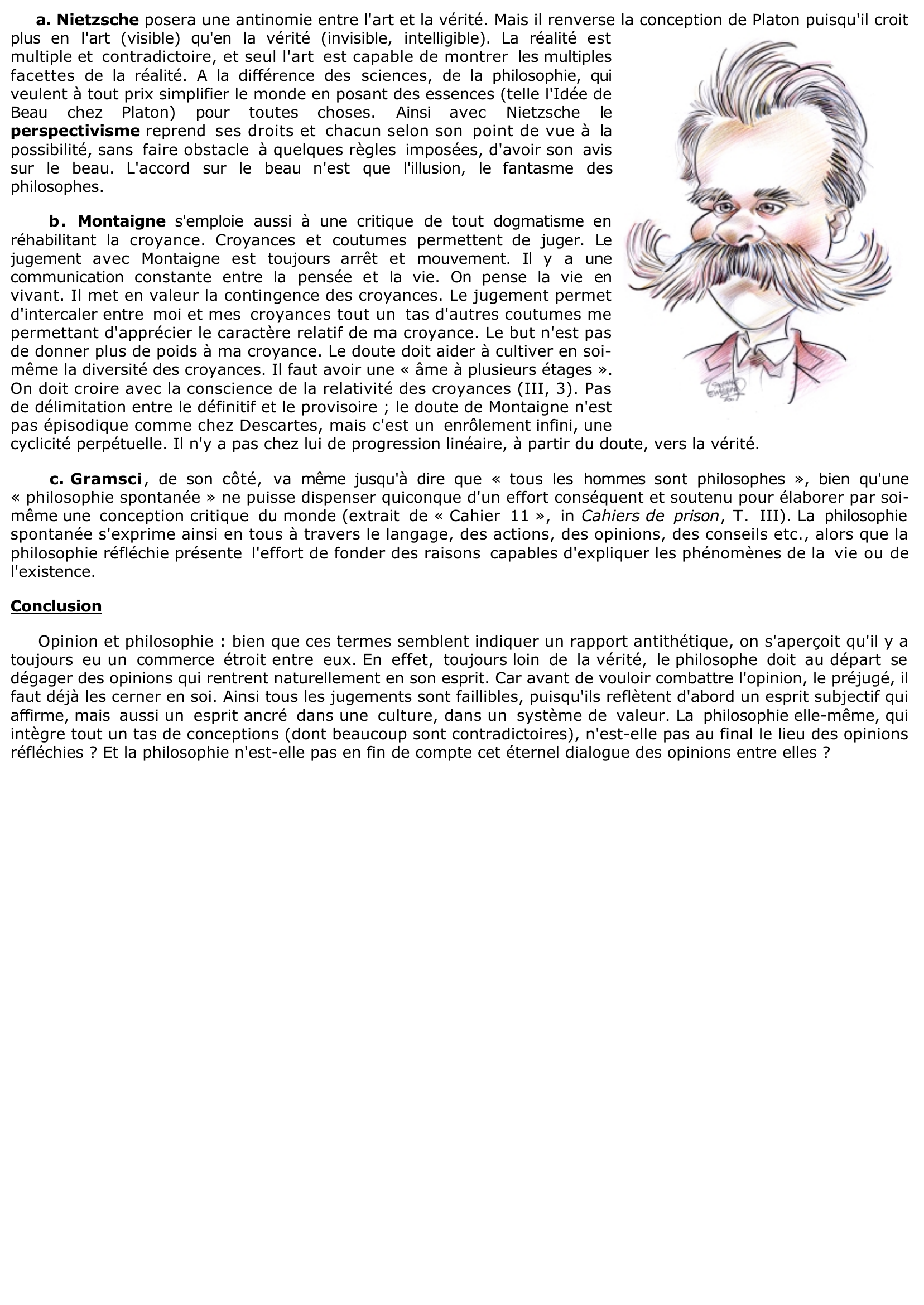Philosophie et opinion ?
Publié le 02/02/2004

Extrait du document


«
a.
Nietzsche posera une antinomie entre l'art et la vérité.
Mais il renverse la conception de Platon puisqu'il croit plus en l'art (visible) qu'en la vérité (invisible, intelligible).
La réalité estmultiple et contradictoire, et seul l'art est capable de montrer les multiplesfacettes de la réalité.
A la différence des sciences, de la philosophie, quiveulent à tout prix simplifier le monde en posant des essences (telle l'Idée deBeau chez Platon) pour toutes choses.
Ainsi avec Nietzsche leperspectivisme reprend ses droits et chacun selon son point de vue à la possibilité, sans faire obstacle à quelques règles imposées, d'avoir son avissur le beau.
L'accord sur le beau n'est que l'illusion, le fantasme desphilosophes.
b. Montaigne s'emploie aussi à une critique de tout dogmatisme en réhabilitant la croyance.
Croyances et coutumes permettent de juger.
Lejugement avec Montaigne est toujours arrêt et mouvement.
Il y a unecommunication constante entre la pensée et la vie.
On pense la vie envivant.
Il met en valeur la contingence des croyances.
Le jugement permetd'intercaler entre moi et mes croyances tout un tas d'autres coutumes mepermettant d'apprécier le caractère relatif de ma croyance.
Le but n'est pasde donner plus de poids à ma croyance.
Le doute doit aider à cultiver en soi-même la diversité des croyances.
Il faut avoir une « âme à plusieurs étages ».On doit croire avec la conscience de la relativité des croyances (III, 3).
Pasde délimitation entre le définitif et le provisoire ; le doute de Montaigne n'estpas épisodique comme chez Descartes, mais c'est un enrôlement infini, unecyclicité perpétuelle.
Il n'y a pas chez lui de progression linéaire, à partir du doute, vers la vérité.
c.
Gramsci , de son côté, va même jusqu'à dire que « tous les hommes sont philosophes », bien qu'une « philosophie spontanée » ne puisse dispenser quiconque d'un effort conséquent et soutenu pour élaborer par soi-même une conception critique du monde (extrait de « Cahier 11 », in Cahiers de prison , T.
III).
La philosophie spontanée s'exprime ainsi en tous à travers le langage, des actions, des opinions, des conseils etc., alors que laphilosophie réfléchie présente l'effort de fonder des raisons capables d'expliquer les phénomènes de la vie ou del'existence.
Conclusion
Opinion et philosophie : bien que ces termes semblent indiquer un rapport antithétique, on s'aperçoit qu'il y atoujours eu un commerce étroit entre eux.
En effet, toujours loin de la vérité, le philosophe doit au départ sedégager des opinions qui rentrent naturellement en son esprit.
Car avant de vouloir combattre l'opinion, le préjugé, ilfaut déjà les cerner en soi.
Ainsi tous les jugements sont faillibles, puisqu'ils reflètent d'abord un esprit subjectif quiaffirme, mais aussi un esprit ancré dans une culture, dans un système de valeur.
La philosophie elle-même, quiintègre tout un tas de conceptions (dont beaucoup sont contradictoires), n'est-elle pas au final le lieu des opinionsréfléchies ? Et la philosophie n'est-elle pas en fin de compte cet éternel dialogue des opinions entre elles ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La philosophie doit-elle s'opposer à l'opinion ?
- Philosophie : L'Opinion
- ÉPICTÈTE, Entretiens: philosophie et opinion
- La philosophie réside-t-elle dans une quelconque opinion ?
- En Philosophie L'opinion a-t-elle nécessairement tort ?