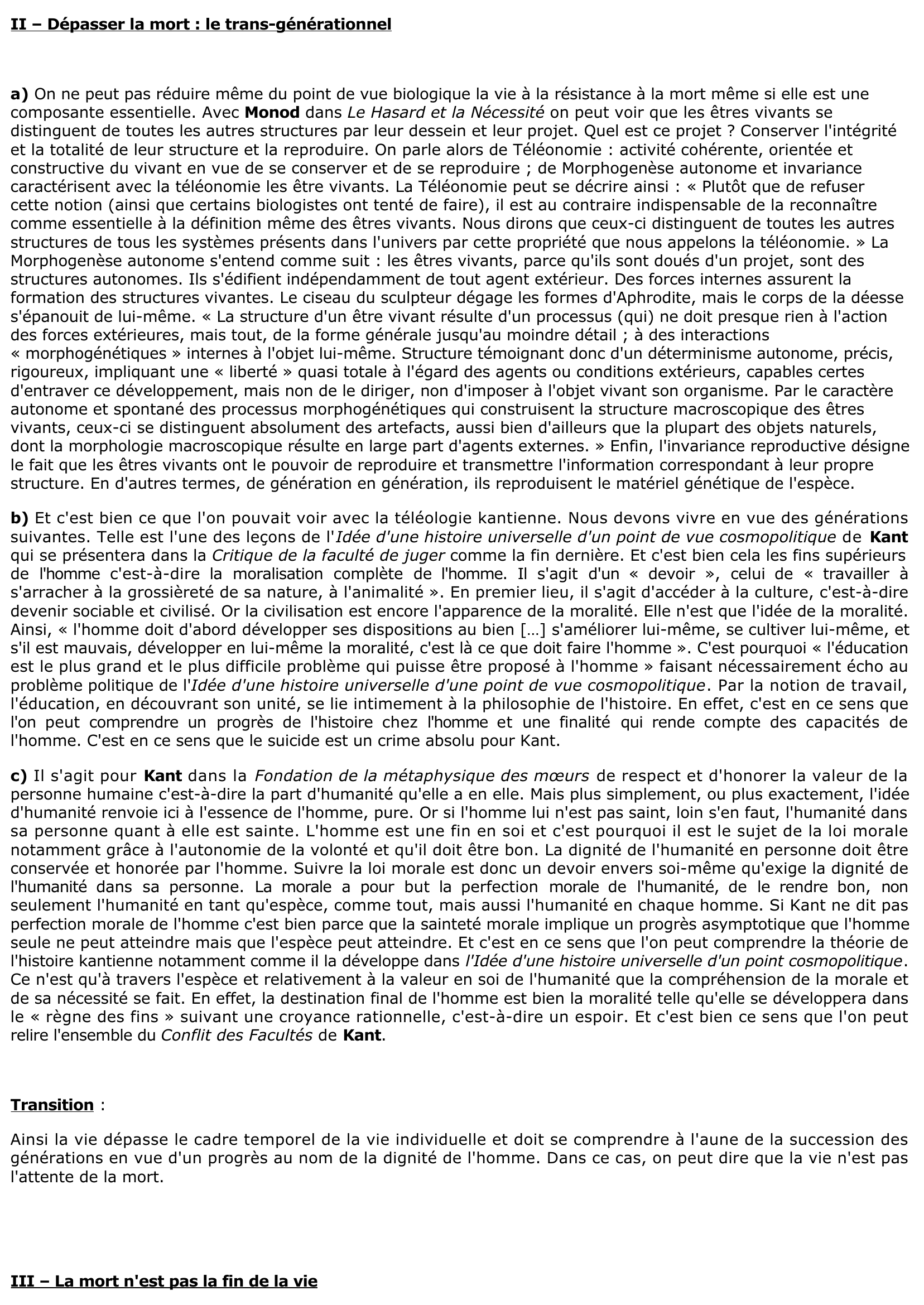Pourquoi donc vivre si l'on doit mourir ?
Publié le 01/08/2010

Extrait du document
Comme le dit Bichat dans ses Recherches physiologiques sur la vie et la mort : « La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort «. Ainsi du point de vue biologiquement, la vie n’est que l’antichambre de la mort : un temps d’attente. Mais dans ce cas, à quoi bon vivre ? Quel est le sens et le but ? C’est bien la question qui est au cœur du sujet et nous invite à nous interroger sur le sens même de la poursuite d’une vie que l’on sait temporaire. Dès lors faudra-t-il sans doute dépasser le cadre purement biologiquement pour en développer le sens moral voire métaphysique.
Si la vie n’est qu’attente de la mort (1ère partie), le vivant ne s’y réduit pas (2nd partie) et par son aspiration dépasse même cette mort (3ème partie).
«
II – Dépasser la mort : le trans-générationnel
a) On ne peut pas réduire même du point de vue biologique la vie à la résistance à la mort même si elle est unecomposante essentielle.
Avec Monod dans Le Hasard et la Nécessité on peut voir que les êtres vivants se distinguent de toutes les autres structures par leur dessein et leur projet.
Quel est ce projet ? Conserver l'intégritéet la totalité de leur structure et la reproduire.
On parle alors de Téléonomie : activité cohérente, orientée etconstructive du vivant en vue de se conserver et de se reproduire ; de Morphogenèse autonome et invariancecaractérisent avec la téléonomie les être vivants.
La Téléonomie peut se décrire ainsi : « Plutôt que de refusercette notion (ainsi que certains biologistes ont tenté de faire), il est au contraire indispensable de la reconnaîtrecomme essentielle à la définition même des êtres vivants.
Nous dirons que ceux-ci distinguent de toutes les autresstructures de tous les systèmes présents dans l'univers par cette propriété que nous appelons la téléonomie.
» LaMorphogenèse autonome s'entend comme suit : les êtres vivants, parce qu'ils sont doués d'un projet, sont desstructures autonomes.
Ils s'édifient indépendamment de tout agent extérieur.
Des forces internes assurent laformation des structures vivantes.
Le ciseau du sculpteur dégage les formes d'Aphrodite, mais le corps de la déesses'épanouit de lui-même.
« La structure d'un être vivant résulte d'un processus (qui) ne doit presque rien à l'actiondes forces extérieures, mais tout, de la forme générale jusqu'au moindre détail ; à des interactions« morphogénétiques » internes à l'objet lui-même.
Structure témoignant donc d'un déterminisme autonome, précis,rigoureux, impliquant une « liberté » quasi totale à l'égard des agents ou conditions extérieurs, capables certesd'entraver ce développement, mais non de le diriger, non d'imposer à l'objet vivant son organisme.
Par le caractèreautonome et spontané des processus morphogénétiques qui construisent la structure macroscopique des êtresvivants, ceux-ci se distinguent absolument des artefacts, aussi bien d'ailleurs que la plupart des objets naturels,dont la morphologie macroscopique résulte en large part d'agents externes.
» Enfin, l'invariance reproductive désignele fait que les êtres vivants ont le pouvoir de reproduire et transmettre l'information correspondant à leur proprestructure.
En d'autres termes, de génération en génération, ils reproduisent le matériel génétique de l'espèce.
b) Et c'est bien ce que l'on pouvait voir avec la téléologie kantienne.
Nous devons vivre en vue des générationssuivantes.
Telle est l'une des leçons de l' Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique de Kant qui se présentera dans la Critique de la faculté de juger comme la fin dernière.
Et c'est bien cela les fins supérieurs de l'homme c'est-à-dire la moralisation complète de l'homme.
Il s'agit d'un « devoir », celui de « travailler às'arracher à la grossièreté de sa nature, à l'animalité ».
En premier lieu, il s'agit d'accéder à la culture, c'est-à-diredevenir sociable et civilisé.
Or la civilisation est encore l'apparence de la moralité.
Elle n'est que l'idée de la moralité.Ainsi, « l'homme doit d'abord développer ses dispositions au bien […] s'améliorer lui-même, se cultiver lui-même, ets'il est mauvais, développer en lui-même la moralité, c'est là ce que doit faire l'homme ».
C'est pourquoi « l'éducationest le plus grand et le plus difficile problème qui puisse être proposé à l'homme » faisant nécessairement écho auproblème politique de l' Idée d'une histoire universelle d'une point de vue cosmopolitique .
Par la notion de travail, l'éducation, en découvrant son unité, se lie intimement à la philosophie de l'histoire.
En effet, c'est en ce sens quel'on peut comprendre un progrès de l'histoire chez l'homme et une finalité qui rende compte des capacités del'homme.
C'est en ce sens que le suicide est un crime absolu pour Kant.
c) Il s'agit pour Kant dans la Fondation de la métaphysique des mœurs de respect et d'honorer la valeur de la personne humaine c'est-à-dire la part d'humanité qu'elle a en elle.
Mais plus simplement, ou plus exactement, l'idéed'humanité renvoie ici à l'essence de l'homme, pure.
Or si l'homme lui n'est pas saint, loin s'en faut, l'humanité danssa personne quant à elle est sainte.
L'homme est une fin en soi et c'est pourquoi il est le sujet de la loi moralenotamment grâce à l'autonomie de la volonté et qu'il doit être bon.
La dignité de l'humanité en personne doit êtreconservée et honorée par l'homme.
Suivre la loi morale est donc un devoir envers soi-même qu'exige la dignité del'humanité dans sa personne.
La morale a pour but la perfection morale de l'humanité, de le rendre bon, nonseulement l'humanité en tant qu'espèce, comme tout, mais aussi l'humanité en chaque homme.
Si Kant ne dit pasperfection morale de l'homme c'est bien parce que la sainteté morale implique un progrès asymptotique que l'hommeseule ne peut atteindre mais que l'espèce peut atteindre.
Et c'est en ce sens que l'on peut comprendre la théorie del'histoire kantienne notamment comme il la développe dans l'Idée d'une histoire universelle d'un point cosmopolitique . Ce n'est qu'à travers l'espèce et relativement à la valeur en soi de l'humanité que la compréhension de la morale etde sa nécessité se fait.
En effet, la destination final de l'homme est bien la moralité telle qu'elle se développera dansle « règne des fins » suivant une croyance rationnelle, c'est-à-dire un espoir.
Et c'est bien ce sens que l'on peutrelire l'ensemble du Conflit des Facultés de Kant .
Transition :
Ainsi la vie dépasse le cadre temporel de la vie individuelle et doit se comprendre à l'aune de la succession desgénérations en vue d'un progrès au nom de la dignité de l'homme.
Dans ce cas, on peut dire que la vie n'est pasl'attente de la mort.
III – La mort n'est pas la fin de la vie.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- faut-il vivre comme si nous devions jamais mourir ?
- « Vivre, c’est apprendre à mourir ».
- Faudrait-il vivre comme si nous ne devions jamais mourir ?
- Doit-on vivre comme si l'on ne devait jamais mourir ?
- Faudrait-il vivre comme si nous ne devions jamais mourir ?