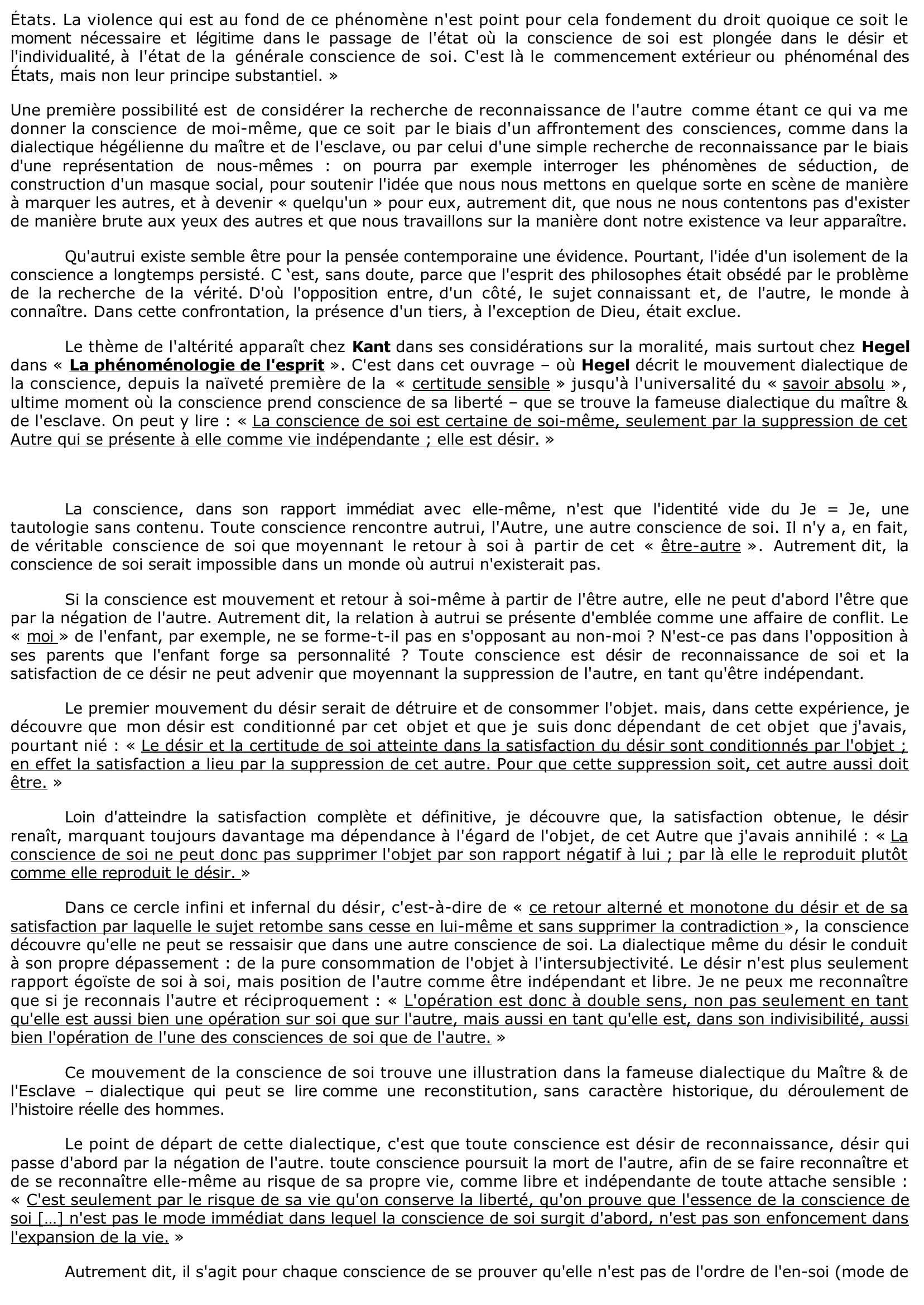Pourquoi l'homme désire-t-il être reconnu par les autres ?
Publié le 27/03/2005

Extrait du document
La question « pourquoi ? « demande que l'on s'interroge sur les causes d'un phénomène, sur son origine. L'objet ici en question est le fait de « chercher à être reconnu par les autres «. Le verbe « chercher à « montre que c'est un effort que nous accomplissons qui est mis en question, donc, plus généralement, un comportement que nous adoptons : le sujet semble donc porter sur une attitude propre à l'humanité, désignée par le pronom « on «.
Ce vers quoi tend vers cet effort est le fait d'être reconnu par les autres. Être reconnu n'est pas être connu : la reconnaissance comporte une dimension de prise en compte totale de ce que nous sommes ; la notion de connaissance ne possède pas cette dimension.
Ceux qui doivent accomplir cette reconnaissance, ce sont les « autres « : autrui, c'est mon semblable humain – on considère qu'un groupe de personnes est un groupe d' « autres «, contrairement à un troupeau de buffles par exemple -, mais c'est aussi celui qui est différent de moi. La question de l'altérité contient ces deux notions de similitude et de différence.
On aborde alors les éléments suivants : « Le sujet part ici d'un constat : nous cherchons à être reconnus par les autres. Que signifie cette notion de reconnaissance ? Pour aborder cela et clarifier le sens du sujet, partez par exemple de la notion d'ignorance et saisissez en quoi le fait d'être ignoré par les autres peut être insupportable. Demandez vous alors de quelle manière nous voulons être reconnus. Essayez de voir en quoi cela met en cause notre image auprès des autres et en quoi cette image peut être essentielle pour nous. Il faut alors s'interroger à savoir pourquoi le rapport aux autres nous met dans cette attitude de représentation nécessaire. Ce sujet vous demande alors de vous interroger sur la place et le rôle de l'autre dans notre rapport à nous-mêmes. Vous pouvez par exemple voir comment le rapport à l'autre peut déterminer l'estime de soi. Comment le rejet de l'autre peut conduire au mépris de soi... Cela ne tend-il pas à saisir ce en quoi l'autre peut être déterminant pour nous et ce en quoi il nous constitue ? «
L'aide de votre professeur met en avant les concepts d'image de nous auprès d'autrui, et pose la question de la représentation que nous nous créons de nous-mêmes et que nous affichons auprès des autres : il faudra proposer une explication de l'existence de ces phénomènes de représentation, ce qui sera révélateur de la relation que nous entretenons avec autrui du point de vue de la construction de notre propre être. C'est en effet dans ce travail sur notre relation à autrui tournée vers la constitution de nous-mêmes que l'on pourra certainement trouver les causes de notre recherche de reconnaissance auprès des autres.
«
États.
La violence qui est au fond de ce phénomène n'est point pour cela fondement du droit quoique ce soit lemoment nécessaire et légitime dans le passage de l'état où la conscience de soi est plongée dans le désir etl'individualité, à l'état de la générale conscience de soi.
C'est là le commencement extérieur ou phénoménal desÉtats, mais non leur principe substantiel.
»
Une première possibilité est de considérer la recherche de reconnaissance de l'autre comme étant ce qui va medonner la conscience de moi-même, que ce soit par le biais d'un affrontement des consciences, comme dans ladialectique hégélienne du maître et de l'esclave, ou par celui d'une simple recherche de reconnaissance par le biaisd'une représentation de nous-mêmes : on pourra par exemple interroger les phénomènes de séduction, deconstruction d'un masque social, pour soutenir l'idée que nous nous mettons en quelque sorte en scène de manièreà marquer les autres, et à devenir « quelqu'un » pour eux, autrement dit, que nous ne nous contentons pas d'existerde manière brute aux yeux des autres et que nous travaillons sur la manière dont notre existence va leur apparaître.
Qu'autrui existe semble être pour la pensée contemporaine une évidence.
Pourtant, l'idée d'un isolement de la conscience a longtemps persisté.
C ‘est, sans doute, parce que l'esprit des philosophes était obsédé par le problèmede la recherche de la vérité.
D'où l'opposition entre, d'un côté, le sujet connaissant et, de l'autre, le monde àconnaître.
Dans cette confrontation, la présence d'un tiers, à l'exception de Dieu, était exclue.
Le thème de l'altérité apparaît chez Kant dans ses considérations sur la moralité, mais surtout chez Hegel dans « La phénoménologie de l'esprit ».
C'est dans cet ouvrage – où Hegel décrit le mouvement dialectique de la conscience, depuis la naïveté première de la « certitude sensible » jusqu'à l'universalité du « savoir absolu », ultime moment où la conscience prend conscience de sa liberté – que se trouve la fameuse dialectique du maître &de l'esclave.
On peut y lire : « La conscience de soi est certaine de soi-même, seulement par la suppression de cet Autre qui se présente à elle comme vie indépendante ; elle est désir. »
La conscience, dans son rapport immédiat avec elle-même, n'est que l'identité vide du Je = Je, une tautologie sans contenu.
Toute conscience rencontre autrui, l'Autre, une autre conscience de soi.
Il n'y a, en fait,de véritable conscience de soi que moyennant le retour à soi à partir de cet « être-autre ».
Autrement dit, la conscience de soi serait impossible dans un monde où autrui n'existerait pas.
Si la conscience est mouvement et retour à soi-même à partir de l'être autre, elle ne peut d'abord l'être que par la négation de l'autre.
Autrement dit, la relation à autrui se présente d'emblée comme une affaire de conflit.
Le« moi » de l'enfant, par exemple, ne se forme-t-il pas en s'opposant au non-moi ? N'est-ce pas dans l'opposition à ses parents que l'enfant forge sa personnalité ? Toute conscience est désir de reconnaissance de soi et lasatisfaction de ce désir ne peut advenir que moyennant la suppression de l'autre, en tant qu'être indépendant.
Le premier mouvement du désir serait de détruire et de consommer l'objet.
mais, dans cette expérience, je découvre que mon désir est conditionné par cet objet et que je suis donc dépendant de cet objet que j'avais,pourtant nié : « Le désir et la certitude de soi atteinte dans la satisfaction du désir sont conditionnés par l'objet ; en effet la satisfaction a lieu par la suppression de cet autre.
Pour que cette suppression soit, cet autre aussi doitêtre. »
Loin d'atteindre la satisfaction complète et définitive, je découvre que, la satisfaction obtenue, le désir renaît, marquant toujours davantage ma dépendance à l'égard de l'objet, de cet Autre que j'avais annihilé : « La conscience de soi ne peut donc pas supprimer l'objet par son rapport négatif à lui ; par là elle le reproduit plutôtcomme elle reproduit le désir.
»
Dans ce cercle infini et infernal du désir, c'est-à-dire de « ce retour alterné et monotone du désir et de sa satisfaction par laquelle le sujet retombe sans cesse en lui-même et sans supprimer la contradiction », la conscience découvre qu'elle ne peut se ressaisir que dans une autre conscience de soi.
La dialectique même du désir le conduità son propre dépassement : de la pure consommation de l'objet à l'intersubjectivité.
Le désir n'est plus seulementrapport égoïste de soi à soi, mais position de l'autre comme être indépendant et libre.
Je ne peux me reconnaîtreque si je reconnais l'autre et réciproquement : « L'opération est donc à double sens, non pas seulement en tant qu'elle est aussi bien une opération sur soi que sur l'autre, mais aussi en tant qu'elle est, dans son indivisibilité, aussibien l'opération de l'une des consciences de soi que de l'autre. »
Ce mouvement de la conscience de soi trouve une illustration dans la fameuse dialectique du Maître & de l'Esclave – dialectique qui peut se lire comme une reconstitution, sans caractère historique, du déroulement del'histoire réelle des hommes.
Le point de départ de cette dialectique, c'est que toute conscience est désir de reconnaissance, désir qui passe d'abord par la négation de l'autre.
toute conscience poursuit la mort de l'autre, afin de se faire reconnaître etde se reconnaître elle-même au risque de sa propre vie, comme libre et indépendante de toute attache sensible :« C'est seulement par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté, qu'on prouve que l'essence de la conscience desoi […] n'est pas le mode immédiat dans lequel la conscience de soi surgit d'abord, n'est pas son enfoncement dansl'expansion de la vie. »
Autrement dit, il s'agit pour chaque conscience de se prouver qu'elle n'est pas de l'ordre de l'en-soi (mode de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le concept de bonheur est un concept si indéterminé, que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut.
- Au nombre des choses qui peuvent porter un penseur au désespoir se trouve d'avoir reconnu que l'illogique est nécessaire à l'homme, et qu'il en naît beaucoup de bien.
- L'homme désire t-il le connu ou l'inconnu ?
- Pourquoi l'homme désire-t-il l'inconscience ?
- l'homme ne désire-t-il que ce dont il a besoin ?