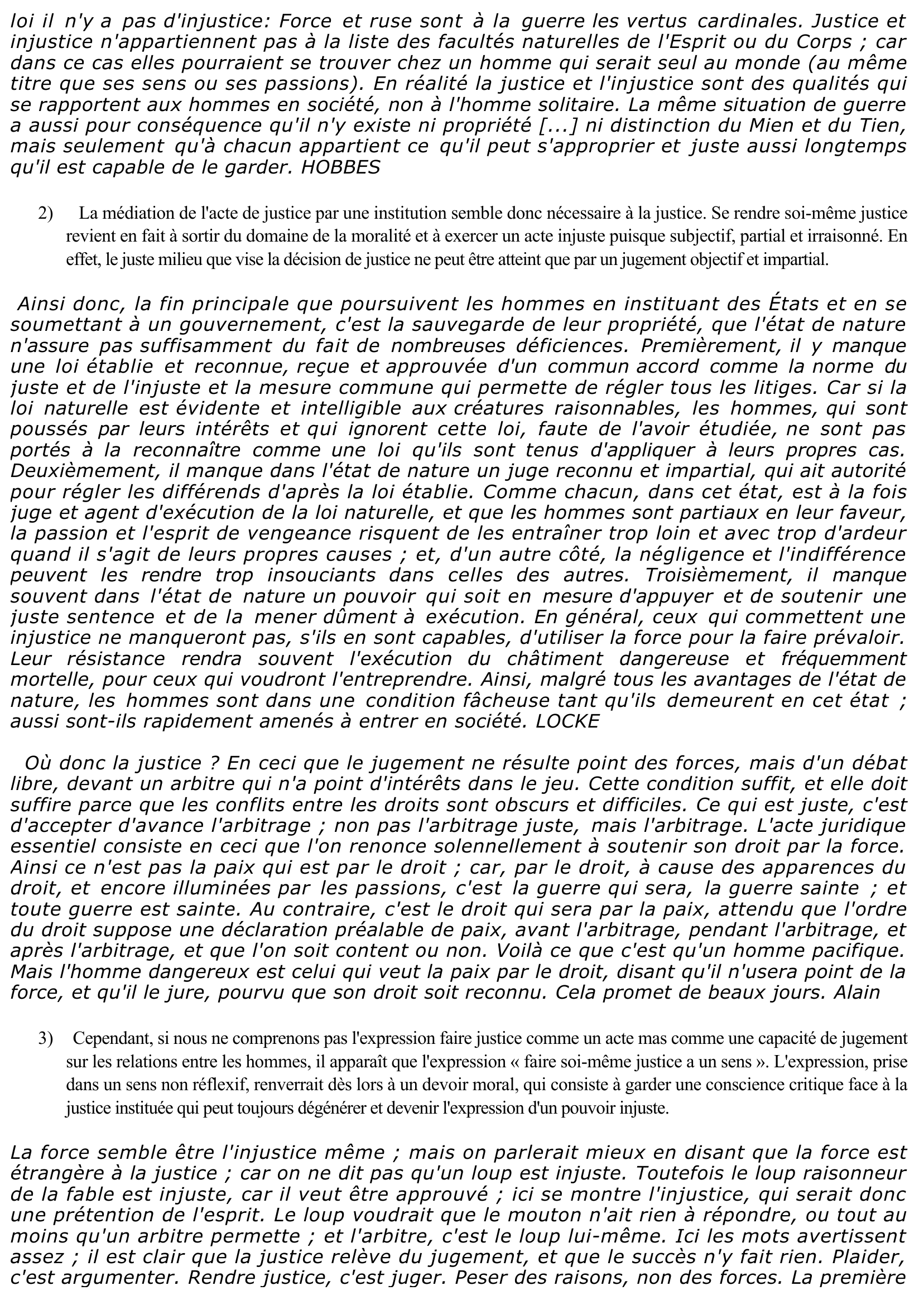Puis-je me faire justice moi-même ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document


«
loi il n'y a pas d'injustice: Force et ruse sont à la guerre les vertus cardinales.
Justice etinjustice n'appartiennent pas à la liste des facultés naturelles de l'Esprit ou du Corps ; cardans ce cas elles pourraient se trouver chez un homme qui serait seul au monde (au mêmetitre que ses sens ou ses passions).
En réalité la justice et l'injustice sont des qualités quise rapportent aux hommes en société, non à l'homme solitaire.
La même situation de guerrea aussi pour conséquence qu'il n'y existe ni propriété [...] ni distinction du Mien et du Tien,mais seulement qu'à chacun appartient ce qu'il peut s'approprier et juste aussi longtempsqu'il est capable de le garder.
HOBBES 2) La médiation de l'acte de justice par une institution semble donc nécessaire à la justice.
Se rendre soi-même justicerevient en fait à sortir du domaine de la moralité et à exercer un acte injuste puisque subjectif, partial et irraisonné.
Eneffet, le juste milieu que vise la décision de justice ne peut être atteint que par un jugement objectif et impartial. Ainsi donc, la fin principale que poursuivent les hommes en instituant des États et en sesoumettant à un gouvernement, c'est la sauvegarde de leur propriété, que l'état de naturen'assure pas suffisamment du fait de nombreuses déficiences.
Premièrement, il y manqueune loi établie et reconnue, reçue et approuvée d'un commun accord comme la norme dujuste et de l'injuste et la mesure commune qui permette de régler tous les litiges.
Car si laloi naturelle est évidente et intelligible aux créatures raisonnables, les hommes, qui sontpoussés par leurs intérêts et qui ignorent cette loi, faute de l'avoir étudiée, ne sont pasportés à la reconnaître comme une loi qu'ils sont tenus d'appliquer à leurs propres cas.Deuxièmement, il manque dans l'état de nature un juge reconnu et impartial, qui ait autoritépour régler les différends d'après la loi établie.
Comme chacun, dans cet état, est à la foisjuge et agent d'exécution de la loi naturelle, et que les hommes sont partiaux en leur faveur,la passion et l'esprit de vengeance risquent de les entraîner trop loin et avec trop d'ardeurquand il s'agit de leurs propres causes ; et, d'un autre côté, la négligence et l'indifférencepeuvent les rendre trop insouciants dans celles des autres.
Troisièmement, il manquesouvent dans l'état de nature un pouvoir qui soit en mesure d'appuyer et de soutenir unejuste sentence et de la mener dûment à exécution.
En général, ceux qui commettent uneinjustice ne manqueront pas, s'ils en sont capables, d'utiliser la force pour la faire prévaloir.Leur résistance rendra souvent l'exécution du châtiment dangereuse et fréquemmentmortelle, pour ceux qui voudront l'entreprendre.
Ainsi, malgré tous les avantages de l'état denature, les hommes sont dans une condition fâcheuse tant qu'ils demeurent en cet état ;aussi sont-ils rapidement amenés à entrer en société.
LOCKE Où donc la justice ? En ceci que le jugement ne résulte point des forces, mais d'un débatlibre, devant un arbitre qui n'a point d'intérêts dans le jeu.
Cette condition suffit, et elle doitsuffire parce que les conflits entre les droits sont obscurs et difficiles.
Ce qui est juste, c'estd'accepter d'avance l'arbitrage ; non pas l'arbitrage juste, mais l'arbitrage.
L'acte juridiqueessentiel consiste en ceci que l'on renonce solennellement à soutenir son droit par la force.Ainsi ce n'est pas la paix qui est par le droit ; car, par le droit, à cause des apparences dudroit, et encore illuminées par les passions, c'est la guerre qui sera, la guerre sainte ; ettoute guerre est sainte.
Au contraire, c'est le droit qui sera par la paix, attendu que l'ordredu droit suppose une déclaration préalable de paix, avant l'arbitrage, pendant l'arbitrage, etaprès l'arbitrage, et que l'on soit content ou non.
Voilà ce que c'est qu'un homme pacifique.Mais l'homme dangereux est celui qui veut la paix par le droit, disant qu'il n'usera point de laforce, et qu'il le jure, pourvu que son droit soit reconnu.
Cela promet de beaux jours.
Alain 3) Cependant, si nous ne comprenons pas l'expression faire justice comme un acte mas comme une capacité de jugementsur les relations entre les hommes, il apparaît que l'expression « faire soi-même justice a un sens ».
L'expression, prisedans un sens non réflexif, renverrait dès lors à un devoir moral, qui consiste à garder une conscience critique face à lajustice instituée qui peut toujours dégénérer et devenir l'expression d'un pouvoir injuste. La force semble être l'injustice même ; mais on parlerait mieux en disant que la force estétrangère à la justice ; car on ne dit pas qu'un loup est injuste.
Toutefois le loup raisonneurde la fable est injuste, car il veut être approuvé ; ici se montre l'injustice, qui serait doncune prétention de l'esprit.
Le loup voudrait que le mouton n'ait rien à répondre, ou tout aumoins qu'un arbitre permette ; et l'arbitre, c'est le loup lui-même.
Ici les mots avertissentassez ; il est clair que la justice relève du jugement, et que le succès n'y fait rien.
Plaider,c'est argumenter.
Rendre justice, c'est juger.
Peser des raisons, non des forces.
La première.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Sujet Faire régner la justice, est-ce seulement appliquer le droit?
- Faire régner la justice, est-ce seulement appliquer le droit ?
- Pour éviter de heurter, je dois faire ici remarquer que, lorsque je nie que la justice soit une vertu naturelle, je fais usage du mot naturel uniquement en tant qu'opposé à artificiel.
- Qui doit faire régner la justice ?
- Le droit peut-il faire abstraction de la notion de justice ?