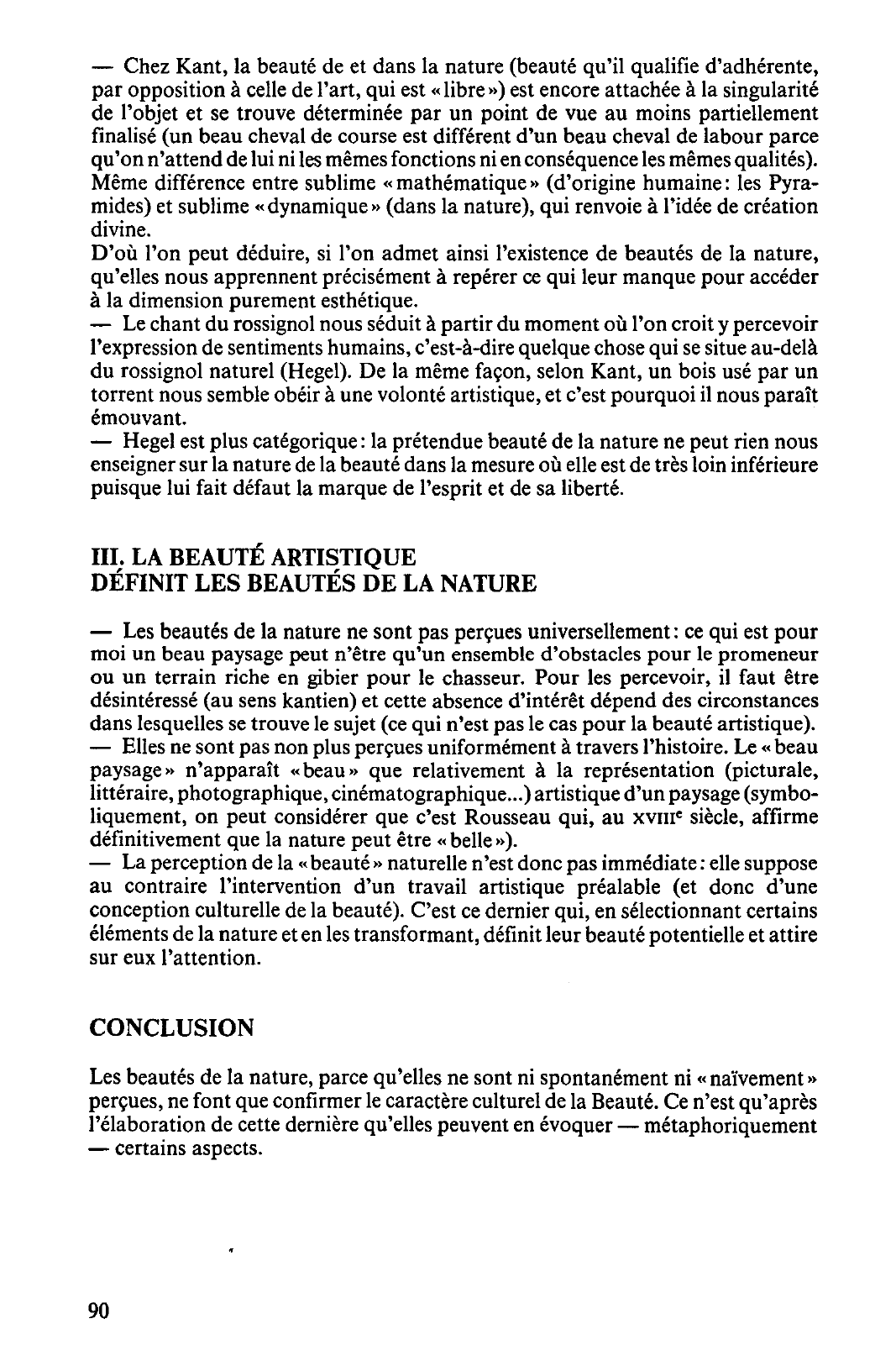Que nous apprennent les beautés de la nature sur la nature même de la beauté?
Publié le 25/09/2018

Extrait du document
— Chez Kant, la beauté de et dans la nature (beauté qu’il qualifie d’adhérente, par opposition à celle de l’art, qui est « libre ») est encore attachée à la singularité de l’objet et se trouve déterminée par un point de vue au moins partiellement finalisé (un beau cheval de course est différent d’un beau cheval de labour parce qu’on n’attend de lui ni les mêmes fonctions ni en conséquence les mêmes qualités). Même différence entre sublime « mathématique » (d’origine humaine : les Pyramides) et sublime «dynamique» (dans la nature), qui renvoie à l’idée de création divine.
D’où l’on peut déduire, si l’on admet ainsi l’existence de beautés de la nature, qu’elles nous apprennent précisément à repérer ce qui leur manque pour accéder à la dimension purement esthétique.
«
-Chez Kant, la beauté de et dans la nature (beauté qu'il qualifie d'adhérente,
par opposition à celle de l'art, qui est« libre») est encore attachée à la singularité
de l'objet et
se trouve déterminée par un point de vue au moins partiellement
finalisé (un beau cheval de course est différent d'un beau cheval de labour parce
qu'on n'attend de lui ni les mêmes fonctions ni en conséquence les mêmes qualités).
Même différence entre sublime
«mathématique» (d'origine humaine: les Pyra
mides) et sublime «dynamique» (dans la nature), qui renvoie à l'idée de création
divine.
D'où l'on peut déduire, si l'on admet ainsi l'existence de beautés de la nature,
qu'elles nous apprennent précisément à repérer
ce qui leur manque pour accéder
à la dimension purement esthétique.
- Le chant du rossignol nous séduit à partir du moment
où l'on croit y percevoir
l'expression de sentiments humains, c'est-à-dire quelque chose qui
se situe au-delà
du rossignol naturel (Hegel).
De la même façon, selon Kant, un bois usé par un
torrent nous semble obéir
à une volonté artistique, et c'est pourquoi il nous paraît
émouvant.
- Hegel est plus catégorique: la prétendue beauté de la nature ne peut rien nous
enseigner sur la nature
de la beauté dans la mesure où elle est de très loin inférieure
puisque lui fait défaut la marque de l'esprit et
de sa liberté.
III.
LA BEAUTÉ ARTISTIQUE
DÉFINIT LES BEAUTÉS DE LA NATURE
- Les beautés de la nature ne sont pas perçues universellement: ce qui est pour
moi un beau paysage peut n'être qu'un ensemble d'obstacles pour le promeneur ou un terrain riche en gibier pour le chasseur.
Pour les percevoir, il faut être
désintéressé (au sens kantien) et cette absence d'intérêt dépend des circonstances
dans lesquelles
se trouve le sujet (ce qui n'est pas Je cas pour la beauté artistique).
- Elles
ne sont pas non plus perçues uniformément à travers l'histoire.
Le« beau paysage» n'apparaît «beau» que relativement à la représentation (picturale,
littéraire, photographique, cinématographique ...
) artistique
d'un paysage (symbo
liquement, on peut considérer que c'est Rousseau qui, au xvm• siècle, affirme
définitivement que la nature peut être «belle»).
-La perception de la «beauté» naturelle n'est donc pas immédiate: elle suppose
au contraire l'intervention d'un travail artistique préalable (et donc d'une
conception culturelle de la beauté).
C'est
ce dernier qui, en sélectionnant certains
éléments de la nature et en
les transformant, définit leur beauté potentielle et attire
sur eux l'attention.
CONCLUSION
Les beautés de la nature, parce qu'elles ne sont ni spontanément ni «naïvement»
perçues, ne font que confirmer le caractère culturel de la Beauté.
Ce n'est qu'après
l'élaboration de cette dernière qu'elles peuvent en évoquer -métaphoriquement
- certains aspects.
90.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Que nous apprennent les beautés de la nature sur la nature même de la beauté?
- Que nous apprennent les beautés naturelles sur la nature même de la beauté ?
- Que nous apprennent les beautés de la nature sur la nature même de la beauté ?
- Que nous apprennent les beautés de la nature sur la nature même de la beauté
- Jean-Claude Tournand écrit : «Il a fallu que s'élaborent au moyen d'une longue expérience les règles de chaque genre, que les écrivains apprennent à en dominer les contraintes et à conquérir à travers elles l'art de communiquer leurs plus intimes pensées. L'idéal classique exige à la fois une idée suffisamment claire pour être totalement communicable, et un langage suffisamment précis pour communiquer cette idée et elle seule : l'idée ne doit pas échapper au langage, mais le langage do